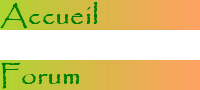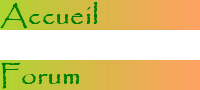Vous êtes
recteur de l'Académie Vaganova, mais vous venez de Moscou. Comment,
quand on vient de Moscou, se fait-on accepter à Saint-Pétersbourg?
Moscou,
oui, c'est ma maison. J'adore Saint-Pétersbourg, mais je n'en vois
plus rien maintenant que je travaille ici. La semaine, je la passe à
Saint-Pétersbourg et le week-end – les samedi et dimanche –, je
suis à Moscou, c'est comme des vacances. Mais j'ai quand même dansé
durant dix-huit saisons au Mariinsky en tant que danseur invité –
je m'y produisais deux ou trois fois dans l'année.
Qu'est-ce
qui vous intéressait dans ce poste? Aviez-vous un goût
particulier pour l'enseignement?
J'ai
commencé à étudier la danse à Tbilissi, puis je suis ensuite allé
étudier à Moscou, et je me rends compte que tous les professeurs
que j'ai eus viennent de Saint-Pétersbourg et ont été élèves de
cette école. Je ne suis pas citoyen de Léningrad, mais au fond, je
suis un peu d'ici comme danseur. Donc me retrouver à la tête de
cette école, je le vois comme un signe du destin. Oui, c'est un
signe du destin. Les personnes qui ont le plus compté dans ma vie,
ce sont Mesdames Galina Oulanova et Marina Semyonova. Elles m'ont
appris non pas tant à être un danseur qu'un acteur sur scène. Ça,
c'est la culture russe et c'est là que réside la grande différence
avec ailleurs. La danse, ce n'est pas un «joli pied».
Enfin oui, pourquoi pas, c'est bien, d'accord. Mais être sur scène,
c'est d'abord être acteur.

Agrippina Vaganova
Quand
vous êtes arrivé ici, y a-t-il des choses que vous avez voulu
changer?
Non.
Il ne s'agit pas pour moi de changer, mais disons qu'il faut prendre
en compte le fait que le monde change. Madame Vaganova a écrit son
livre, Principes du ballet classique, en 1934, justement pour
cette raison. A l'époque, on donnait douze, treize, quatorze
représentations de ballet par mois au Théâtre Mariinsky, c'était
déjà beaucoup plus qu'à l'époque impériale, où on en donnait
environ quatre. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose comme
vingt-huit, voire trente représentations de ballet, que l'on
donne par mois! Le fait est que la façon de vivre a changé
complètement. Les jeunes diplômés qui sortent d'ici pour être
engagés, une autre vie les attend au théâtre. Ici, c'est un peu
comme leur maison, comme leur maman. On s'occupe d'eux en permanence,
on se préoccupe de ce qu'ils veulent danser, de ce qu'ils mangent,
de leur santé... Mais au théâtre, la vie est complètement
différente. Donc, je ne veux pas changer le fond, je veux simplement
un tout petit peu corriger le système, comme Vaganova a pu le faire
en 1934, pour mieux préparer les enfants à la vie qu'ils mèneront
ensuite au théâtre.
Vous avez
récemment remonté le ballet La Fée des Poupées des frères
Legat pour les élèves de l'Académie. Y a-t-il d'autres ballets du
répertoire de l'Académie que vous aimeriez remonter?
Ce
ballet est parfait pour nos élèves, d'abord parce qu'il permet de
faire danser toutes les classes : il y a de nombreux rôles pour
les petits, pour les niveaux intermédiaires et pour les danseurs qui
passent leur diplôme. Ensuite, tout y est très beau, que ce soit la
musique, l'histoire, et bien sûr les décors. C'est le premier
ballet des frères Legat et la première œuvre que Léon Bakst a
faite pour le Théâtre Mariinsky. Il se trouve que cette année,
c'est le 150e anniversaire de la naissance de Léon Bakst.
Après
ça, je vais remonter le Boléro de Bronislava Nijinska, pour
célébrer le 125e anniversaire de sa naissance. Les élèves vont le
donner pour le spectacle de fin d'études. C'est un ballet qui fut
créé à l'origine pour Ida Rubinstein. Elle ne l'a pas dansé à
Léningrad et ce sera donc la première fois qu'il sera donné au
Théâtre Mariinsky. Nous avons repris pour cela la chorégraphie
qu'avait remontée Andris Liepa avec le Ballet du Kremlin. Moi-même
je ne l'ai pas dansé, mais j'avais fait L'Après-midi d'un faune.
Il faut savoir que c''est la première version chorégraphique du
Boléro de Ravel. Tout le monde pense que c'est Monsieur
Béjart qui a imaginé cette danseuse qui danse sur une table, mais
non, pardon, c'est Nijinska... (rires).

Nikolaï Tsiskaridzé (portrait officiel)
Et les
autres ballets de ce spectacle?
Cette
année, nous montons la scène de ballet de l'opéra de Glinka, Ivan
Soussanine - le bal polonais. C'est une grande scène de ballet
qui comprend quatre danses : une polonaise, une krakowiak, une
valse, une mazurka. Cela fait trente ans qu'on ne l'a pas dansée au
Mariinsky. Une grande partie de la chorégraphie a disparu, mais il y
a encore quelques vieux professeurs qui l'ont dansée et ont aidé à
le remonter. Il y aura aussi le dernier chef d’œuvre de Fokine,
chorégraphié juste après la Révolution en 1917 : le Jardin
de Naïna, pour l'opéra de Glinka, Rouslan et Ludmila. C'est
très beau. Il s'agit d'un grand ballet classique, avec beaucoup de
danse, sur pointes évidemment, enfin un tout petit peu
néo-classique, parce que c'est du Fokine. Dans tous ces opéras
anciens, il y avait une grande scène de ballet. Au Mariinsky,
c'était obligatoire. On va donner trois représentations de ce
spectacle au Mariinsky, puis une à Moscou, au Palais du Kremlin.
A part
ça, que pensez-vous des reconstructions menées autour des ballets
de Petipa?
J'ai
dansé La Bayadère de Vikharev au Mariinsky, Le Corsaire
de Ratmansky et Bourlaka au Bolchoï. Alors voilà, je dirais que
c'est amusant, mais que cela n'a rien d'authentique. Par exemple,
dans les ballets, à l'époque de Petipa, le danseur ne danse pas à
proprement parler. Il n'y a pas de grands portés. Regardez les
photos dans le musée... Après la Révolution, des « trucs »,
empruntés au music-hall ou au cirque, ont pénétré au théâtre et
influencé le ballet, mais avant, non, tout ça n'existait pas. Quand
Nijinski est monté sur scène dans Giselle avec son collant
et sa culotte, cela a fait scandale... Maria Fedorovna, la mère de
l'Empereur Nicolas II, s'est offusquée... Et il est parti.
Aujourd'hui, ce n'est plus possible de se priver du danseur! Et
donc, ce ne sont pas des ballets du XIXe siècle que l'on remonte.
Pour moi, le théâtre, ce n'est pas un musée. Mon professeur,
Marina Semyonova a été l'une des dernières ballerines à danser
tous les grands ballets de Petipa. Elle a dansé les dernières
versions de La Belle au bois dormant, du Corsaire, de
La Bayadère, de La Fille du Pharaon, du Lac des
cygnes... Puis elle a quitté le Mariinsky pour Moscou. Au
Mariinsky, les ballets de Petipa ont cessé d'être dansés tels
quels et ont alors été remontés dans de nouvelles versions, tout
d'abord par Agrippina Vaganova, puis par Fiodor Lopoukhov et par
Konstantin Sergueiev. J'avais discuté de cela avec Madame Semyonova.
Je trouvais que c'était intéressant qu'elle ait pu connaître,
elle, les versions anciennes. Elle me répondait que non. Elle
expliquait qu'elle-même, quand elle est montée sur scène pour la
première fois, quand elle était encore jeune et belle, il y avait
déjà toujours, dans ces ballets de Petipa, un arrangement nouveau,
un pas de deux nouveau ou une variation nouvelle pour les solistes.
De
plus, dans ces versions anciennes, la mise en scène était très
importante – c'était même quelque chose d'énorme! La
Fille du pharaon, c'était cinq actes, avec un prologue et
une apothéose – sept actes en quelque sorte. Les représentations
pouvaient débuter à 14h et les entractes duraient très longtemps :
on allait se détendre, boire du champagne..., pendant que derrière
le rideau, on changeait les décors. Maintenant, tout ça n'est plus
possible! Il y a les syndicats qui arrivent et vous disent en
vous mettant la montre sous le nez : «c'est l'heure,
c'est l'heure, c'est l'heure!» (rires) Si aujourd'hui,
on proposait de danser Le Corsaire
dans de telles conditions à
Londres, au Met ou à l'Opéra de Paris, les syndicats nous
diraient
non aussitôt : «Il faut couper le dernier
acte!» (rires) La vie des gens a changé. Alors oui, j'ai
vu
Paquita à Munich, La Belle au bois dormant à New
York... Encore une fois, ces reconstructions sont amusantes, mais le
résultat n'est pas authentique. Monsieur Petipa a travaillé toute
sa vie ici, dans ce bâtiment. Il y a créé tous ses ballets,
car à l'époque, il n'y avait pas de studios de répétition au
Théâtre Mariinsky, ils se trouvaient tous dans les locaux de la rue
Rossi. Les danseurs ne se produisaient pas à New York, à Paris, ou
je ne sais où. Ce sont deux mondes différents.

Hall d'entrée de l'Académie Vaganova
Vous êtes
directeur de l'Académie, mais est-ce que vous allez voir les élèves
en studio?
J'y
vais tous les jours! Je ne donne pas la classe moi-même, mais
je corrige les élèves et je conduis les répétitions. Cela change
tout le temps. Nous travaillons tous les soirs un répertoire
différent.
Est-ce
que la danse vous manque aujourd'hui?
Non.
J'ai dansé les princes durant toute ma carrière. Je ne suis plus un
prince. Un vieux prince, ce n'est pas beau à voir. En tout cas, en
tant que spectateur, je n'ai pas envie de voir ça. J'ai envie de
voir de beaux garçons, de belles filles sur scène. Alors oui, je
danse de temps en temps la Mère Simone dans La Fille mal gardée
au Théâtre Mikhailovsky. J'aime bien ça. Car je n'oublie pas que
je suis un acteur – et un danseur un tout petit peu encore.
Propos recueillis par Bénédicte Jarrasse