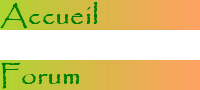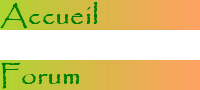|
Christine Camillo, de Paris à Berlin via Londres
04 juillet 2010 : Christine Camillo, Maître de Ballet, se présente
L’histoire
récente du ballet à Berlin est d’abord le reflet de
la partition de l’Allemagne survenue à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale et du statut de la ville, divisée en
quatre zones d’occupation (russe, américaine, anglaise et
française), puis, après la chute du Mur, en 1989, de la
réunification des deux états germaniques, RFA et RDA.
Le bâtiment «historique» de l’Opéra de
Berlin, édifié sur l’avenue «Unter den
Linden» («Sous les Tilleuls») était
situé dans l’ex-zone soviétique. Sa création
remonte à 1741, sous l’impulsion de Frédéric
le Grand. Ravagé par un incendie en 1843, le bâtiment sera
à nouveau détruit, par des bombardements aériens,
durant la Seconde Guerre mondiale. Seule la façade pourra
être sauvée. En 1952, les autorités de la RDA
entreprennent la reconstruction de la Staatsoper («Opéra
national»), qui sera ré-inaugurée en 1955. En
l’an 2000, le gouvernement de l’Allemagne
réunifiée décide de raser la Staatsoper et de la
remplacer par un théâtre neuf, correspondant mieux aux
exigences techniques et artistiques actuelles. D’importantes
manifestations populaires viennent heureusement faire échouer ce
funeste projet, et la Staatsoper est finalement classée monument
historique. D’importants travaux de rénovation y sont
actuellement menés, et la vénérable institution
devrait être rouverte au public pour la saison 2013-2014.
A Berlin-Ouest, l’opéra et le ballet
s’établissent, après 1945, à la
Städtische Oper («Opéra municipal »). La
Städtische Oper fut bâtie en 1911 sur l’emplacement
qu’elle occupe encore aujourd’hui. Egalement
dévastée par un bombardement en 1943, elle ne sera
reconstruite qu’en 1961, et prendra le nom de Deutsche Oper
(«Opéra allemand») à cette occasion.
Dans chacun des deux grands théâtres se développe
une compagnie de ballet. Si les origines de la danse classique
remontent, dans la capitale allemande, à Frédéric
Le Grand, qui fonda, en 1742, la première troupe, il ne reste
plus rien, ou presque, à Berlin, en matière de danse
classique, lorsque le régime national-socialiste
s’effondre en mai 1945.
A l’Est, c’est Tatiana Gsovsky, qui, la première,
s’attèle à remonter une compagnie classique.
Formée à l’école russe, elle
s’intéresse également aux idées de Mary
Wigman, figure emblématique de la danse contemporaine allemande
dans l’entre-deux guerres. En 1951, elle quitte la Staatsoper,
créé sa propre troupe et passe à l’Ouest en
1953. De manière assez surprenante, les autorités de la
RDA choisissent de privilégier non pas le ballet
académique hérité de la tradition russe, mais
choisissent au contraire, pour succéder à Tatiana
Gsovsky, des directeurs qui s’inscrivent dans la filiation de
Mary Wigman : Daisi Spies (1951-1955), Lilo Gruber (1955-1969) et Claus
Schulz (1969-1972). Ce n’est qu’en 1974, avec
l’arrivée d’Egon Bischoff, que le ballet de la
Staatsoper redevient une compagnie «classique»,
constituée de danseurs formés à la méthode
Vaganova. Mickaël Denard, ancien danseur Etoile de
l’Opéra de Paris, succède à Egon Bischoff en
1993 ; sous sa direction, le répertoire classique demeure
prépondérant, mais les ouvrages de Maurice Béjart
ou de Roland Petit font également leur apparition sur la
scène de la Staatsoper.
Tatiana Gsovsky est, par un curieux coup du destin, également
à l’origine de la renaissance du ballet à
Berlin-Ouest. Passée dans le camp occidental, Tatiana Gsvosky
est nommée «Maître de ballet et Chorégraphe
en chef» de la Städtische Oper (future Deutsche Oper) en
1958. En 1966, elle est remplacée par Kenneth MacMillan, auquel
succède quatre ans plus tard, Gerd Reinholm. Si Reinholm, en
poste jusqu’en 1990, se concentre essentiellement sur le ballet
académique, ses successeurs immédiats, Peter Schaufuss
(1990-1994), Ray Barra (1994-1996) et Richard Cragun (1996-1999)
privilégient un répertoire plus actuel. La
dernière directrice de la troupe sera la Française
Sylviane Bayard (1990-2004), disciple de Marcia Haydée, qui
effectua l’essentiel de sa carrière de danseuse au ballet
de Stuttgart.
En 2004, le gouvernement allemand décida, par mesure
d’économie, de fusionner les deux compagnies. A
l’ensemble ainsi constitué se joint une troisième
troupe, celle de la Komische Oper («Opéra-comique»),
elle aussi située dans l’ancienne zone Est, et qui
était dévolue à la danse contemporaine et aux
chorégraphies expérimentales (Blanca Li l’avait
dirigée de 2001 à 2002).
C’est Vladimir Malakhov qui est nommé à la
tête de ce nouveau Staatsballett de Berlin, et
préside encore aujourd’hui à sa destinée.
La Française Christine Camillo, aujourd’hui Maître
de Ballet, a effectué une grande partie de sa carrière
à la Deutsche Oper, dans l’ex-Berlin-Ouest. Elle a
gentiment accepté de retracer son parcours. Dans un autre
entretien, nous ferons connaissance avec Beatrice Knop qui, elle, est une enfant de l’ancienne zone Est de Berlin.

Formée à l’Académie Princesse Grâce
à Monaco, j’ai remporté le Prix de Lausanne en
1981. Cela m’a valu une bourse d’études d’un
an à l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris.
Néanmoins, j’avais peu d’espoir
d’intégrer la compagnie nationale, car il était
extrêmement rare que des élèves venant de
l’«extérieur» soient pris lors du concours.
Claude Bessy, consciente de ce fait, m’a proposé, en guise
d’alternative, de devenir professeur – pas moins! –
pour les danseurs de la troupe, alors que je n’avais que quinze
ans et demi! J’ai évidemment refusé, mais mon
passage à l’Ecole de danse m’aura au moins permis de
profiter de l’enseignement de très bons professeurs, comme
Lucien Duthoit ou Christiane Vaussard. De plus, Claude Bessy
m’avait confié la responsabilité de
l’organisation des répétitions des «portes
ouvertes» – c’est ainsi qu’on appelait à
l’époque le spectacle annuel de l’école.
A l’issue de cette année à l’Ecole de
l’Opéra de Paris, j’ai quitté assez
rapidement la France. De toute façon, il reste un Camillo
à Paris, mon frère Eric, qui enseigne toujours à
l’Ecole de danse!
Je suis donc allée à Londres passer une audition pour
entrer au Scottish Ballet. On m’a d’abord fait savoir
qu’il n’y avait pas de place pour moi, mais la direction de
la compagnie a tout de même gardé mes coordonnées.
En août, on m’a rappelée pour me dire de faire mes
valises tout de suite et de venir en Ecosse. Au bout de trois ans,
j’ai été nommée soliste. En 1986, j’ai
quitté le Scottish Ballet pour aller à Londres, à
l’English National Ballet, alors dirigé par Peter
Schaufuss. Lorsque celui-ci a été nommé directeur
du Ballet de la Deutsche Oper à Berlin, en 1990, il m’a
proposé de le suivre, et j’ai accepté. J’ai
été engagée à la Deutsche Oper avec un
contrat de Première soliste. Peter Schaufuss est parti au
Danemark en 1994, mais là, j’ai décidé de
rester à Berlin. Trois directeurs se sont succédé
de 1994 à 2004 : Ray Barra, Richard Cragun et Sylviane Bayard.
Avec ces différentes personnalités, le répertoire
a beaucoup évolué, et il a fallu a chaque fois
s’adapter. En 2004, les trois compagnies de ballet berlinoises,
Deutsche Oper, Staatsoper et Komische Oper ont été
fusionnées et placées sous la direction de Vladimir
Malakhov. Celui-ci m’a alors proposé de devenir
Maître de Ballet à mi-temps, et de consacrer le reste de
mon temps à mon activité de soliste dans la compagnie.
J’ai refusé, et j’ai préféré
mettre un terme à ma carrière de danseuse, pour me
consacrer entièrement à mes nouvelles fonctions.
J’ai été moi-même formée aux
méthodes russes (Vaganova / Messerer à Monaco) et
française (à l’Opéra de Paris), mais le
choix de la méthode n’est pas ce qui comptait en premier
pour Vladimir Malakhov quand il m’a nommée
Maître de Ballet. Ce qui est prioritaire pour lui, c’est le
niveau artistique de la troupe, et son adaptabilité aux divers
styles des chorégraphies de notre répertoire, de Petipa
à Balanchine ou Cranko. Vladimir Malakhov cherche une
manière plus «moderne» de danser les classiques, en
mettant l’accent sur la beauté plastique et
l’homogénéité des physiques, avec des
mouvements plus libres, mais tout en préservant les fondamentaux
de la méthode russe.
La grande variété du répertoire est
d’ailleurs l’une des caractéristiques saillantes du
Ballet de Berlin. Nous pouvons danser aussi bien Giselle
que des ouvrages de Bigonzetti, de Béjart, de Duato, de Forsythe
ou de Neumeier. Nous avons la chance de posséder suffisamment de
danseurs - quatre-vingt huit - pour aborder des pièces
aussi diverses. Dans le futur, les choses évolueront sans doute
encore un peu, car Vladimir Malakhov se réservera, je pense,
plutôt les chorégraphies néoclassiques et ne
dansera plus lui-même les grands classiques, tels le Lac des Cygnes.
Pour cela, nous avons beaucoup de très bons solistes, et, avec
M. Malakhov, nous sommes très attentifs aux danseurs de la
génération montante, à leur ouverture
d’esprit et à leur capacité à bien
s’intégrer à la compagnie. Il y a peu
d’artistes qui sont entrés au Ballet de Berlin directement
après leur formation, trois ou quatre tout au plus. La plupart
sont venus d’autres troupes, et ont été
engagés à des niveaux différents (corps de ballet,
solistes) en fonction de leur expérience et de leurs
capacités. Mais ensuite, surtout chez les danseurs de corps de
ballet, l’effectif reste assez stable, et il y a peu de
départs. Chez les solistes, il y a évidemment plus de
mouvement. Parmi eux, Polina Semionova est un peu
l’emblème de la compagnie. Elle est arrivée chez
nous à l’âge de dix-huit ans, et Vladimir Malakhov
l’a immédiatement repérée.
Le Ballet de Berlin se trouve actuellement dans une situation de
transition, puisque «sa» maison, la Staatsoper Unter den
Linden, est en travaux pour plusieurs années. Nous sommes
censés y retourner après la fin du chantier, mais le
directeur de l’Opéra, Daniel Barenboïm, semble
vouloir dédier le théâtre «historique»
à la musique. Espérons tout de même qu’il
fera un petit effort pour le ballet!
Christine Camillo - Propos recueillis par R. F.
Entretien
réalisé le 04 juillet 2010 - Beatrice Knop © 2010,
Dansomanie
|
|