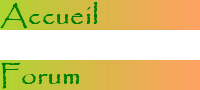 |




|
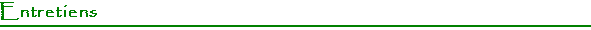
 |
|
|
Wang Qimin et Li Jun, Etoiles du Ballet National de Chine
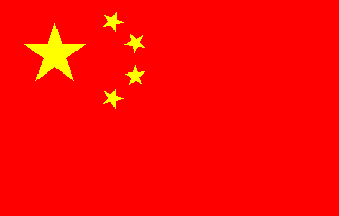 |
中文版 |
12 décembre
2008 : rencontre avec Wang Qimin et Li Jun
Du
19 au 21 décembre 2008, Onegin de John Cranko sera porté
à la scène par le Ballet National de Chine. Les
rôles principaux, Tatiana et Onéguine, seront
dansés par Wang Qimin, Etoile, et Li Jun, soliste principal, en
alternance avec deux autres étoiles féminines et deux
autres premiers solistes masculins. Dans l’après-midi du
12 décembre, après une intense journée de
répétition, ces jeunes stars chinoises de la danse ont
accepté d’accorder une interview à Dansomanie. Tous
deux participeront à la tournée du Ballet National de
Chine à Paris, en janvier 2009.
Quels rôles allez-vous danser à Paris?
Li Jun :
Nous allons nous concentrer sur les représentations de Sylvia.
Wang Qimin ne dansera d’ailleurs que ce rôle, en alternance
avec Jun Amanda, qui va peut-être aussi incarner Lao Si, un
personnage de serviteur, dans le Détachement Féminin Rouge.
Venir à l’Opéra Garnier a-t-il en sens particulier pour un danseur / une danseuse chinois(e)?
Wang Qimin - Li Jun : Cela nous cause évidemment du stress et nous met dans un relatif état de tension psychologique.
Pourquoi?
Wang Qimin - Li Jun :
Nous allons nous produire au Palais Garnier, dont la scène est
inclinée. Les danseurs chinois n’ont pas du tout
l’habitude de cela. Nous allons danser un ballet français,
sur une scène dont nous ne maîtrisons pas les
caractéristiques. Cela sera un véritable défi pour
nous. C’est un peu comme si nous étions arrivés au
dernier niveau de difficulté d’un jeu électronique
et qu’il faille le maîtriser coûte que coûte.
Peut-être ne devons-nous pas nous attendre à une
prestation exceptionnelle, mais ce que nous devons faire, c’est
nous adapter du mieux possible à cet environnement nouveau pour
nous, en espérant que nous nous produirons au meilleur de notre
forme.
N’avez-vous pas pu disposer d’un plateau incliné pour répéter à Pékin?
Wang Qimin - Li Jun : Les
scènes inclinées sont très rares aujourd’hui
de par le monde, on ne les trouve que dans quelques
théâtres anciens. En octobre dernier, en guise
d’échauffement avant notre venue à Paris, nous
avons donné plusieurs représentations de Sylvia
à l’Opéra National de Pékin. Peut-être
les avez-vous vues? La scène du nouvel Opéra de
Pékin est modulable, et elle avait été
réglée à la même pente que celle du Palais
Garnier. Le spectacle a tourné au gag, car les danseurs
n’arrivaient pratiquement pas à tenir en équilibre!
Mais nous ne pouvons pas monopoliser la scène de
l’Opéra National pour répéter ; nous partons
pour Paris le 2 janvier 2009, la Première aura lieu le 5, ce qui
nous laissera très peu de temps pour nous habituer à la
scène, et nous allons devoir faire face à un rude
défi. La seule chose que nous pouvons faire, c’est essayer
de nous surpasser, de donner le maximum de nous-mêmes.

Que
représente pour un danseur / une danseuse chinois(e)
l’école de ballet français? Quelles sont les
méthodes en usage en Chine pour l’apprentissage de la
danse classique? Utilise-t-on plutôt la technique russe ou la
technique française?
Wang Qimin - Li Jun : A
l’heure actuelle, le ballet évolue très rapidement,
et on pourrait dire qu’on arrive à une sorte de point de
convergence entre les différentes écoles.
L’école française, emblématique du ballet
romantique, mettait l’accent sur l’élégance
et le raffinement du travail des pieds, tandis qu’en Russie,
c’est l’expressivité du haut du corps et
l’ampleur des mouvements qui sont privilégiées.
Mais à présent, les danseurs russes portent
également une attention croissante au travail des pieds,
à l’instar des Français. Chaque école
recueille les enseignements de l’autre, en assimile les
avantages, et de ce fait on peut dire que la quête de la
perfection technique conduit les différents courants artistiques
à se rejoindre.
Lorsque nous étions élèves à
l’Académie de danse de Pékin, nous avons suivi la
méthode Vaganova. Une fois entrés au Ballet National de
Chine, nous avons dansé de nombreuses œuvres de styles
très différents : russe, français, anglais,
allemand, américain et même cubain. Par ailleurs, la
compagnie invite aussi de nombreux professeurs étrangers, qui
nous font bénéficier de leur enseignement. Il est donc
difficile de dire que nous nous sommes concentrés sur une
école, une technique particulière. Nous avons,
d’une certaine manière, fait nôtre l’essence
de l’école russe et de l’école
française, et c’est peut être l’une des
raisons du développement rapide du ballet en Chine.

Comment s’est
effectuée la transition entre l’école et la
compagnie? Cela s’est il passé
«naturellement», ou cela vous a-t-il coûté des
efforts particuliers?
Wang Qimin - Li Jun : Nous
avons eu beaucoup de chance tous les deux. Alors que nous étions
encore à l’Académie, nous avons déjà
pu danser plusieurs ballets entiers, et nous avons participé
à des concours internationaux. Cela nous a permis
d’acquérir une véritable expérience de la
scène et du spectacle, et lorsque nous sommes entrés au
Ballet National de Chine, nous avons pu nous adapter très vite
à la vie d’un danseur professionnel. La danse fait
maintenant partie de notre quotidien, comme boire ou manger. Mais tous
les danseurs n’ont pas eu les mêmes opportunités, et
certains sont arrivés dans la compagnie sans expérience
pratique, avec pour tout bagage la formation dispensée à
l’Académie ; pour eux, le temps d’adaptation a
été beaucoup plus long.
Y a-t-il
aujourd’hui une véritable «école
chinoise» du ballet classique, un style spécifiquement
chinois?
Wang Qimin - Li Jun : Non,
le ballet s’est développé tardivement en Chine.
C’est un art importé, dont l’intégration
à la culture chinoise en est encore au stade de l’enfance.
Même si nous avons tiré profit des différentes
écoles, et que nous avons pu progresser rapidement, la fusion
des cultures chinoise et occidentale demande du temps. Mais le
fondateur d’une véritable «école
chinoise» n’est sans doute pas encore né.
Mais des tentatives ont lieu : au cours des dernières
années, le Ballet National de Chine a voulu créer son
propre répertoire, avec des œuvres telles que Raise the Red Lantern, ou Le Pavillon des Pivoines.
Le reste relève de cultures étrangères ; il y a un
réel besoin de créer un répertoire chinois
spécifique, mais nous n’en sommes qu’aux
prémices.
Pour Sylvia, avec qui avez-vous travaillé? Comment avez-vous abordé le style romantique français?
Wang Qimin - Li Jun : Au
mois d’octobre 2008, Lionel Delanoë et Laurent Novis sont
venus en Chine pour nous faire répéter ce ballet. Ils
avaient déjà fait le voyage quatre ans auparavant,
lorsque l’ouvrage fut créé à Pékin.
Claude de Vulpian, était également venue, mais elle
n’est restée que peu de temps, une semaine en tout avant
les premières représentations officielles. Nous
n’avons cependant pas été confrontés, lors
des répétitions, à des problèmes techniques
insurmontables. Nous avons fait de notre mieux.
La création de Sylvia
s’intégrait à l’origine dans un programme
d’échanges culturels franco-chinois, qui
s’intitulait «2004-2005, l’année de la France
en Chine».
Avez-vous des contacts avec des danseurs, des professeurs, ou des chorégraphes français?
Wang Qimin - Li Jun : Très
rarement, en raison de la barrière linguistique. Il n’y a
que peu d’opportunités d’échanges, hormis les
contacts officiels entre compagnies. A titre personnel, nous avons eu
quelques contacts avec Luigi Bonino, en raison d’une
tournée où étaient présentés des
ballets de Roland Petit, en Europe et en Asie. C’était en
2006, et nous avons pu prendre le temps de faire connaissance.
Est-ce que le choix de Sylvia,
un ballet, qui, en France, a disparu du répertoire sous sa forme
originelle, revêt pour vous une signification
particulière? Avez-vous le sentiment, avec Sylvia, de
«restituer» au public français une partie de son
propre patrimoine culturel?
Wang Qimin - Li Jun : Comme dit, pour nous, avec Sylvia,
il s’agit simplement d’un programme officiel
d’échanges culturels. Nous n’avons pas
d’autres ambitions.
Comment le public chinois a-t-il accueilli Sylvia?
Wang Qimin - Li Jun : C’est aux spectateurs de répondre à cette question!
Li Jun : Lors des
représentations à l’Opéra National, en
octobre, j’étais moi même un soir dans la salle, et
j’ai remarqué que les spectateurs chinois
appréciaient les ouvrages dramatiques, avec une intrigue. De ce
fait, l’ouvrage a été accepté, même si
le public chinois – qui je le crois, adore le ballet – en a
sa propre compréhension.
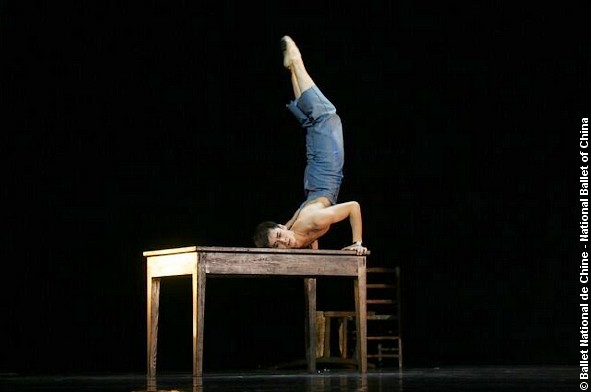
Au
cours des dernières années, le Ballet National de Chine a
souvent collaboré avec Roland Petit, et vous-mêmes avez, en
tant qu’artistes invités, participé à une
tournée au cours de laquelle ses œuvres ont
été présentées en Asie et en Europe.
Comment, au travers de votre expérience,
caractériseriez-vous les différences entre un ouvrage de
Roland Petit et un ballet romantique français traditionnel, tel
que Sylvia?
Li Jun : Les
œuvres de Roland Petit sont d’une grande limpidité,
et elles explorent toujours de nouveaux modes d’expression de
l’amour. Elles ont, dans un cadre avant-gardiste et audacieux,
atteint une ampleur et une profondeur significatives. Ayant
dansé le Jeune homme et la Mort,
j’ai été très surpris d’apprendre
qu’il avait été créé en 1946. Il
était si en avance sur son temps ; en comparaison, ce
qu’on nous donnait à voir en Chine avait plusieurs
décennies de retard. Même maintenant, nous ne produisons
pas nous-mêmes ce genre de chorégraphies contemporaines.
J’aime danser les œuvres de Roland Petit, mais parfois,
elles m’effraient.

Le Détachement féminin rouge
est un des ballets emblématiques du répertoire chinois.
Pensez-vous qu’il puisse être compris sans trop de
difficultés par le public français? De manière
plus générale, le Détachement féminin rouge
peut-il être compris par des personnes qui n’ont
qu’une connaissance limitée de l’histoire et de la
culture chinoises?
Wang Qimin - Li Jun : Elles
le comprendront. La trame de ce ballet rappelle beaucoup
l’histoire de la Révolution française. Elle parle
de soulèvement démocratique, de liberté,
d’égalité et d’émancipation des femmes.
Tout comme les Flammes de Paris?
Wang Qimin - Li Jun : Exactement. Si le public comprend les Flammes de Paris, il comprendra le Détachement féminin rouge.
Et si vraiment il n’y parvenait pas, il pourra toujours
apprécier les performances intrinsèques des danseurs!

Pensez-vous que les ouvrages spécifiquement chinois, comme le Détachement féminin rouge,
puissent un jour, à l’instar des grandes œuvres du
répertoire français ou russe,
s’«internationaliser» et être dansés par
des compagnies étrangères, notamment occidentales?
En ce qui concerne le Détachement féminin rouge, non.
C’est une œuvre trop ancrée dans la culture
chinoise.
Mais le ballet
classique [occidental], un art «importé», a
réussi à s’implanter en Chine. Pourquoi,
inversement, le Détachement féminin rouge
ne pourrait-il pas s’internationaliser? Et d’ailleurs, la
troupe japonaise du Matsuyama Ballet l’a déjà
représenté…
C’est un cas très particulier. Le Matsuyama Ballet est une
compagnie privée, qui entretient de très bonnes relations
avec le Ballet National de Chine. Et les ex-étoiles du
Matsuyama, Morishita Yoko et Shimizu sont venus tout
spécialement travailler cet ouvrage avec le Ballet National de
Chine.
Wang Qimin & Li Jun
Entretien
réalisé le 12 décembre 2008 - Wang Quimin - Li Jun © 2008,
Enya Chen - Dansomanie
|
|
|



















