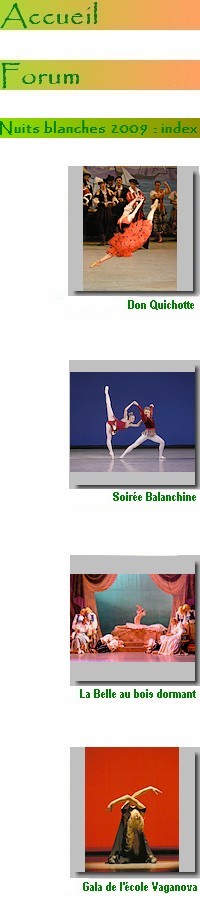 |




|
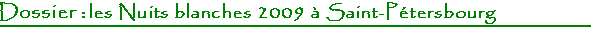
 |
|
|
15 juin
2009 : Soirée
Balanchine
Irina
Golub et Alexandre Sergueïev dans Rubis
En prélude
à une tournée londonienne dont le
programme doit comporter un important hommage à Balanchine,
le Théâtre
Mariinsky met à l’affiche, à
l’occasion du Festival des Nuits Blanches,
une soirée entièrement
dédiée au chorégraphe et
composée d’oeuvres
variées, deux jours après avoir offert au public
l’intégralité de Joyaux.
On connaît du reste l’attachement de la compagnie
– et son talent à
l’interpréter -, depuis plus d’une
décennie, au répertoire de ce
chorégraphe, certes associé à la danse
américaine, mais né à
Saint-Pétersbourg et formé à
l’Ecole du Ballet Impérial. Le directeur
actuel, Yuri Fateev, en est de surcroît l’un des
répétiteurs
privilégiés au sein de la troupe et a notamment
permis, très récemment,
le retour au répertoire du pas de deux de Tarantella et surtout de
l’immense Thème
et Variations,
premier ballet de Balanchine remonté au Mariinsky, en 1989.
Le
répertoire balanchinien, introduit progressivement durant
les années 90
et au début des années 2000, a
contribué sans aucun doute, même s’il
reste cantonné à quelques œuvres
emblématiques, à transformer le style
et l’image de la compagnie et à lui imprimer
aujourd’hui une marque
distinctive éloignée à bien des
égards de celle du mythique Kirov.
Le riche
programme à l’affiche de ce 15 juin comprend des
chorégraphies
appartenant à différentes périodes
– en même temps qu’à
différentes
veines - de la création balanchinienne. Le ballet narratif,
présent au
travers du Fils
prodigue
(1929), y côtoie ainsi les pas de deux virtuoses les plus
fameux - de l’inusable Tchaïkovsky
Pas de deux
(1960) à Tarantella (1964) en passant par le
bouillant duo de Rubis (1967) -, sans oublier la
pièce symphonique brillante pour solistes et grand ensemble,
Symphonie
en ut
(1947), chargée de conclure naturellement la
soirée en beauté.
Le
Fils prodigue
ouvre
toutefois la soirée sans grande passion. Cette
œuvre de jeunesse de
Balanchine, encore associée à la
période des Ballets russes et à
laquelle collaborèrent notamment Boris Kochno en tant que
librettiste
et le peintre Georges Rouault pour l’élaboration
des décors et des
costumes, peine d’autant plus à retenir
l’attention, a fortiori à
séduire, que les danseurs semblent, de manière
somme toute palpable,
assez peu concernés par le ballet. Andreï Batalov,
soliste rare, ancien
lauréat de concours prestigieux durant les années
90 (il fut en
particulier l’un des rares danseurs à
être récompensé du Grand Prix au
Concours de Moscou), incarne ici le rôle du Fils prodigue. Si
sa danse
possède toute la virtuosité et la puissance
souhaitées, son jeu reste
passablement monolithique et surtout dépourvu de la charge
émotionnelle
que porte le personnage du Fils, inspiré de la parabole
évangélique. A
ses côtés, Daria Pavlenko, danseuse que l'on
qualifierait plutôt de
romantique, mal distribuée depuis son retour sur
scène en janvier
dernier, le plus souvent cantonnée à des
rôles incongrus pour son
statut d’étoile (la Danseuse des rues dans Don
Quichotte,
ou encore quelque ballet de Forsythe auquel le public local reste dans
l’ensemble indifférent), y campe le rôle
de la Sirène, mais est loin de
posséder l’érotisme glacial et
souverain qui sied au rôle et rend
l’interprétation de feu et de glace
mêlés d’une Ekaterina Kondaurova -
vue à Paris associée à
l’excellent Mikhaïl Lobukhin - si saisissante,
pour ne pas dire incontournable. Le corps de ballet, qui figure
notamment les compagnons d’infortune du Fils, semble de son
côté, à
l’instar des solistes, assumer professionnellement la
représentation,
mais de manière lointaine et sans toujours se soucier de la
coordination d’ensemble. Seul Vladimir Ponomarev,
Père qu’on croirait
tout droit sorti de quelque palimpseste biblique, parvient à
impressionner par sa stature scénique, sa justesse de ton et
son
autorité dramatique. Dans la compagnie depuis 1964, Vladimir
Ponomarev
est un danseur de caractère au statut quasi-mythique,
abonné en
priorité aux grands rôles de pantomime
qu’offrent les ballets de Petipa
: Roi, Duc, Prince, Brahmane et autres Don Quichotte... Lorsque le
rideau tombe, les artistes reçoivent de la part du public
des
applaudissements polis, quelques rappels de convention, mais
l’enthousiasme attend toujours de pointer le bout de son
nez….

Viktoria
Tereshkina et Leonid Sarafanov dans Tchaïkovsky Pas de deux
Les
choses sérieuses débutent après
l’entracte avec une série de
pas de deux virtuoses destinés à mettre en valeur
les qualités des
étoiles et des solistes en devenir de la compagnie. De
manière
significative, la loge réservée tacitement aux
maîtres de ballet et aux
danseurs se remplit soudainement, comme pour signifier que le spectacle
est à présent digne d’un
intérêt soutenu. Et quel spectacle en effet !
Viktoria Tereshkina et Leonid Sarafanov réveillent une
assemblée en
voie d’assoupissement par une prestation qu’on
aimerait qualifier
d’anthologie, si l’on ne craignait de sombrer dans
le cliché. D’aussi
loin qu’on s’en souvienne, on n’a jamais
eu l’occasion de voir, ni de
près ni de loin, un Tchaïkovsky
Pas de deux
– classique parmi les classiques de tous les galas -
exécuté avec autant de virtuosité, de
brio, de
raffinement et d’esprit
conjugués.

Viktoria
Tereshkina dans Tchaïkovsky
Pas de deux
Viktoria Tereshkina est l’image même de la
perfection
technique mise au service du style, de
l’élégance et de la
séduction.
Virtuosité des sauts, beauté des attitudes et des
arabesques, moelleux
des développés, perfection des
équilibres, brio des pirouettes,
précision et vélocité du travail de
bas de jambe, élégance des ports de
bras et des ports de tête, qui savent se faire
séducteurs avec esprit,
tout en elle respire l’intelligence de la danse, le
contrôle absolu du
mouvement, fondu dans une musicalité savante et une
maîtrise de cet art
des ralentis et des accélérés rendu si
nécessaire dans ce pas. Rien ne
souffre ici la moindre poussière, la moindre scorie. Chez
elle, tout –
à commencer par le visage, au regard exotique et
à la chevelure de
jais, et ce sourire indicible, épanoui, discret - brille de
mille feux,
sans qu’une faute de goût ou un quelconque effet
clinquant ne vienne
entacher le geste, le mouvement, la pose. Leonid Sarafanov,
d’une
virtuosité éblouissante, sait du reste
tempérer ce goût du
spectaculaire qui est comme sa marque de fabrique, pour mettre en
valeur sa partenaire, ballerine au firmament des étoiles de
la danse.
La réaction d'un public exigeant, qui reste parfois sur la
retenue mais
acclame ici le couple avec enthousiasme, est à cet
égard éloquente...
On se dit alors que si Alina Somova - vue en d’autres lieux
dans ce
même pas de deux - est comme le joli brouillon, maladroit,
superficiel
et irritant, du Mariinsky des temps modernes, propre à
satisfaire
pleinement un public décivilisé, Viktoria
Tereshkina en est pour sa
part comme le chef d’oeuvre ultime et inimitable, celui qui
vient
malgré tout confirmer la gloire sans cesse
renouvelée d’une compagnie
légendaire.

Irina
Golub et Alexandre Sergueïev dans Rubis
Avec le pas de deux de Rubis,
on redescend brutalement de quelques étages…
Après une telle
prestation, et quels que soient les mérites des danseurs, il
paraît en
effet difficile de s’imposer, de surcroît
s’agissant, comme c’est le
cas ici, d’un duo extrait d’un ballet fonctionnant
d’ordinaire comme un
tout. Irina Golub possède pourtant le glamour – en
même temps que les
lignes - qui se prête idéalement à ce
morceau inspiré du style de
Broadway et conçu comme un hommage à la danse
américaine. Sa
prestation, très technique, très
concentrée, souffre pourtant d’un
manque de fluidité qui finit par apparaître
déplacé, sinon caricatural,
en termes de style. Trop de sérieux ou trop
d’agressivité, tout semble
comme excessif dans cette exhibition virtuose : il manque ici le
relâchement, la distance et l’humour dont savent
faire preuve une
Tereshkina ou une Vishneva dans la façon qu’elles
ont d’appréhender
Balanchine. Son partenaire, Alexandre Sergueïev, brillant
danseur promis,
semble-t-il, à un bel avenir, a quant à lui la
séduction plus détendue
et n’est pas loin de l’éclipser.
L’échange ludique, teinté de
libertinage, qui constitue le duo disparaît pour laisser
place à un
schéma plus traditionnel et ennuyeux où
l’on tend à ne plus percevoir
que le côté "chirurgical" de la
chorégraphie.

Elisaveta
Cheprasova dans Tarantella
Tarantella, pastiche, sinon
parodie, du style bournonvillien, arrive ensuite avec sa
chorégraphie
impossible et son costume ridicule qui enlaidirait n’importe
quelle
beauté. Elisaveta Cheprasova en est une, mais n’a
pas de ces complexes
: elle joue le jeu avec aplomb et
générosité, et un sens de
l’humour
qui ne gâte rien, bien accompagnée par Filipp Stepin, coryphée lui
aussi, qui fait ses débuts dans ce morceau de bravoure. Le
jeune homme
est doué d’un beau ballon et d’un vrai
brio, à la Ratmansky, la jeune
fille possède une énergie et un dynamisme
réjouissants, et si le pas de
deux perd en précision et en propreté dans la
coda, et notamment dans
l'interminable série de pirouettes finales, on saluera
néanmoins la
réussite scénique réalisée
par ces deux talents prometteurs, à qui il
reste de mûrir et d’affiner une technique
déjà très solide.
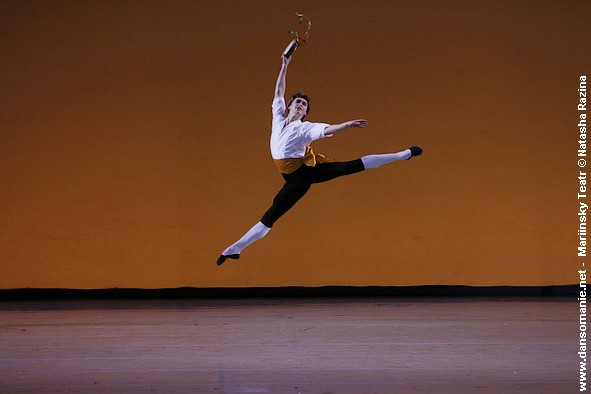
Filipp
Stepin dans Tarantella
Symphonie
en Ut,
clou du
spectacle, achève enfin la soirée comme une
apothéose visuelle,
musicale et plastique - il faut bien l’avouer –
inoubliable,
essentielle. Le ballet de Balanchine, inspiré du style
impérial dans
lequel le chorégraphe avait lui-même
été formé, semble alors, par ses
fascinants ensembles géométriques et ses volutes
hypnotiques, avoir été
écrit pour se déployer dans
l’écrin majestueux du Théâtre
Mariinsky,
interprété par ce corps de ballet d'une
beauté unique qui s'y révèle
magistral. Il est par ailleurs sublimé par les tutus
étincelants,
conçus spécifiquement pour la troupe par Irina
Press, lesquels
rappellent, dans leur camaïeu de blanc, de beige, de vert et
de bleu,
les couleurs du théâtre. Dans le premier
mouvement, Alina Somova forme
néanmoins un couple insolite avec Denis Matvienko, qui a
récemment
rejoint le Mariinsky en qualité de danseur principal. Ce
dernier est
sans doute un merveilleux danseur dans un certain
répertoire, mais,
très crispé dans le haut du corps, il reste,
malgré la virtuosité
formelle de sa danse, comme étranger au style de ce morceau
balanchinien qu’il aborde ici pour la première
fois. Il est vrai qu'il
aurait pu rêver d'une partenaire - sa propre femme Anastasia,
par
exemple, qui faisait ses débuts quelques jours auparavant
dans ce
premier mouvement aux côtés d'Alexandre
Sergueïev - lui rendant la tâche
plus aisée ! Indifférente à autre
chose qu'elle-même, plus glamour que
jamais, celle-ci nous assène son style clinquant habituel,
malgré un
louable effort – bref, hélas ! - de
sobriété, auquel on pourrait
éventuellement adhérer avec indulgence si elle
faisait au moins montre
d’une technique un peu plus contrôlée,
ou un peu moins négligée - au
profit du sourire - dans le travail du bas de jambe. Finalement, cette
étrange paire, très sobrement applaudie, ne fait
que mettre en valeur
la belle harmonie et le raffinement délicat du corps de
ballet, ainsi
que des demi-solistes, Maria Shirinkina et Yana Selina, qui
s’affirment
à leurs côtés comme d'impeccables
modèles de style et
d’élégance.
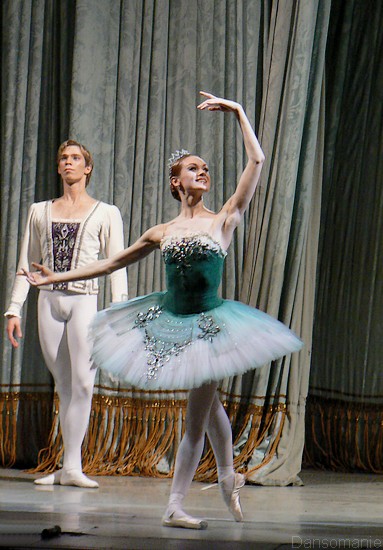
Kirill Safin et Uliana Lopatkina dans Symphonie en Ut
L’adage, interprété par Uliana
Lopatkina et Danila Korsuntsev, succède
au mouvement allegro, et prend soudain des airs de "choc des cultures"
- de choc visuel et spirituel tout simplement. Etait-on, il y a encore
quelques minutes, dans le même théâtre ?
Le corps de ballet se dissout
pour l’œil à présent, ne
laissant place qu’à Uliana, objet de tous les
regards, écrivant dans l'espace ses arabesques - "sans rien
en elle qui
pèse ou qui pose" -, admirablement soutenue par Danila, le
partenaire
attentif d’une vie, dans cet adage où,
à l’instar de celui de Diamants,
s’expriment à merveille sa sensibilité
artistique et musicale ainsi que
son sens du legato unique. Que peut-on, somme toute, encore dire sur
cette danseuse, faite de manière consubstantielle pour
danser l'adage,
qui semble user tous les qualificatifs, et dont la prestation est
acclamée religieusement par un public sachant
reconnaître en elle sa ballerine et sa
reine, à l’autorité
incontestée ? Le couple formé ensuite de
Ekaterina
Osmolkina et du bondissant Leonid Sarafanov ne paraît
guère en phase
musicalement, malgré les qualités individuelles
de l'un et de l'autre,
mais il semble a posteriori bien délicat de porter un
jugement sur ce
troisième mouvement au cours duquel la danseuse, au sourire
soudain
figé, s’est probablement blessée, comme
en témoigne son absence, ainsi
que celle de son partenaire, aux saluts. C’est à
Nadezhda Gonchar et
Kirill Safin qu’est dévolu l’ultime
mouvement, solidement et
impeccablement dansé par un couple à
l’unisson, qui a de surcroît le
mérite de nous ramener, après quelques
incongruités, à une certaine
humanité de la danse. Plus qu’une
célébration des seules solistes, la
coda finale de Symphonie
en Ut
est une ode adressée au corps de ballet, à un
corps de
ballet qui, à ce moment précis, sait encore se
montrer
étourdissant.
B. Jarrasse ©
2009,
Dansomanie
Soirée Balanchine
Direction
musicale : Boris Gruzin
Le Fils prodigue
Ballet en trois
scènes
Musique : Sergueï
Prokofiev (Op. 46, 1928-29, commande de
Sergueï Diaghilev)
Livret
: Boris Kochno (d’après la parabole
biblique)
Chorégraphie
: George Balanchine
Le
Fils prodigue –
Andreï Batalov
Le Père –
Vladimir Ponomarev
La Sirène –
Daria Pavlenko
Les Sœurs –
Anastasia Vasilets / Olga Balinskaya
Les Confidents du Fils
prodigue –
Maxim Khrebtov / Anton Pimonov
Tchaïkovsky Pas de deux
Musique : Piotr
Tchaïkovsky
Chorégraphie :
George Balanchine
Viktoria
Tereshkina, Leonid Sarafanov
Pas de
deux du ballet Rubis
(2ème volet de Joyaux)
Musique : Igor Stravinsky
Chorégraphie :
George Balanchine
Irina Golub, Alexandre
Sergueïev
Tarantella
Musique : Louis Moreau
Gottschalk
Chorégraphie :
George Balanchine
Elizaveta Cheprasova
– Filipp Stepin (début)
Symphonie en ut
Ballet en quatre mouvements
Musique : George Bizet
(Symphonie n°1 en ut)
Chorégraphie :
George Balanchine
Chorégraphie remontée par Colleen Neary
Costumes : Irina Press
Création :
Théâtre de
l’Opéra, Paris, 1947
Entrée au
répertoire du
Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg
: 9 février 1996
1-
Allegro vivo
Alina Somova –
Denis Matvienko (début)
Maria Shirinkina –
Yana Selina
Maxim Khrebtov –
Fiodor Murashov
Artistes du Ballet du
Théâtre Mariinsky
2-
Adagio
Uliana Lopatkina –
Danila Korsuntsev
Daria Pavlova –
Anna Lavrinenko
Islom Baimuradov –
Dmitry Pikhachov
Artistes du Ballet du
Théâtre Mariinsky
3-
Allegro vivace
Ekaterina Osmolkina
– Leonid Sarafanov
Xenia Dubrovina –
Elena Androsova
Anton Pimonov –
Alexeï Nedviga
Artistes du Ballet du
Théâtre Mariinsky
4-
Allegro vivace
Nadezhda Gonchar –
Kirill Safin (début)
Daria Vasnetsova –
Anastasia Petushkova
Karen Ioannissian –
Denis Firsov
Artistes du Ballet du
Théâtre Mariinsky


|
|
|



















