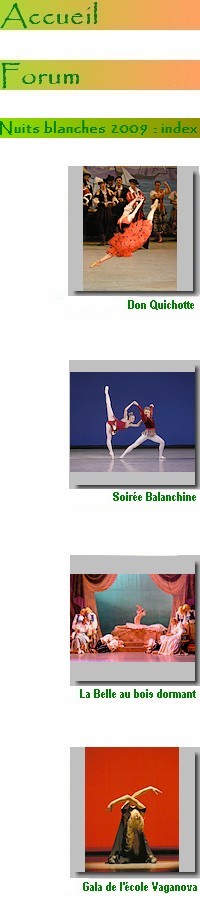 |




|
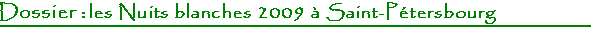
 |
|
|
18 juin
2009 : La
Belle au bois dormant
Denis
Matvienko (Désiré) et Anastasia Matvienko (Aurore)
A l’approche de la
fête des Voiles Rouges qui
célèbre pour les habitants de
Saint-Pétersbourg la fin de l’année
scolaire, sur fond de nuit (très) blanche et
arrosée, La Belle
au bois dormant
fait son retour dans sa maison natale, au Théâtre
Mariinsky, après
quatre mois d’absence à l’affiche. En
dépit de quelques hésitations de
programmation, c’est finalement la version
révisée par Konstantin Sergueïev en 1952, qui
bénéficie des faveurs du directeur de la troupe,
Yuri Fateev, ainsi que du public local, qui a été
une nouvelle fois
préférée à celle
reconstruite récemment par Sergueï Vikharev,
d’après
l’œuvre originale de Petipa,
créée en 1890.
Pour
cette soirée unique - en raison du rigoureux
système de
programmation par alternance - et de près de 4h, la salle,
assaillie
jusqu’au dernier strapontin de fond de loge, affiche complet,
remplie
par un public incroyablement jeune et familial, comme à
l’occasion des
représentations du - déjà
très populaire - Petit
Cheval bossu,
deux fois à l’affiche durant la même
période. Il n’y a rien à faire,
les ballets narratifs enthousiasment toujours plus les spectateurs
russes que le meilleur de Balanchine…

Anastasia
Matvienko (Aurore)
Si la reconstruction de La Belle
au bois dormant
par Sergueï Vikharev constitue une spectaculaire, fascinante
et
mélancolique tentative pour retrouver une trace du faste du
ballet
impérial - un vrai fantasme d’historien et de
balletomane -, la version
de Konstantin Sergueïev, d’une plus grande
sobriété scénographique, avec
ses toiles peintes en trompe l’œil et ses tutus
monochromes, ne déçoit
pourtant nullement le spectateur exigeant et avide de "grandeur". La
noblesse de l’œuvre y est
préservée, son caractère de conte de
fées y
est pleinement rendu, avec poésie, sans sophistication
superfétatoire
ni effet clinquant, laissant toute sa place à la
beauté de la danse et
à l’exposition de
l’esthétique d’apparat qui lui est
attachée. En
outre, le ballet, d’une grande lisibilité,
s’offre au regard avec une
sorte d’évidence sereine dans cet écrin
naturel qu’est pour lui le
Théâtre Mariinsky. Le voir se déployer
dans ce cadre étincelant et sur
cette scène monumentale et légendaire
où il est né est en soi
déjà une
récompense.
 Le défilé des Fées, dans le Prologue Le défilé des Fées, dans le Prologue

Denis
Matvienko (Désiré) et Anastasia Matvienko (Aurore)
Mais
trêve de politique théâtrale, revenons
à notre Belle…
On aurait pu rêver sans doute, en explorateurs avides de
"pittoresque",
d’un couple plus authentiquement estampillé
"Kirov-Mariinsky" que les
Matvienko, venus de Kiev et devenus depuis quelques années
des
danseurs
à l’aura internationale. Trop
peut-être… A
première vue cependant,
Anastasia, moins connue en Occident que son
célèbre
époux, ne se
distingue pas vraiment, ni par son physique ni par son style, des
danseuses actuelles du Mariinsky. Elle possède en outre les
lignes les
plus parfaites qu’on puisse imaginer, un pied de
rêve, une
grâce
délicate, relevée par un visage aussi glamour et
exotique
que celui de
"la" Vichneva… à un détail
près : ce
n’est pas "la" Vichneva... Sur un
plan technique, sa danse, bien que d’un raffinement
sensiblement
moins
évident que celle déployée par les
solistes
attachées historiquement au
Ballet du Mariinsky, se révèle la plupart du
temps
irréprochable,
entachée de nulle faute de goût
déplaisante, de
nulle minauderie
déplacée. L’entrée
s’avère
d’emblée séduisante : le visage est
épanoui,
rayonnant, les sauts pétillants comme la jeunesse
conquérante d’Aurore.
L’Adage à la Rose est pour sa part
enlevé avec
sérénité et un relatif
brio, avec des équilibres et des pirouettes impeccables.
Seule
la
variation de la Vision, à l’acte II, la voit
ensuite un
peu plus tendue
dans les équilibres de l’adage et les ports de
bras, qui
auraient
mérité davantage de moelleux dans
l’expression,
mais elle est
admirablement soutenue par l’impeccable partenaire
qu’est
à ses côtés
Denis Matvienko, et, au-delà, par un corps de ballet
d’une
beauté
presque irréelle. Le Grand pas, sans
s’élever
à des hauteurs inédites,
est exécuté enfin avec aisance et noblesse.
Néanmoins, au-delà de la
beauté formelle et du professionnalisme
indéniable de
l’exécution,
consciencieuse à l’extrême et
manifestement
très encadrée, on est
rapidement gêné par un certain nombre de manques
sur le
plan
dramatique, ou tout du moins par le monolithisme d’une
interprétation
qui ne semble guère évoluer ni se nuancer au fil
des
actes.

Anastasia
Matvienko (Aurore)
Son
Aurore
est juvénile et charmante, mais elle n’est que
juvénile et charmante.
Le rôle de la princesse de conte de fées est sans
doute
peu investi
psychologiquement parlant – il s’agit là
d’un
archétype -, mais, dans
le cadre aristocratique et grandiose de ce ballet, il est pourtant le
moment privilégié où peut -
où doit - se
révéler une sorte d’idéal ou
d’essence de la ballerine classique. C’est
là, au
travers de
l’exposition de ce non-personnage qu’est Aurore et
des
qualités que lui
prête l’imaginaire, que le spectateur attend de
voir
briller la
personnalité de celle qui a été
choisie pour
l’incarner, à la fois
séduisante et unique. En cela, il est peut-être
l’un
des rôles les plus
difficiles du répertoire, car il n’est au fond que
"paraître", mais un
"paraître" qu’il faut parvenir à faire
vivre et
exister durant trois
longs actes. Or, jamais on ne perçoit ici
véritablement
ce quelque
chose d’unique et d’irremplaçable
qu’ont
chacune à leur manière - qu’on
les apprécie ou non d’ailleurs –, dans
la
personnalité scénique
qu’elles exposent et les trésors de
créativité qu’elles
possèdent, des
solistes abonnées au rôle, telles que Viktoria
Tereshkina,
Olesia
Novikova, Evgenia Obraztsova ou Ekaterina Osmolkina - voire Alina
Somova, quoi qu’on puisse en dire.

Anastasia
Matvienko (Aurore)
et Denis
Matvienko (Désiré)
Aux
côtés
d’Anastasia, Denis
Matvienko, qui n’apparaît qu’à
partir du
second acte, à l’occasion de
la scène de la Chasse, s’affirme comme un Prince
des plus
convaincants
tant par son allure que par son engagement. Les soli de
l’acte II
et de
l’acte III lui sont une occasion particulière de
briller,
avec sobriété
et style toutefois, et de montrer son fabuleux sens de
l’accélération
dans les manèges, ainsi que la virtuosité de ses
tours.
Il déploie par
ailleurs des qualités remarquables de partenariat, au
service de
sa
Belle – la situation le laisse aisément comprendre
–
dans la Vision
comme dans le Grand pas. Le Prince Désiré, bien
que peu
mis en valeur
par la chorégraphie de Sergueïev, est loin de se
réduire
ici à un simple
rôle de faire-valoir décoratif. Denis Matvienko
sait lui
imprimer
diverses facettes : rêveur et distrait durant la
scène de
la Chasse, où
on le trouve comme en proie à la mélancolie, il
succombe
au trouble et
à la fascination durant la scène de la Vision,
pour
s’imposer avec une
autorité toute princière dans l’ultime
pas de deux.
Denis
Matvienko (Désiré) et Anastasia Matvienko (Aurore)
Le ballet
donne toutefois bien d’autres aliments à la vue et
à
l’entendement que ses deux solistes principaux, qui
n’apparaissent l’un
et l’autre que relativement tardivement au cours de
l’intrigue. Le
prologue sur lequel s’ouvre le spectacle est notamment
l’occasion, au
travers du défilé des Fées
auprès du berceau d’Aurore, d’admirer
les
qualités des solistes ou demi-solistes, plus ou moins
expérimentées, de
la compagnie. Parmi elles, on remarque plus
particulièrement, dans deux
registres opposés, la Fée Violente de Nadezhda
Gonchar, incisive et
tranchante comme une lame, et la Fée Canari de Valeria
Martiniuk,
délicieuse et chantante – la joie de vivre et de
danser incarnée. En
Fée Candide, vêtue d’un tutu blanc
immaculé qui lui sied à ravir, la
délicate Maria Shirinkina parvient de son
côté à conjuguer la
précision
technique et musicale et une douceur, un moelleux même,
qu’on pourrait
croire parfois perdus. La dimension à la fois virtuose et
incarnée de
la chorégraphie, au service de l’histoire, nous
semble ici
particulièrement appréciable. Les
interprètes ne sont pas uniquement
chargées d’exécuter des pas complexes,
sous la forme d’un exercice
d’école, mais aussi de figurer par un
tempérament particulier les
différents dons offerts à Aurore par les
Fées - variables d’une version
à l’autre – et
suggérés par la chorégraphie.

Lilia
Lishchuk (la Fée des Lilas)
L'interprétation de la Fée
des Lilas est confiée à Lilia Lishchuk,
récemment diplômée de
l’Académie Vaganova et dans la compagnie depuis
seulement cette saison,
qui fait ses débuts dans son premier rôle
d'envergure, choisie
manifestement pour sa silhouette longue et
élancée. Si elle
n’impressionne pas au même titre que Yulia
Stepanova, vue dans le même
rôle lors du spectacle de fin d’études
de l’Académie Vaganova,
laquelle, à peine plus jeune, est dotée
d’une technique qui semble déjà
éprouvée par des années de
scène, elle séduit toutefois par une douceur
et une sérénité toute aristocratiques
qui lui vaudront au demeurant un
beau succès lors des saluts. En contrepoint de cette figure
féerique,
incarnation des vertus traditionnelles attribuées au pouvoir
royal,
plutôt que bonne fée, au sens
étroitement moral et sentimental, le
personnage de la Fée Carabosse,
interprétée ici par un homme, tranche
parallèlement avec la vision manichéenne et
caricaturale qu’en donnent
le plus souvent les versions occidentales. Loin
d’être réduite au rôle
de la méchante fée à la Disney,
affublée de toutes les laideurs
physiques et morales, symbolisées par une cour de rats
répugnants, elle
apparaît comme un être à
l’inquiétante étrangeté,
campé avec une
ambiguïté remarquable par Roman Skripkin.
L’interprète est d’autant
plus saisissant que son allure noble et sa morgue de puissant ne
l’opposent pas fondamentalement aux personnages apolliniens
de la cour,
dont il pourrait au fond figurer la face obscure.

Denis
Matvienko (Désiré)
A la suite du moment magique
que constitue l’intermède musical,
interprété rideau fermé par le violon
d'orchestre devenu centre de tous
les regards, et en prélude au Grand pas de deux et
à l’apothéose
finale, le dernier acte présente à son tour, en
écho au défilé des Fées
du prologue, la parade attendue des personnages de contes,
conçue comme
un divertissement offert à Aurore et
Désiré, plaçant les noces sous le
signe de la féerie. Le Pas de quatre des Fées
Diamant, Saphir, Or et
Argent y brille d’entrée par sa parfaite
coordination d’ensemble et son
extraordinaire musicalité. Si Anastasia Petushkova peine
quelque peu
dans la variation solo de la Fée Diamant à donner
le change à la
vivacité éblouissante de Ekaterina Osmolkina,
prévue initialement
(laquelle, distribuée dans la même semaine dans
les rôles principaux du Réveil
de Flore
et de Don
Quichotte,
puis dans le troisième mouvement de Symphonie
en ut,
tout en préparant le rôle-titre de Shurale,
a fini par déclarer forfait…), le trio
secondaire, formé de Yulia
Kasenkova (Saphir), Anna Lavrinenko (Or) et Maria Shirinkina (Argent)
mérite pour le coup toutes les louanges. En revanche, le Pas
de deux de
l’Oiseau bleu et de la Princesse Florine, est une relative
déception, à
la hauteur de l’incongruité du couple qui
l’interprète : le jeune
Kirill Safin, qui fait là ses débuts, et
qu’on a vu excellent dans un
autre répertoire, paraît malheureusement bien trop
grand, en même temps
que trop tendu pour la circonstance, pour briller pleinement, et avec
une certaine poésie, dans les sauts et la batterie virtuose
qui
composent la chorégraphie ; quant à Anastasia
Kolegova, qui accumule
ici les effets superflus et clinquants, sa danse, à la
technique
pourtant très précise, est
dénuée de la douceur et du naturel gracieux
qui conviennent au rôle de la Princesse Florine.
Modèles de style,
d’élégance et
d’interprétation se montrent à
l’inverse Yana Selina,
Chatte blanche spirituelle, au raffinement et à la
drôlerie
irrésistibles, et Elena Yushkovskaya, délicieux
Petit Chaperon Rouge à
la grâce mutine.
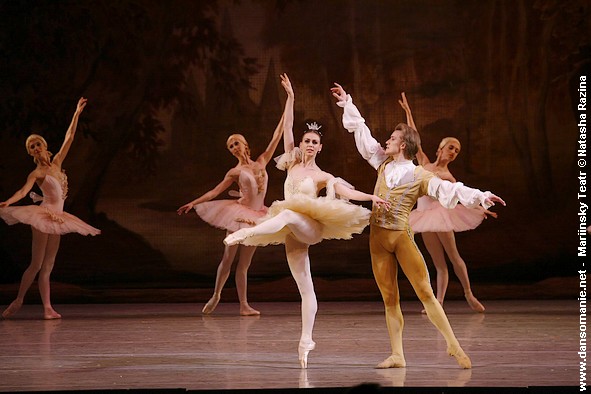
Anastasia
Matvienko (Aurore)
et Denis
Matvienko (Désiré)
Ce qu’on retiendra
enfin de cette Belle,
qui demeure, inaltérable, bien au-delà des
solistes qu’un spectacle
peut convoquer - qui demain changeront -, c’est un corps de
ballet qui
se révèle à cette occasion proprement
éblouissant, miraculeux comme au
premier jour, beau comme un rêve de Pierre en un soir de nuit
blanche.
Les fascinantes architectures conçues par Petipa, tout
à la fois
réelles et irréelles, à
l’image de la ville étrange où il
choisit de
créer, se déploient de manière
hypnotique dans la Valse des Fleurs, à
laquelle se mêlent traditionnellement les jeunes
élèves de l’Académie
Vaganova, comme dans le Tableau de la Vision, tous deux
sublimés par de
subtils coloris aux résonances symboliques. Les volutes
formées par les
ensembles, déployées sur
l’immensité de la scène du Mariinsky,
s’ouvrent et se referment, se plient et se
déplient alors comme un
mirage, dans une harmonie musicale inégalée, sans
doute incomparable.
Un don à nul autre
pareil.
B. Jarrasse ©
2009,
Dansomanie
La Belle au bois dormant
Ballet
féerie en trois actes (cinq scènes) avec
un prologue et une apothéose
Musique : Piotr Tchaïkovsky
Livret : Ivan Vsevolozhsky, Marius Petipa,
d’après
les contes de Charles Perrault
Chorégraphie : Marius Petipa
(révision :
Konstantin Sergueïev)
Direction
musicale : Boris Gruzin
Le Roi –
Vladimir Ponomarev
La Reine –
Elena Bazhenova
La Princesse Aurore –
Anastasia Matvienko (début)
Le Prince
Désiré –
Denis Matvienko
(début)
Les Quatre Prétendants
d’Aurore –
Denis Firsov, Andreï Ermakov, Dmitry Pikhachov, Alexandre Sergueïev
La Fée des Lilas –
Lilia Lishchuk (début)
La Fée Tendresse –
Maria Shirinkina
La Fée
Espièglerie –
Yulia Kasenkova
La Fée
Générosité –
Elena
Yushkovskaya
La Fée Audace –
Nadezhda Gonchar
La Fée Canari –
Valeria Martiniuk
La Fée Diamant –
Anastasia Petushkova
La Fée Saphir –
Yulia Kasenkova
La Fée Or –
Anna Lavrinenko
La Fée Argent –
Maria Shirinkina
La Fée Carabosse –
Roman Skripkin
Catalabutte –
Andreï Yacovlev (1er)
Galifron –
Andreï Yacovlev (1er)
Un Serviteur –
Anatoly Marchenko
La Princesse Florine –
Anastasia Kolegova
L’Oiseau bleu –
Kirill Safin (début)
La Chatte blanche –
Yana Selina
Le Chat botté –
Fiodor Murashov
Le Petit Chaperon rouge –
Elena Yushkovskaya
Le Loup –
Anatoly Marchenko
Une Servante –
Polina Rassadina
Un Chasseur –
Grigory Popov


|
|
|



















