 |




|

 |
|
|
14 - 15
août
2009 : La
Belle au bois dormant
Evguenia
Obrazstova (Aurore)
Il y a près de dix
ans, le Mariinsky présentait en ouverture d’une
prestigieuse tournée londonienne La Belle
au bois dormant
dans la spectaculaire version de 1890 reconstruite par Sergueï
Vikharev. Comme l’apothéose d’une
décennie fantastique. On peut sans
doute affirmer aujourd’hui qu’elle constituait, en
ces années
"post-perestroïka", un essai d’une ambition folle
pour retrouver, dans
un élan de nostalgie joyeuse, la trace oubliée et
le parfum perdu de la
grandeur du Ballet Impérial. En 2009, après
moultes changements au sein
de la compagnie, le Mariinsky achevait sa saison
d’été londonienne en
proposant aux spectateurs de Covent Garden ce même ballet
dans la
version "soviétique" de Konstantin Sergueev et les
décors de Simon
Virsaladze. Retour en arrière ou choix regrettable, diront
certains, le
fameux hiatus entre les goûts dominants d’un
certain public et ceux de
l’institution est apparu, dans ce cas précis,
particulièrement
prégnant. Quoi qu’il en soit, cette Belle
de 1952, qui bénéficie ouvertement des faveurs du
directeur de la
troupe, Youri Fateev, et des danseurs eux-mêmes, fait partie
d’un
héritage et d’une tradition
profondément ancrée dans la compagnie, et
à
ce titre, mérite indéniablement de continuer
à exister – elle aussi
possède sa beauté et sa poésie propres
- en espérant cependant que cela
puisse se faire, dans le proche futur, sans exclusive.
Nonobstant
le choix d’une version du ballet au détriment
d’une autre, les représentations de cette Belle
se sont heurté à divers problèmes,
parmi lesquels le fait d’arriver en
bout de course, à l’extrême fin de la
saison et d’une tournée au
programme particulièrement serré - ce dont la
compagnie est toutefois
coutumière. Beaucoup plus gênantes restent les
coupures ponctuelles
effectuées dans la chorégraphie,
réduisant de fait une œuvre de près de
4h à une version allégée de 3h10,
apparemment justifiée par les
contraintes horaires locales. La très poétique
scène de la Chasse, à
l’acte II, était notamment privée de
ses danses collectives, limitée en
substance au solo du Prince Désiré, tandis que
l’acte III se retrouvait
tronqué d’une partie de ses précieux
divertissements. Il faut bien
avouer enfin que, envisagées globalement, tout au moins du
côté de ces
dames, les distributions, dont étaient absentes à
la fois Diana
Vishneva et Viktoria Tereshkina (cette dernière ayant
été soudainement
remplacée par Anastasia Kolegova, soliste sans doute
compétente et
consciencieuse, mais qu’on dira objectivement de second
ordre), mais
aussi Ekaterina Osmolkina (malheureusement blessée) et
Olesia Novikova
(en congé), manquaient singulièrement de panache
pour une tournée
effectuée dans un théâtre qui a connu,
et connaît encore, de
remarquables interprètes du rôle
d’Aurore.
Pour
cette Belle de fin
de saison, c’est Evgenia Obraztsova qui incarnait,
à l’occasion de la
première, la Princesse Aurore, aux
côtés d’Igor Kolb dans le rôle
du
Prince Désiré et d’Ekaterina Kondaurova
dans celui de la Fée des Lilas.
Evgenia Obraztova, par son physique ravissant et sa grâce
juvénile,
semble à vrai dire née pour
interpréter un tel rôle, un rôle qui
semble
ne reposer sur rien, ou presque rien, si l’on s’en
tient à l’aspect
dramatique, tout en représentant beaucoup, sur le plan
symbolique
autant que chorégraphique. L’épaisseur
psychologique du personnage
étant à peu près inexistante, il
s’agit ici, avant tout, de paraître
– de paraître ce que l’on est
substantiellement –, à savoir une
princesse de conte de fées évoluant dans le
contexte hautement
aristocratique d’une cour de France
rêvée et fantasmée. Il est
évident
que seule une ballerine à la forte personnalité
scénique et artistique,
peut parvenir, en plus de ses qualités techniques,
à faire exister et
tenir cette pure apparence, cet archétype
littéraire, cette essence
même de la beauté classique, durant trois longs
actes.
Evgenia
Obraztova possède sans conteste, et de manière
superlative,
l’aisance et la solidité technique
exigées par la chorégraphie ainsi
que le raffinement délicat qui sied tant au style du ballet
qu’au
caractère noble de l’héroïne.
A cet égard, elle honore pleinement la
tradition d’élégance, de perfection
méticuleuse et de pureté académique
du Mariinsky. Ses sauts sont à la fois légers et
puissants - sans ces
molles et si courantes retombées au sol de gymnaste -, ses
équilibres
durant l’Adage à la Rose ou la scène de
la Vision ne connaissent pas la
moindre hésitation et savent se faire spectaculaires sans
excès, le
travail du bas de jambe est toujours d’une impeccable
précision, les
épaulements et les ports de tête se
révèlent subtils, chargés de
nuances… L’entrée d’Aurore,
au premier acte, empreinte de vivacité et
d’allant, nous présente ainsi une princesse
joyeuse et d’emblée
conquérante, où le tempérament solaire
de la danseuse trouve à
s’exprimer avec une autorité et un bonheur
gourmands. L’acte II, situé
non plus dans le monde réel, mais dans le monde onirique
d’une forêt
magique – aux couleurs de l’automne - sur laquelle
veille la Fée des
Lilas, voit alors le personnage se teinter d’une aura de
mystère : elle
est ici la princesse endormie, irréelle et fantomatique qui
apparaît en
rêve au Prince durant un adage de toute beauté,
auquel se joignent la
Fée des Lilas et le corps de ballet, qui reste
l’un des sommets
esthétiques et émotionnels du ballet. Si la
transformation s’avère
jusque-là convaincante, l’acte III manque en
revanche d’un certain air
de grandeur dans l’interprétation. Le pas de deux
final est certes
parfaitement dansé, mais ressemble à un simple
numéro de gala, dont la
relative banalité se heurte à la
majesté imposée par les circonstances.
L’instant, qui se présente comme une forme
d’apothéose pour les héros
du conte, manque en quelque sorte de la
théâtralité nécessaire pour
exister avec éclat. Aurore reste la jeune princesse
fraîche, radieuse
et pleine de charme qu’elle était lors de son
éveil à la vie, mais
peine davantage à triompher sous les traits d’une
femme que le temps a
métamorphosée. Une certaine sophistication des
effets, au-delà de
sourires de convention quelque peu forcés,
n’aurait sans doute pas paru
superflu.
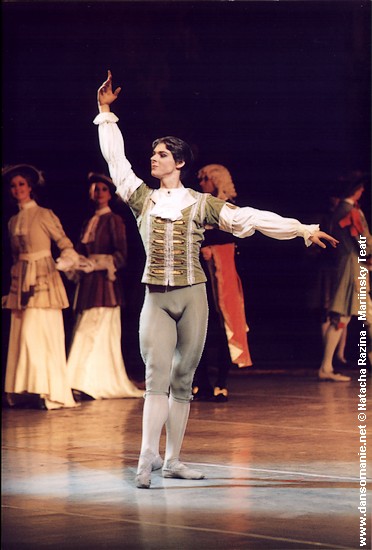
Vladimir
Shklyarov (Desiré)
En Prince Désiré, Igor Kolb se montre de son
côté un interprète puissant,
à la danse impeccable et féline, en
même
temps qu’un partenaire hors pair et d’une
générosité admirable. Ironie
du temps qui passe, il était déjà
Désiré, en 2000, ici même à
Covent
Garden, dans La Belle
de
Vikharev, alors que son nom n’était que celui
d’un tout jeune soliste
figurant dans des distributions à faire frémir de
délice et de
nostalgie... Son physique rugueux et son tempérament sombre,
presque
"intellectuel", lui permettent en outre de donner une
véritable
consistance à un rôle bien mince, tout en
échappant au syndrome des
princes trop charmants, si lisses et souriants qu’ils
finissent par en
paraître insupportables de niaiserie. Dans ce rôle
de bravoure, limité
à une certaine forme de virtuosité brillante, il
faut néanmoins se
donner la peine de voir et d’admirer aussi – une
raison de croire et
d’espérer! - Vladimir Shklyarov
(désormais principal lui aussi, il
officiait aux côtés d’Anastasia Kolegova
lors de la matinée du 15
août), d'une stature apollinienne, qui offre au public ce
petit frisson
supplémentaire conférant à une
excellente prestation un parfum
d’exceptionnel.
C’est toutefois Ekaterina Kondaurova qui, en Fée
des Lilas, a su illuminer d’un éclat tout
particulier une
représentation à certains égards en
demi-teinte, si l’on veut bien se
souvenir que c’est le Mariinsky que l’on regarde.
Si son Odette-Odile,
d’une perfection technique et d’une
beauté formelle indéniables, avait
peut-être pu laisser le spectateur sur sa faim du fait du
relatif
manque d’émotion qui s’y
reflétait, sa Fée des Lilas ne suscite en
revanche que des éloges appuyés. On ne peut
même se retenir d’un
profond sentiment de reconnaissance devant l’accomplissement
artistique
dont elle fait preuve ici, en contrepoint de l’image
résolument
moderne, glaciale et sexy, dont elle a pu être quelque peu
prisonnière
par le passé, notamment en tant
qu’interprète privilégiée du
répertoire
de William Forsythe. En Fée des Lilas, elle parvient en
effet à
conjuguer son autorité naturelle et
auréolée de mystère - cette intense
force de persuasion qui la rend si propre à
interpréter les personnages
héroïques – à une
sérénité et une douceur admirables,
révélées par une
danse infiniment moelleuse et lyrique. Pas la moindre extension
forcée
(là où Daria Vasnetsova nous aura
livré dans le même rôle un
véritable
show – franchement épuisant -,
contrôlé du reste à la perfection, mais
plus balanchinien que classiquement classique et sans rapport avec
l’image de la bienfaitrice d’Aurore), dans une
chorégraphie qui
pourrait pourtant les solliciter, une danse ample, fluide,
élégante,
dont les difficultés sont surmontées sans heurts
et avec un brio
toujours tempéré, un air de bonté
naturelle et inaltérée, sa prestation
ce soir-là n’était sans doute pas loin
de ce qu’on appelle - en langage
humain - la perfection. A cet égard, son duo avec Carabosse,
interprétée par le
ténébreux et inquiétant Islom
Baimuradov, mérite
spécialement d’être mentionné
pour son impeccable théâtralité et le
conflit moral que les deux personnages parvenaient ensemble
à suggérer.
Carabosse a d’ailleurs été
huée sans retenue par le public anglais,
conformément à la coutume locale, signe que
l’interprète avait été
à la
hauteur d’un rôle qui exige de grandes
qualités, à la fois plastiques
et de mime, pour retenir l’attention et
véritablement saisir
le spectateur, sans sombrer dans un grotesque littéral qui
n’a que peu
à voir avec le personnage tel que cette version
chorégraphique nous le
dépeint.
En marge des rôles principaux, on retiendra une
nouvelle fois, et avant toutes les autres, la prestation, digne de tous
les superlatifs, de Yana Selina en Fée Violente (on la
retrouvait
encore en Chatte Blanche dans les divertissements de l’acte
III, un
rôle comique qu’elle incarne de manière
magistrale). Par sa précision
aiguë, presque désespérante, son sens de
l’attaque et son talent à
manier avec nuance les accents musicaux, elle parvient à
métamorphoser
une simple variation virtuose en un véritable bijou
d’interprétation.
Dans un style autre, léger et aérien, en
conformité avec le tempérament
qu’elle est censée incarner, Maria Shirinkina
révèle quant à elle sa
danse pure et cristalline dans la variation de la Fée
Tendresse
(Candide), sans doute la Fée la plus remarquable avec
l’indispensable
Fée Canari de Valeria Martiniuk. On regrette de
n’avoir pu, pour cette
fois, voir cette jeune coryphée formée
à Perm en Princesse Florine, un
rôle qu’elle possède
également à son (jeune) répertoire. La
Princesse
Florine de cette première, Daria Vasnetsova
(associée au talentueux et
prometteur Maxim Zyuzin en Oiseau bleu), laisse en revanche plus
perplexe notamment quant à son adéquation au
rôle : si sa grande taille
et son autorité naturelle, doublées
d’un physique débordant de glamour,
se prêtent aisément au personnage de la
Fée des Lilas, (un rôle qu’elle
incarnait lors de la matinée du 15 août), ses
indéniables qualités
scéniques paraissent en revanche peu en phase avec la nature
profonde
du Pas de deux en question, qui exige sans doute un style plus subtil,
à la fois éthéré et
gracieux (beaucoup mieux servi de ce point de vue
par Irina Golub lors de la matinée du 15). Quant au corps de
ballet, en
dépit de la musicalité unique qu’il
parvient à conserver envers et
contre tout et qui transparaît notamment dans le Prologue
enchanteur
mettant en scène les Fées ou les volutes de la
Valse des Fleurs, il
faut bien avouer qu’en cette fin de tournée et
à l’approche des
vacances, il ne délivrait pas toujours la même
impression, à la fois
dynamique et sereine, d’harmonie classique que lors de la
représentation donnée de ce même
ouvrage il y a deux mois, durant les
Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg. Au fond, jamais il ne
nous est
apparu plus évident que c’est là-bas,
et nulle part ailleurs, que cette Belle
mal aimée, décousue et
un brin fatiguée est faite pour briller dans toute sa
plénitude. Il est
des lieux où, imperceptiblement, souffle l’esprit.
B. Jarrasse
©
2009,
Dansomanie
La Belle au
bois dormant
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Chorégraphie : Marius Petipa, révisée
par Konstantin Sergueïev
Argument : Ivan Vsevolojsky - Sergueï Khudekov,
d'après Charles Perrault
Direction
musicale : Pavel Bubelnikov
____
Vendredi 14 août 2009,
19h30
Le
Roi – Vladimir Ponomarev
La
Reine
– Elena Bajenova
Aurore
– Evguenia Obraztsova
Le
Prince Désiré – Igor Kolb
Les
Suivants d'Aurore – Konstantin Zverev - Maxim Zuzin -
Sergueï Popov - Alexander Sergueïev
La
Fée des Lilas – Ekaterina Kondaurova
Carabosse
– Islom Baïmuradov
La Fée Tendresse –
Maria Shirinkina
La Fée
Espièglerie –
Evguenia Dolmatova
La Fée
Générosité –
Elena
Yushkovskaïa
La Fée Audace –
Jana Selina
La Fée Canari –
Valeria Martinyuk
La Fée Diamant –
Irina Golub
La Fée Saphir –
Elena Androsova
La Fée Or –
Ksenia Dubrovina
La Fée Argent –
Anna Lavrinenko
Catalabutte –
Soslan Kulaev
Galifron –
Soslan
Kulaev
Un
Serviteur – Anatoly Marchenko
Florine
– Daria Vasnetsova
L'Oiseau bleu
– Maxim Zuzin
La
Chatte blanche – Jana Selina
Le Chat botté – Fedor
Murashov
Le Petit chaperon rouge – Elena
Yushkovskaïa
Le Grand méchant loup – Anatoly Marchenko
____
Samedi 14 août 2009,
14h00
Le Roi – Vladimir
Ponomarev
La
Reine
– Elena Bajenova
Aurore
– Anastasia Kolegova
Le
Prince Désiré – Vladimir Shklyarov
Les
Suivants d'Aurore – Konstantin Zverev - Maxim Zuzin -
Sergueï Popov - Alexander Sergueïev
La
Fée des Lilas – Daria Vasnetsova
Carabosse
– Islom Baïmuradov
La Fée Tendresse –
Maria Shirinkina
La Fée
Espièglerie –
Evguenia Dolmatova
La Fée
Générosité –
Elena
Yushkovskaïa
La Fée Audace –
Jana Selina
La Fée Canari –
Valeria Martinyuk
La Fée Diamant –
Anastasia Petushkova
La Fée Saphir –
Elena Androsova
La Fée Or –
Ksenia Dubrovina
La Fée Argent –
Anna Lavrinenko
Catalabutte –
Soslan Kulaev
Galifron –
Soslan
Kulaev
Un
Serviteur – Anatoly Marchenko
Florine
– Irina Golub
L'Oiseau bleu
– Alexander Timofeïev
La
Chatte blanche – Valeria Matinyuk
Le Chat botté – Grigory
Popov
Le Petit chaperon rouge – Elena
Yushkovskaïa
Le Grand méchant loup – Anatoly Marchenko


|
|
|



















