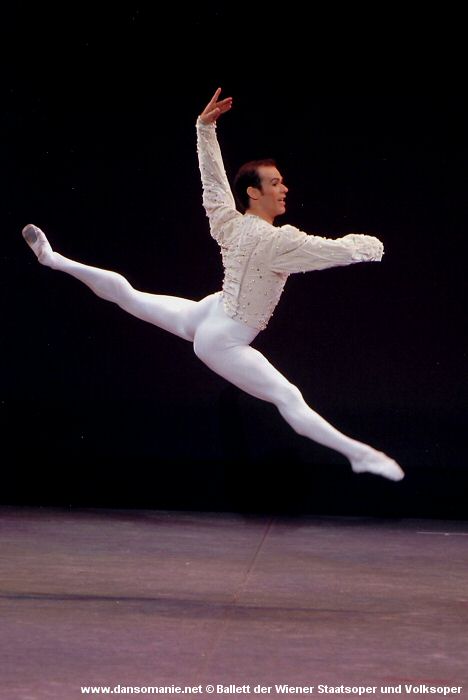Samuel
Colombet, d'Avignon, et Alexis Forabosco, de Paris, ont tous
deux choisi de poursuivre leur carrière de danseur à l'étranger ; un
parcours similaire les a d'abord conduits en Allemagne, puis en
Autriche, et ils exercent aujourd'hui tous les deux leur art au Ballet
de l'Opéra de Vienne. Ils ont accepté, pour Dansomanie,
d'évoquer leur trajectoire qui les a menés jusque sur les rives du
Danube.
Samuel Colombet et Alexis Forabosco, danseurs à l'Opéra de Vienne
|

|
Samuel
Colombet :
J’ai
été formé au Conservatoire National de Danse d’Avignon, où
je suis resté jusqu’au baccalauréat. J’ai ensuite passé
des auditions et, en janvier 1996, j’ai été engagé à
Lucerne. Coup de chance, ce fut ma première audition et… mon
premier contrat. En fait, dès l’issue de la présentation, on
m’a demandé de rester, et j’ai dû m’installer en Suisse
sur- le-champ. La compagnie avait un répertoire assez
classique, les filles travaillaient sur pointes, et j’y ai
notamment dansé pas mal de Cranko. Mais il faut savoir
que dans les pays d’expression germanique, il n’existe pas
de distinction radicale entre compagnies «classiques» et «contemporaines».
On y danse de tout, partout, aussi bien du Petipa que du Mats
Ek. J’avoue ne pas comprendre pourquoi, en France, on sépare
aussi nettement les troupes «classiques» (c'est-à-dire où
les filles dansent sur pointes) et les troupes «contemporaines»,
où l’on évolue pieds nus.
J’ai
passé un an à Lucerne, puis, le directeur à changé, nos
contrats n’ont pas été renouvelés et les quatorze danseurs
de la compagnie ont été licenciés.
En
septembre 1997, j’ai réussi à entrer au Regional Theater de
Hof, en Bavière, où je suis demeuré deux ans. Ensuite, ce fut
l’Opéra de Halle, en Saxe-Anhalt, puis, quatre ans plus tard,
Graz, en Autriche. Je n’y suis resté qu’une seule année,
car le poste ne correspondait pas vraiment à mes attentes. Et
finalement, en 2004, on m’a engagé à l’Opéra de Vienne.
Dans la capitale autrichienne, la saison de ballet s’étend de
septembre à juin. Les danseurs sont recrutés sur des contrats
d’un an, tacitement reconductibles. Si, au 31 janvier de la
saison en cours, lesdits contrats n’ont pas été dénoncés,
ils sont automatiquement renouvelés pour l’année suivante.
Mais, contrairement à l’usage en vigueur à l’Opéra de
Paris, par exemple, nous ne bénéficions pas de CDI (contrats
à durée indéterminée, ndlr.), et nous demeurons toujours
dans une certaine précarité. Et l’incertitude s’accroît
lors des changements de direction : le nouveau directeur a
souvent aussi d’autres exigences, le répertoire évolue, tout
comme le profil des danseurs recherchés, et on risque évidemment
toujours d’être licenciés. L’Opéra de Vienne aura un
nouvel Intendant général (administrateur, ndlr.) – le Français
Dominique Meyer, actuel directeur du Théâtre des Champs-Elysées
– en 2010, et cela impliquera peut-être aussi quelques
bouleversements au niveau du ballet. |
|
|
|

|
Alexis
Forabosco :
Ma formation s’est déroulée à Paris. J’ai débuté
la danse à 14 ans. J’ai étudié tout d’abord au
Conservatoire National de Région (CNR, rue de Madrid à Paris,
ndlr.), puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris (CNSMDP). Dans cet établissement, le cursus
est normalement de cinq ans, mais en 1998, au bout de ma troisième
année, je suis parti au Ballet National de Bordeaux, Charles
Jude m’ayant obtenu un contrat. Tout en étant à
Bordeaux, je suivais aussi des cours au ballet de la Scala de
Milan, ville où résidait mon amie, et où je me rendais par
conséquent fréquemment. Le directeur du ballet de la Scala, Frédéric
Olivieri, m’avait non seulement permis d’assister aux
cours de la compagnie, mais aussi de participer à quelques
tournées, en tant que surnuméraire.
Avec l’accord de Charles Jude, j’ai donc
fini par quitter Bordeaux définitivement en cours de saison, et
je suis resté six mois à la Scala. Malheureusement, à
l’issue de la saison, on ne m’a proposé qu’un nouveau
contrat de surnuméraire de neuf mois, que j’ai refusé.
J’ai donc tenté ma chance ailleurs, en passant des auditions,
et Ivan Liska m’a engagé à Munich ; j’ai pris
mes fonctions lors de la saison 2001-2002, et je suis demeuré
au Bayerisches Staatsballett jusqu’en 2006. Ce fut une expérience
très positive : le répertoire était varié, nous
disposions de moyens financiers conséquents, et Munich est une
ville très agréable à vivre. |
|
|
|

|
|
Samuel Colombet |
|
|
|

|
Samuel
Colombet :
A l’Opéra de Vienne, il existe trois niveaux de
hiérarchie : les solistes, les demi-solistes et le corps
de ballet. Avec 104 danseurs, la compagnie est l’un des plus
gros ensembles chorégraphiques d’Europe occidentale. Elle résulte
de la fusion, en 2006, de la troupe de la Volksoper (l’«Opéra-comique»
de Vienne, en quelque sorte, ndlr.) et de celle de la Staatsoper
(le «grand» Opéra, ndlr.). Mais, en raison de problèmes de
locaux, le travail demeure réparti entre deux groupes distincts
de danseurs : l’un répète à la Volksoper et interprète
surtout les ballets inclus dans les opéras et les opérettes,
tandis que l’autre se consacre plutôt au grand répertoire
strictement chorégraphique.
L’intégration des deux troupes en une seule entité
ne s’est donc pas entièrement réalisée dans les faits, même
si les danseurs anciennement affectés à la Volksoper viennent
renforcer les ex-Staatsoper lorsque nous montons de grosses
productions, telles le Lac
des cygnes. Mais les choses évoluent, et, au cours de la
saison 2008-2009, pour la première fois, le même ballet sera
à l’affiche des deux théâtres. Les danseurs de chaque
groupe seront mélangés, et pourront, si besoin est, se
remplacer mutuellement. C’est une bonne chose, car les grands
ouvrages classiques étaient jusqu’à présent exclus du répertoire
de la Volksoper. Cela induira aussi des changements d’ordre «culturel»
chez les artistes, car la Volksoper était plus ou moins considérée
comme «inférieure» à sa grande sœur. Par ailleurs, à la
Volksoper, tous les danseurs avaient un rang égal, alors qu’à
la Staatsoper la hiérarchie était traditionnellement plus
marquée, même si les danseurs de corps de ballet pouvaient
aussi occasionnellement être distribués sur des soli. |
|
|
|

|
|
Alexis
Forabosco |
|
|
|

|
Alexis
Forabosco :
Justement,
moi qui suis dans le corps de ballet, j’ai par exemple pu
danser l’un des Trois Jeunes Hommes dans Manon, de MacMillan. La variation est très compliquée, et
j’ai pris beaucoup de plaisir à en dominer les difficultés.
De manière générale, on pourrait dire que tous les soli sont
intéressants, car pour un danseur, il est toujours motivant de
se retrouver sur le devant de la scène. De plus, lorsqu’on
est distribué sur un solo, on bénéficie lors des répétitions
de corrections personnalisées qui nous permettent de
progresser, et le travail en est d’autant plus valorisant.
Le
répertoire du ballet de l’Opéra de Vienne comporte beaucoup
d’ouvrages russes, mais MacMillan – son Mayerling sera bientôt à l’affiche – ou Cranko – dont
nous avons donné Onéguine
et Roméo et Juliette
y sont aussi présents. La saison 2008-2009 marquera la première
entrée au répertoire d’un ballet de Roland Petit, La
Chauve-souris ; néanmoins, ce sont toujours les chorégraphes
d’Europe de l’Est qui se taillent la part du lion.
Lors des premières d’une production importante, il est fréquent que
des solistes étrangers renommés soient invités. Pour la Bayadère, on avait fait venir Léonid Sarafanov. Par chance,
Sarafanov a pu rester un peu plus longtemps, et nous
avons pu, en sus des classes, faire du travail intéressant avec
lui. |
|
|
|

|
|
Samuel Colombet
(à gauche) dans Max und Moritz (chor. Ferenc Barbay
& Michael Kropf) |
|
|
|

|
Samuel
Colombet :
Pour
moi, l’une des expériences les plus marquantes fut Mokka,
une chorégraphie de Myriam Naisy (chorégraphe française
née à Grenoble, ndlr.) sur des musiques de Paolo Conte.
Myriam Naisy s’est montrée assez exigeante dans le
choix des interprètes, et j’ai de ce fait été très flatté
et heureux que d’emblée, elle ait voulu travailler avec moi.
Autre
beau souvenir, Tabula rasa,
un ballet écrit spécialement pour nous par András Lukács,
un danseur hongrois de la compagnie. András Lukács s’est
montré d’une grande patience, et les répétitions ont été
très agréables.
Enfin,
tout récemment, on m’a confié, dans Max
und Moritz, de Ferenc Barbay
et Michael Kropf, le rôle de la Veuve Bolte, où je dois
me travestir et monter sur pointes. Là aussi, le travail a été
très intéressant. Pour ce même ouvrage, il m’a par ailleurs
fallu prendre des cours de claquettes!
[Max et Moritz sont deux personnages comiques de bande dessinée, nés
en Allemagne en 1865 sous le pinceau de Wilhelm Busch. Ils sont
l’équivalent germanique de Zig
et Puce, ndlr.]
Au cours du mois de mai 2008, nous aurons aussi une soirée «Jeunes Chorégraphes»,
au cours de laquelle je vais faire mes débuts de créateur. Je
vais y monter une pièce pour quatre danseuses, intitulée Lieder für vier Frauen. C’est pour moi un sacré défi car je
n’ai aucune expérience dans ce domaine, mais en tout cas, le
travail préparatoire s’est avéré très intéressant. Tout
d’abord, on m’a demandé de présenter un projet détaillé,
avec esquisses de costumes, dessins techniques, etc. A partir de
cela, on a discuté de ce qui était réalisable ou non. J’ai
pu choisir mes interprètes, et, au fil des répétitions, il
m’a fallu adapter les pas de danse à leurs aptitudes propres. |
|
|
|

|
|
Alexis
Forabosco (de face) dans In Your Eyes my Face Remains (chor.
András Lukács) |
|
|
|

|
Alexis
Forabosco :
Personnellement,
je ne me sens pas une âme de chorégraphe, je suis un interprète
avant tout. C’est certainement très intéressant de monter
une chorégraphie, mais je
ne me sens pas capable de me lancer dans une telle aventure.
Comment je me suis adapté à l’Autriche ? En fait, le plus
difficile fut mon arrivée en Allemagne. Une fois la langue maîtrisée,
les choses sont devenue beaucoup plus aisées. J’ai appris
l’allemand sur le tas, tout comme l’anglais d’ailleurs! Ce
serait stupide de ne pas vouloir parler la langue du pays qui
vous accueille. Il faut faire cet effort. Les Français ont des
préjugés contre l’allemand, mais c’est une langue «carrée»
que j’apprécie beaucoup ; maintenant, même avec des
amis francophones, il m’arrive, sans m’en rendre compte,
d’insérer des mots d’allemand dans la conversation. |
|
|
|

|
Samuel
Colombet :
A l’école, j’avais fais anglais-espagnol…
Alors, j’ai acheté une méthode d’allemand, mais cela n’a
pas été très efficace. Comme Alexis, c’est sur le tas que
j’ai véritablement appris la langue. En plus, je me suis
retrouvé dans le groupe des «ex-Volksoper», essentiellement
germanophone, donc je n’avais pas le choix. A la Volksoper,
les cours ont généralement lieu en allemand, tandis qu’à la
Staatsoper, c’est l’anglais qui est privilégié. Mais pour
les répétitions, de toutes manières, l’allemand prédomine,
quel que soit le lieu. Donc, je m’y suis fait, au point que
maintenant, il m’arrive d’aider les collègues lorsqu’une
traduction est nécessaire! |
|
|
|
 
|
Samuel
Colombet & Alexis Forabosco :
Aujourd’hui, il faut viser toute l’Europe, et
les jeunes artistes français doivent être conscients qu’il
n’y a pas que l’Opéra de Paris, même si c’est une
compagnie magnifique. En Allemagne, on trouve de très
nombreuses compagnies, qui offrent des débouchés aux danseurs,
leur permettent de travailler avec des chorégraphes intéressants,
dans des répertoires originaux et variés. |
Samuel
Colombet & Alexis Forabosco
Entretien
réalisé le 29 mai 2008
© Samuel Colombet & Alexis
Forabosco – Dansomanie
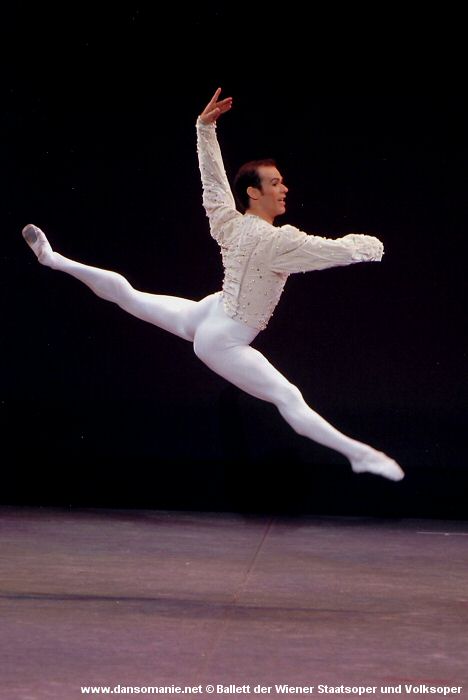
|