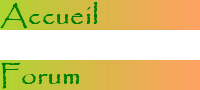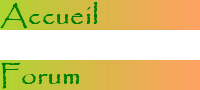|
Prix de Lausanne 2018 - Interview : Birgit Keil
31 janvier 2018 : Birgit Keil, l'Etoile allemande
Birgit Keil est revenue en 2018 au Jury du
Prix de Lausanne après en avoir fait partie lors des tous débuts du
concours, au temps d'Elvire et Philippe Braunschweig. Relativement peu
connue en France, même si elle a dansé en tant qu'invitée à l'Opéra de
Paris, Birgit Keil fut LA grande ballerine d'Allemagne de l'Ouest durant
les années 1960 et 1970. Egérie de John Cranko, elle a exercé son art
durant plus de trente ans au Ballet de Stuttgart, tout en menant une
carrière internationale en tant qu'artiste invitée.
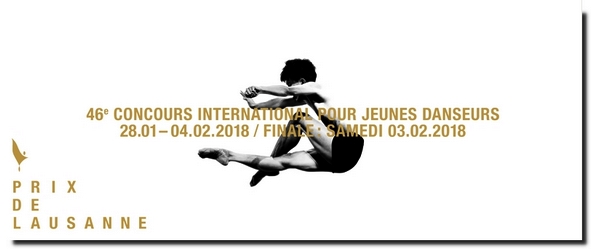
Birgit Keil, membre du jury du Prix de Lausanne 2018
Pouvez-vous tout
d'abord retracer un peu votre carrière? Vous êtes célèbre en Allemagne
mais le public français, hormis les balletomanes les plus avertis, ne
vous connait pas vraiment.
Ma carrière s'est principalement déroulée à Stuttgart. J'ai fait mes
classes à l'école du Stadttheater, et puis, vint John Cranko. Il m'a
engagée dans sa compagnie, et après un an, j'ai obtenu une bourse du
Ministère de la Culture [du Land de Bade-Wurtemberg, ndlr] pour
poursuivre ma formation durant une année supplémentaire à la Royal
Ballet School à Londres. D'emblée, il était convenu que je retournerai
ensuite à Stuttgart, où je fus nommée soliste. Kenneth McMillan, qui, à
l'époque, était directeur et chef-chorégraphe du Royal Ballet, avait
eu, de la part de John Cranko, pour instruction de me prendre sous son
aile, de me «chouchouter» un peu. Il m'a montré énormément de choses,
et j'avais l'autorisation d'assister aux répétitions et aux créations.
C'était là un grand privilège dont je jouissais par rapport aux autres
élèves. Quand je suis retournée à Stuttgart, c'est Kenneth McMillan
lui-même qui m'a accueillie. Il venait de créer son fameux ballet Las Hermanas [Les Deux sœurs,
d'après Federico Garcia Lorca, ndlr]. C'est là que j'ai obtenu mon
premier rôle important, celui de la Soeur cadette. Peu de temps après,
j'ai été promue «Erste Solo Tänzerin» [Principal, le grade le plus élevé
dans les compagnies allemandes, ndlr]. J'ai travaillé douze ans sous la
direction de Cranko. Sa mort fut pour moi un grand choc. Nous revenions
d'une tournée aux USA, et nous étions dans l'avion qui nous ramenait de
Pennsylvanie à Stuttgart. Cranko est mort durant le voyage. J'étais
dans le même avion. C'est quelque chose que l'on ne peut pas oublier.
Après cela, étions tous persuadés que la compagnie allait éclater. Il
n'en a heureusement rien été. Nous sommes tous restés soudés. La troupe
que Cranko avait mise sur pieds était comme une famille. Il était un
père pour nous. Il me considérait comme sa « Baby Ballerina » - comme
celles des Ballets Russes [c'est ainsi que l'on avait nommé les trois
très jeunes danseuses recrutées par George Balanchine en 1931-1932
lorsqu'il était Maître de ballet aux Ballets Russes de Monte-Carlo,
Irina Baranova, Tatiana Riabouchinska et Tamara Toumanova. Elles avaient
toutes entre 13 et 15 ans au moment de leur engagement, ndlr]. J'étais
la ballerine allemande dont il rêvait.
Qu'est ce que Cranko appréciait tellement en vous? Pourquoi a-t-il décidé de faire de vous une soliste?
J'étais très jeune. J'ai obtenu mon premier contrat à seize ans. Cranko
voulait élargir mes horizons. Je vivais encore chez mes parents, avec
mes frères et sœurs, et j'étais très surveillée. C'est pour cela qu'il
m'a envoyée à Londres. Il voulait que je découvre le monde, que je fasse
des expériences, avant de retourner à Stuttgart. J'ai même eu le droit
de suivre les cours avec le Royal Ballet. Ce fut inoubliable pour moi,
il y avait là toutes les grandes stars de la danse, Svetlana Beriosova
notamment. Je ne saurais dire si l'une d'entre elles m'a davantage
marquée que les autres. Cela formait un tout, où je pouvais assouvir ma
passion pour la danse.
Vos parents avaient-ils eux-mêmes un lien avec cet art?
Non. Nous venions des Sudètes [région germanophone de
l'ex-Tchécoslovaquie, annexée par Hitler en 1938, ndlr]. En 1945, nous
avons tout perdu. Nous avons passé huit ans dans un camp de réfugiés à
Bad Kissigen [ville du nord de la Bavière, située près de Würzburg,
ndlr]. Nous avons ensuite déménagé à Stuttagart. Mon père, invalide de
guerre, était obligé de suivre un stage de rééducation. Je pense que je
n'ai pas apporté beaucoup de joie à mes parents. J'avais une santé
fragile, j'étais souvent malade, et à trois reprises, ma vie a même été
menacée. Je souffrais par ailleurs du dos, et ma colonne vertébrale
était très faible. La doctoresse avait conseillé de m'envoyer faire de
la gymnastique rééducative. Ma mère a préféré m'inscrire à un cours de
danse classique. Ce fut donc le ballet. C'est encore aujourd'hui un
mystère pour moi, mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Ce fut
une grande chance, même si cela a aussi été un grand sacrifice pour ma
famille, qui n'avait à l'époque quasiment pas de moyens financiers. A
six ans [recte : huit ans], j'ai donc chaussé mes premières pointes.
Quand vous êtres entrée au Ballet de
Stuttgart, il n'y avait – en RFA – quasiment pas de danseuses – ou de
danseurs – classiques allemands de rang international. C'est toujours un
peu le cas, alors que, paradoxalement, il existe Outre-Rhin davantage
de compagnies de ballet qu'en France par exemple. Comment expliquez-vous
cela?
A vrai dire, je n'ai pas vraiment d'explication à cela. Il en a
effectivement presque toujours été ainsi. Le métier de danseur est
difficile, contraignant. Pour l'exercé, il faut être passionné,
«possédé» même. C'est la danse qui choisit ses serviteurs. La plus
orgueilleuse des mères, le plus ambitieux des professeurs ne peuvent
rien pour celui qui n'a pas le courage nécessaire. Le danseur vraiment
«possédé» DOIT danser, un peu comme un joueur compulsif DOIT jouer.
C'est comme cela que ça s'est passé pour moi. Je n'avais de cesse d'en
finir avec l'école, pour pouvoir me consacrer entièrement à ce qui
n'était encore qu'un «hobby», la danse.
Vous avez fait toute votre carrière à Stuttgart?
Oui. J'ai passé trente-cinq ans dans la compagnie. Après la mort de John
Cranko, l'intérim a été brièvement assuré par la maîtresse de ballet de
l'époque, puis Glen Tetley a pris la direction de la troupe. Il a, à la
suite de Cranko, donné une nouvelle dimension au Ballet de Stuttgart.
Il a fait énormément de créations pour moi, et ce fut une période très
heureuse. Ensuite, Marcia Haydée est arrivée, et j'ai pris ma retraite.
J'ai encore assuré durant un an les fonctions de Maîtresse de ballet,
puis je me suis arrêtée. En fait, je n'arrivais plus à me sortir de la
tête l'idée de créer une fondation destinée à aider les nouvelles
générations de danseurs. C'est pour cela que j'ai cessé mes activités au
Ballet de Stuttgart. J'ai donc mis sur pied la Tanzstiftung Birgit Keil
[Fondation Birgit Keil pour la danse], qui a aujourd'hui plus de vingt
deux ans d'existence. Elle a déjà soutenu financièrement trois-cents
boursiers. Quand j'ai quitté la scène, j'ai eu droit à un somptueux gala
d'adieux, gala qui a aussi été l'occasion de lancer cette fondation, et
de la présenter au public. De nombreux jeunes danseurs y ont participé.
Le siège de ma fondation est à Stuttgart. Stuttgart est devenue ma
«patrie», et c'est toujours mon lieu de résidence principal, même si
aussi bien Cranko que ses successeurs, Glen Tetley et Marcia Haydée,
nous ont toujours encouragés à nous produire partout dans le monde, que
se soit lors des tournées officielles de la compagnie ou en tant
qu'invités. J'ai ainsi beaucoup dansé à l'American Ballet Theatre à New
York. Eliot Feld, notamment, a chorégraphié pour moi. J'ai également
dansé à Vienne, à la Scala de Milan et à l'Opéra de Paris.
Justement, vous évoquez l'Opéra de Paris. Vous y aviez dansé quoi?
J'y ai dansé le Pas de quatre
d'Anton Dolin [pas de quatre chorégraphié par Jules Perrot en 1845 à
Londres, et qui réunissait Lucile Grahn, Carlotta Grisi, Fanny Cerrito
et Marie Taglioni. La pièce fut recréée par Dolin en 1941, ndlr], ainsi
que le grand Pas de deux de Casse-Noisette.
Vous avez été une partenaire de Nouréev, non?
Effectivement, à Vienne. J'y ai dansé une longue série de Lac des Cygnes
à ses côtés. J'ai aussi dansé à l'ABT avec Fernando Bujones. Ce furent
de belles et grandes expériences. J'y ai appris énormément.
Et après?
Au moment de l'arrivée de Reid Anderson à la direction du Ballet de
Stuttgart, on m'a proposé un poste d'enseignante à la Hochscule für
Musik und darstellende Kunst [Conservatoire Supérieur de Musique et
d'Arts de la scène] de Mannheim, a laquelle était adjointe une Académie
de Danse, dont on m'a confié la direction quelques mois plus tard. Cela
fait maintenant vingt ans que j'occupe ces fonctions. Je suis
principalement chargée de la formation de jeunes professionnels de la
danse, qui sont d'ailleurs aussi boursiers pour la plupart. Il y a eu
parmi eux d'anciens élèves de la John Cranko Schule, comme Alicia
Amatriain, qui a depuis fait une carrière internationale avec le Ballet
de Stuttgart. Elle fut l'une de mes toutes premières disciples. Il y a
aussi Thiago Bordin, un Brésilien qui est devenu célèbre au Ballet de
Hambourg, et qui est maintenant chorégraphe au Nederlands Dans Theater.
Et l'an passé, un de mes élèves, Taisuke Nakao, a remporté le troisième
prix à Lausanne.
Et cette année, présentez-vous aussi un candidat?
Non, cette année, il n'y a personne de Mannheim au Prix de Lausanne. En
revanche, nous avons un garçon et une jeune fille qui prennent part au
« projet chorégraphique » initié par Goyo Montero [une nouveauté du Prix
2018, qui réunit cinquante élèves issus de vingt-cinq écoles
partenaires, ndlr]. C'est aussi une belle expérience.
Vous êtes aussi active au Staatstheater de Karlsruhe, non?
Oui, depuis 2003 je dirige le Staatsballett de Karlsruhe, avec Vladimir
Klos, mon compagnon, qui fut aussi mon partenaire à Stuttgart. Mannheim –
Karlsrhue – Stuttargart, ces villes heureusement assez proches forment
un peu mon «triangle d'or»!
Quels sont vos liens avec le Prix de Lausanne?
J'ai été invitée à faire partie du jury par Philippe et Elvire
Braunschweig dans les toutes premières années d'existence du Prix de
Lausanne. Pas la première année, mais dans les tout débuts quand même.
Et c'est pour moi une très belle chose que de pouvoir y retourner
aujourd'hui. Je suis étonnée de voir comment, d'année en année,
l'organisation se développe d'année en année. En tant que juré, je peux
maintenant observer comme les coaches font travailler les candidats, que
ce soit en cours, en classique ou en contemporain. Ils apprennent
énormément, et se dégagent un peu du stress. C'est vrai, un concours,
c'est très stressant, et tous ne supportent pas un tel stress. Tout le
monde ne peut pas passer des concours ainsi.
Comment jugez-vous les jeunes candidats du Prix de Lausanne
aujourd'hui, par rapport à leurs prédécesseurs des
débuts?
Les choses ont beaucoup évolué. Sur le plan physique, athlétique, le
niveau est assurément meilleur. Mais nous jugeons également des aspects
artistiques, et c'est cela qui compte d'abord pour moi. En tout cas je
suis très impressionnée.
Birgit Keil - Propos recueillis et traduits de l'allemand par
Romain Feist
Le
contenu des articles publiés sur www.dansomanie.net et
www.forum-dansomanie.net est la propriété
exclusive de
Dansomanie et de ses rédacteurs respectifs.Toute
reproduction
intégrale ou partielle non autrorisée par
Dansomanie
ou ne relevant pas des exceptions prévues par la loi (droit
de
citation
notamment dans le cadre de revues de presse, copie à usage
privé), par
quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété
intellectuelle.
Entretien
réalisé le 31 janvier 2018 - Birgit Keil © 2018,
Dansomanie
|
|