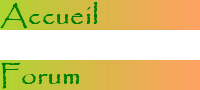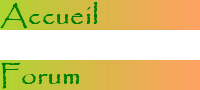Dinna Bjørn, danseuse, maîtresse de ballet, chorégraphe
03 décembre 2017 : réflexions autour de l'«Ecole Bournonville»
Dans quelques
jours, le Ballet Nice-Méditerranée reprendra La Sylphide, d'August
Bournonville, dans la version restituée par Dinna Bjørn. L'ancienne soliste du Ballet Royal du Danemark,
qui fut également directrice du Ballet de Norvège, puis maîtresse de ballet à
Helsinki, en Finlande, livre ici ses réflexions sur la célèbre «École
Bournonville», ce recueil d'exercices organisés en six «journées», qui
constitue la base de l'apprentissage du style d'August Bournonville. L'article de Dinna
Bjørn a été aimablement rédigé en réponse à un "concours"
lancé par la Société Auguste Vestris en janvier 2017, publié sur Dansomanie et
dans The Dancing Times. Nous espérons que
ce document, émanant d'une spécialiste incontestée du maître franco-danois,
contribuera à une meilleure connaissance et à une meilleure compréhension de
l'oeuvre de Bournonville auprès du public francophone.

Se
plonger dans les classes de Bournonville, c’est un peu fouiller
dans une malle aux trésors remplie de joyaux chorégraphiques tous
plus précieux les uns que les autres. Indéniablement, ces classes
sont un instrument inestimable pour qui veut se préparer à danser
Bournonville sur scène. Mais pas uniquement. Danser l’une ou
l’autre de ces classes d’un bout à l’autre donne entrain et
énergie ; exécutées dans le respect minutieux du style et de
la technique, elles permettent un échauffement et un entraînement
de toutes les parties du corps. Après cela, vous serez prêt pour
danser absolument tout.
C’est
de cela que nous sommes redevables à Hans Beck et à ses
contemporains. Ce sont eux qui ont, à la fin du dix-neuvième
siècle, entrepris la compilation de cette série de six classes,
connues sous le titre d’ «École Bournonville»,
à l’intention des danseurs des générations futures. Ces six
classes se fondent sur la réunion de divers exercices que
Bournonville avait l’habitude de faire exécuter durant ses cours,
ainsi que de certaines variations extraites de ses ballets. C’est
grâce à ce matériau, utilisé quotidiennement durant un
demi-siècle par les élèves de l’école et les danseurs [du
Ballet Royal du Danemark] qu’aujourd’hui encore, l’enseignement
théorique et pratique de Bournonville a pu être préservé. Un
enseignement qui s’est transmis directement d’une génération à
la suivante.
Un
problème se pose cependant pour qui veut utiliser ces classes comme
source pour l’étude du système pédagogique de Bournonville en
lui-même. En effet, elles n’ont pas été rassemblées dans leur
ordre actuel par le chorégraphe, mais par Hans Beck et certains de
ses derniers élèves. Même les choix de pas d’école et
d’exercices sont fondés sur leurs souvenirs plus ou moins
sélectifs. Pour cette raison, la structure des cours reflète sans
doute davantage les préoccupations éducatives de Hans Beck que de
Bournonville.
Il
me semble en fait que Hans Beck a surtout souhaité s’attacher à
préserver les éléments chorégraphiques de l’enseignement de son
maître. Il n’a pas voulu « perdre du temps » à
accumuler des exercices exclusivement destinés à travailler un
aspect technique particulier. Il est possible qu’il ait eu
l’intention de laisser à chaque professeur le soin d’ajouter
lui-même les exercices de son choix, en fonction de ses besoins du
moment. Il est évident que c’était là le souhait de Bournonville
lui-même, et on peut s’en convaincre à la lecture de ses deux
principaux ouvrages pédagogiques, les Études chorégraphiques
et Ytaarsgave for Danse-Yndere, eller Anskuelse af Dansen som
skjøn Kunst og behagelig Tidsfordriv («Étrennes pour les
amateurs de danse ou La Danse considérée comme un art d’agrément
et un passe-temps plaisant ») ; il est certain que
Bournonville complétait ses cours par des exercices simples, et des
recommandations qu’il prodigue aux professeurs, on peut déduire
qu’il adaptait lui-même son enseignement aux besoins spécifiques
de chaque danseur.
J’en
conclus que si vous voulez enseigner le style de Bournonville
aujourd’hui, et préparer vos élèves à exécuter sur scène ses
chorégraphies, vous devez utiliser les six « classes »
comme une source d’inspiration, où vous pouvez puiser des
exercices ou des fragments d’exercices que vous réarrangerez de
manière à ce qu’ils correspondent à vos besoins et au niveau des
danseurs de votre cours.
Mais
pour y parvenir, il faut vraiment que vous ayez les classes « dans
la peau », que vous les ayez dansées vous-mêmes, que vous les
ayez maîtrisées et comprises de l’intérieur - en sus bien
évidemment de connaître les chorégraphies des ballets de
Bournonville qui ont été préservées. C'est à cette condition
seulement que les six classes pourront devenir un outil adéquat pour
transmettre le style et la technique Bournonville aux futures
générations. Même si ces six classes n'ont pas été créées sous
cette forme par Bournonville lui-même, je dirais qu'elles
constituent une base solide à partir de laquelle on peut apprendre à
devenir un bon professeur de technique Bournonville.
A
présent, les six classes existent en DVD, ce qui est à la fois
merveilleux et dangereux. Merveilleux, parce qu'elles sont, de cette
manière, conservées pour l'éternité et rendues accessibles à
tous. Mais dangereux aussi, car cela peut amener à croire qu'il
suffit de regarder le DVD et d'en mémoriser les exercices pour
pouvoir enseigner Bournonville, sans les avoir jamais appris soi-même
d'un professeur - avec toute la dévotion, la connaissance profonde,
la compréhension des détails stylistiques, musicaux et techniques
qui vont avec -, et peut-être même sans les avoir jamais dansées
soi-même.
A
ce stade, je voudrais citer le célèbre danseur danois, Erik Bruhn,
qui disait dans son livre Bournonville et la technique du ballet,
écrit il y a plus de cinquante ans :
Bien des années
après sa mort, dans un effort admirable pour sauver son travail de
l'oubli et lui donner en quelque sorte une forme tangible et durable,
les successeurs de Bournonville ont codifié son enseignement à
travers un système arbitraire, comportant une classe définie pour
chaque jour de la semaine. La mise en place de cette formule a eu de
bons et de mauvais résultats. Elle a permis de préserver, intacts,
certains aspects de la technique du ballet, qui méritaient vraiment
d'être sauvés et avaient disparu dans le reste du monde. Elle a
aussi permis de garder les danseurs dans les exigences spécialement
requises pour le répertoire Bournonville, et cela a ainsi permis de
sauver ses chefs d’œuvres. Cependant, elle a aussi eu comme effet
nocif de permettre à quiconque ayant mémorisé l'ordre des classes
d'enseigner le «système Bournonville». Un exercice
n'est bon que s'il est dans les mains de celui qui sait comment et
quand en faire usage. Bournonville lui-même soulignait le fait que
ses exercices devaient être mis en pratique «en fonction des
besoins individuels de l'élève».
Donc déjà à ce
moment-là, Erik Bruhn était clairement conscient du danger
existant, quand on essaye de capturer quelque chose, qui a à voir
avec l'art vivant et un travail incessant, de le mettre dans une
forme fixe.
En
ce qui concerne les classes de Bournonville, il est également
important d'être conscient du fait qu'elles sont faites pour des
danseurs professionnels et non pour des élèves, même si pendant de
nombreuses années, au Ballet royal du Danemark, les élèves ont
aussi fait ces classes. Je sais de mon père, Niels Bjorn Larsen, qui
est entrée à l'école du Ballet Royal du Danemark en 1919, que,
durant ses dix années à l'Ecole, lui et tous les autres élèves
pratiquaient tous les jours la classe du matin et ce, de l'âge de
six ans à l'âge de seize ans – et ils faisant toutes les classes
de Bournonville ! Après la barre, les plus jeunes élèves
faisaient seulement les quatre ou cinq premiers exercices, les élèves
un peu plus âgés continuaient en faisant quelques exercices de
plus, et seuls les plus âgés terminaient la classe. A travers cette
répétition constante, physiquement, des mêmes exercices, ils
avaient tous appris à exécuter tous les exercices à la fin de leur
scolarité! On ne procède plus ainsi aujourd'hui et je crois
fortement que ce n'est pas la pédagogie qu'aurait lui-même
recommandée Bournonville! Mais encore une fois, c'est grâce à
cette «méthode d'enseignement» que ces classes ont
survécu et sont devenues une «seconde nature» pour
plusieurs générations de danseurs au Danemark.

A
présent, regardons ces six classes, leur structure, et leur ordre de
succession. Chaque
classe comprend entre vingt-deux (pour la classe du mercredi) et
vingt-cinq (pour la classe du lundi) exercices ; au total cela
fait cent-quarante-deux exercices, certains assez courts, d'autres
très longs. Chaque classe a une certaine structure, conforme aux
deux « mots-clés » de l'enseignement de Bournonville :
l'aplomb et la vigueur. Dans son petit ouvrage, intitulé Un
Cadeau de Nouvel An pour les amateurs de ballet,
celui-ci explique qu'il y a deux qualités techniques principales que
tout danseur doit s'efforcer de maîtriser complètement durant la
classe quotidienne. L'aplomb, c'est préserver, dans tous les
mouvements, une perception claire du centre [de gravité du corps],
en particulier dans les mouvements d'adage. C'est demeurer conscient
du lien entre le corps et le sol, c'est maintenir le centre [de
gravité] constamment dans l'axe vertical de la jambe de terre (on
pourrait aussi nommer cela l'équilibre : Bournonville appelle
la pirouette, qui consiste à tourner autour de son propre centre en
un équilibre parfait, «le triomphe de l'aplomb»). La
vigueur, elle, se réfère à la rapidité et à la précision du
travail des pieds dans les mouvements croisés et battus, lorsqu'on
quitte le sol et que l'on se déplace en l'air. La combinaison de
ces deux qualités permet de pouvoir transférer rapidement le poids
du corps d'une jambe à l'autre et de changer rapidement de direction
au milieu d'une séquence. Bournonville insistait sur le fait que
tous les exercices faits en classe devaient être des exercices
permettant d'améliorer l'une ou l'autre de ces qualités ou la
combinaison des deux.
Lorsqu'on
examine les six classes, on voit que chaque classe débute par trois
ou quatre exercices, qui sont des exercices spécifiques pour
travailler l' « aplomb ». L'exercice n° 1 est ainsi
toujours un adage. Suit l'exercice n° 2, qui est un exercice de
port de bras, en quatrième ou en cinquième position. Lui succède,
dans la plupart des classes, un autre exercice lent pour travailler
l'aplomb : l'exercice n° 3, qui est un andante avec pirouettes.
Les classes du mercredi et du vendredi font exception :
l'exercice n° 3 est constitué d'un enchaînement de pirouettes sur
différents tempi et l'exercice n° 4 propose un type d'adage
différent, plus chorégraphique.
Le
«corps» principal des classes est constitué de
différents exercices impliquant des mouvements allegro. Il y en a de
huit – le mercredi – à treize – le samedi. Les exercices
démarrent de manière plus statique (tendu, fondu, posé chassé et
différentes sortes de pirouettes), avec des mouvements
principalement axés sur l'aplomb, et progressivement, évoluent dans
différentes direction en l'air, de manière à travailler la
«vigueur» (ballonné, sissonne fermée, sissonne
ouverte, échappé, glissades, jetés, petits sauts avec batterie).
Cet
ensemble d'exercices laisse progressivement la place aux grands
sauts, aux grandes valses, mélangés à des pas spécifiques pour
les femmes (allegro rapides avec batterie, exercices spécifiques de
pointes) et pour les hommes (brisé volé, grandes pirouettes,
grandes cabrioles, tours en l'air). Il s'achève par de véritables
variations, pour les hommes et pour les femmes, tirées des ballets
de Bournonville. Certaines sont de ballets connus, comme celles du
Senor dans La Ventana (lundi), de Gurn dans La Sylphide
(mardi) ou la Fête des fleurs à Genzano (samedi), d'autres
viennent de ballets oubliés, qui ne sont plus représentés sur
scène. Cette dernière partie de la classe est composée de huit
(mardi et samedi), neuf (jeudi et vendredi), dix (mercredi) ou douze
(lundi) exercices.
Lorsqu'on
regarde les classes de lundi et du mardi en parallèle l'une de
l'autre, on pourrait être tenté de croire qu'elles ont permuté et
qu'à l'origine, elles apparaissaient dans l'ordre inverse. En effet,
la classe du mardi est à bien des égards beaucoup plus simple. Elle
est, de toutes les classes, la plus «basique» (par ex :
n° 4 - «Tendu»,
n° 5 - «posé chassé», n° 6 et 7 -
«Changement [de pied]et grand plié», n° 11 -
«Sissonne fermée»,
n° 15 «Brisé», n° 19 - «Pas croisé»), tandis que la
classe du lundi est déjà plus élaborée sur le plan chorégraphique
(par exemple : n° 4 - «Tendu et posé chassé», n° 5 «Pirouette avec grand plié», n° 6 - «Rond de jambe sauté avec
pirouettes», n° 7 - «Ballonné», n° 12 - «Pas de polka», n°
18 - «7-step»).

Mais
peut-être Hans Beck a-t-il procédé ainsi tout à fait
intentionnellement, parce qu'il se souvenait que Bournonville voulait
avant tout que la danse soit l'expression de quelque chose. Pour
Bournonville, la danse devait exprimer la joie et l'envie de se
mouvoir en musique avec naturel et avec grâce, et il est bon de se
le rappeler, même en classe. Par conséquent, vous commencez la
semaine par des exercices qui sont plus «dansants»,
mais vous font prendre conscience en même temps de tous les défis
techniques ; vous affrontez ces enchaînements, ce qui vous
permet de revenir le lendemain aux fondamentaux et de travailler
séparément les éléments qui les composent grâce aux exercices
plus élémentaires de la classe du mardi.
Ensuite,
vous êtes davantage préparé à les combiner le lendemain, à la
classe du mercredi, qui est l'une des plus « dansantes »
et chorégraphiques de toutes et où chaque exercice est une petite
danse en soi (exemples : n° 3 - «Pirouettes», n° 6 -
«Ronds de jambe en l'air sauté avec pirouettes», n° 7 -
«Posé chassé», n° 11 - «Dark step», n° 12 - le
«Quatre royal step» [« entrechats 4»], n° 14 - «Grande valse»,
n° 16 - «Grand pas arrière»).
La
classe du jeudi vous ramène à nouveau aux fondamentaux (exemples :
n° 4 - «Posé chassé», n° 5 - «Tendu simple», n°
10 - «Demi-pas chinois», n° 11 - «Ballotté»), dans
une forme néanmoins plus dansante (exemples : n° 6 - «Les
fausses préparations», n° 7 - «Posé chassé avec
pirouettes», n° 8 - «Rond de jambe sauté et sissonne», n° 12 -
«Sissonne et cabriole», n° 16 et 17- «Balloon steps»
[«Ballonés»]).
La
classe du vendredi est un peu atypique et ne participe pas de la
justification de l'ordre des exercices et de la détermination des
règles. Elle est constituée principalement de la chorégraphie
exacte de l'«École de danse», qui forme une
section du ballet de Bournonville, Le Conservatoire. On
pourrait être tenté de dire qu'ici, Hans Beck a choisi la solution
de facilité en se contentant d'emprunter les pas au ballet dans sa
version scénique pour composer l'une des classes hebdomadaires.
Cependant, nous pouvons aussi lui en être reconnaissant, parce que
c'est la manière dont la chorégraphie a survécu – en étant
dansé en classe chaque vendredi! - et c'est ainsi que nous pouvons
encore donner l'«École de danse» tirée du
Conservatoire dans sa version originale, alors que la
chorégraphie du reste du ballet a été perdue.
Cela
fait néanmoins de la classe de vendredi une classe différente dans
sa structure des cinq autres classes, et en ce sens, elle est aussi
plus difficile à catégoriser. Seuls cinq exercices sur les
vingt-trois qui la composent ne sont pas tirés du Conservatoire
(n° 2 - «Port de bras», n° 4 - «Adage», n° 5 - «Equilibres», n°
6 - «Pirouette», n° 8 - «Posé chassé»). En outre, tous
les exercices tirés du Conservatoire constituent des
tentatives délibérées de la part de Bournonville de montrer des
exemples du vieux style français et de l'école parisienne, dans
lesquels lui-même avait été formé durant ses années de jeunesse
à Paris. Ils sont donc davantage un hommage à la source, à partir
de laquelle il a développé plus trad son propre style
caractéristique. Cela contribue à faire de la classe du vendredi
une classe plus académique, d'une certaine manière, avec des pas
très difficiles insérés dans des exercices assez courts, car
lorsque Bournonville a chorégraphié cette section du ballet
Conservatoire, il devait faire entrer une classe entière dans
un passage de quinze minutes.
La
classe de samedi est une intéressante combinaison de pas très
simples (exemples : n° 1 - «Adage», n° 6 - «Pirouette», n°
10 - «Ballonné et rond de jambe sauté», n° 11 - «Saut de
basque et attitude») et d'enchaînements très chorégraphiques,
d'un niveau avancé (exemples : n° 15 - «Petit allegro», n°
18 - «Grand pas espagnol», n° 22 - «Galop», n° 23 - «Big
joking step», n° 24 - «Doorstep»). C'est une classe pour
«reposer l'esprit» d'une certaine manière et permettre au corps de
se souvenir de tout ce qu'il a appris et travaillé durant la
semaine, tous les exercices étant des «variations» sur ces thèmes.
La
majorité des exercices sont composés de pas «unisexes»,
ce qui signifie qu'ils peuvent être réalisés aussi bien par les
femmes que par les hommes, mais il y a toutefois onze exercices qui
comportent une version spécifique pour les femmes une version
spécifique pour les hommes. Le lundi, il s'agit des n° 18 -
«7-step» et le n° 20 - «Charlotte Skousgaard», le mardi, c'est
le n° 15 : «Brisé» (la différence est que les hommes ont
une partie en plus), le mercredi, c'est le n° 14 («Traversé») et
le n° 16 («Grand pas arrière»), et le vendredi, c'est le n° 12
(coupé ballonné et pas jeté avec des conclusions différentes) et
le n° 17 (la cabriole avec différents ports de bras), le samedi, le
n° 12 («La reine») et le n° 14 (la marche solo, où les femmes
ont une partie en plus, que les hommes ne font pas). Le plus souvent,
il s'agit simplement d'une partie de l'exercice qui diffère.
Parfois, il ne s'agit que d'un seul pas, par exemple, les hommes font
un tour en l'air, quand les femmes font un soutenu ou une pirouette.
Comme
signalé précédemment, de nombreux exercices sont composés de
séquences empruntées aux ouvrages chorégraphiques de Bournonville.
Par conséquent, il est très caractéristique que chaque exercice
soit composé de nombreux types de pas différents. Une
simple série d'assemblés ou de jetés n'existe pas dans ces classes
(même pas dans les exercices que j'ai appelés plus «basiques»)
et le pirouettes sont presque toujours préparées ou suivies des pas
sautés, comme un échappé, un jeté, un ballonné, un assemblé, un
changement. Cependant, beaucoup d'exercices comportent des séries de
pas du même type, exécutés dans différentes directions et avec
différents épaulements, par exemple le n° 15 de la classe du lundi
(sissonne fermée en effacé et croisé), le n° 13 de la classe du
mercredi (sissonne attitude avec réception en effacé et en croisé)
et le n° 12 de la classe du jeudi (cabrioles en effacé et croisé).
Certains
exercices, d'une structure similaire, sont répétés dans plusieurs
classes, par exemple le n° 3 des classes des mardi, jeudi et
samedi, qui est un andante avec pirouettes. Cet exercice, toujours en
quatre parties, suit un certain motif : il commence en effacé
devant, puis effacé arrière, ensuite croisé devant, et il se
termine en croisé arrière ; chaque partie se termine sur une
pirouette «signature», toujours dans l'ordre suivant :
attitude en dedans finie à la seconde en face, attitude en-dedans
finie en attitude effacée, attitude en-dedans finie en première
arabesque, et pirouette en-dedans sur le coup de pied finie en relevé
à la seconde (quelquefois, Bournonville l'appelle la pirouette
renversée). Étant donné que ce type d'exercice existe dans trois
des six classes, cela doit indiquer que c'était là un type
d'exercice qu'appréciait Bournonville dans ses propres classes.
Le
n° 3 de la classe du lundi est un peu similaire dans sa structure,
mais il a seulement trois parties au lieu de quatre et et se termine
sur une pirouette finie en première arabesque. Néanmoins, il y a eu
des discussions pour savoir si cet andante en trois parties
appartenait à la classe du lundi ou à celle du mardi, dans la
mesure où la musique peut convenir aux deux, et d'ailleurs, mes
professeurs le faisaient des deux façons. Sur la version qui existe
maintenant en DVD, l'andante en trois parties est rattaché à la
classe du mardi et celui en quatre parties à la classe du lundi. Il
n'empêche que ces deux exercices demeurent très semblables dans
leur structure. Le n° 4 de la classe du mercredi est un adage avec
grand jeté et pirouettes, très différent dans sa structure, et le
n° 4 de la classe du vendredi est un adage beaucoup plus court en
deux parties, sans aucune pirouette. Au total, il y a un choix de
douze exercices d'adage différents dans les classes de Bournonville,
certains sans pirouette, d'autres avec pirouettes, certains très
carrés et académiques, avec des grands pliés, dégagés et
développés (n° 1 des classes de mardi, jeudi et samedi), d'autres
plus chorégraphiés, avec des combinaisons de pas inattendues et
complexes (n° 1 des classes de lundi, mercredi et vendredi, n° 4 de
mercredi).

Il
est intéressant de noter que Bournonville utilise le grand plié
comme un élément important dans les exercices destinés à
travailler l'aplomb, par exemple comme une préparation pour les
pirouettes à partir de la cinquième position (n° 3 et 5 de la
classe de lundi, n° 3 de la classe de mardi) ou pour un changement
de pied (n° 7 de la classe de mardi, n° 5 de la classe de mercredi,
n° 7 de la classe de jeudi). Dans un grand plié, vous êtes obligé
de rester dans le même axe vertical durant le mouvement de descente
vers le sol puis en remontant ; cela en fait un excellent
exercice pour maintenir le centre de gravité au droit des pieds.
Un
autre exercice «signature» est le posé chassé, qui
existe dans les six classes et figure toujours parmi les huit
premiers exercices. Dans le n° 4 de la classe du lundi et les n° 4
et 5 du samedi, le posé chasse est inséré dans un exercice de
tendu, alors qu'il apparaît comme un exercice séparé, très long,
et assez basique dans le n° 5 du mardi et le n° 4 du jeudi. Ces
deux exercices sont développés dans toutes les directions
possible : en face en avant et en arrière, à côté vers la
jambe en avant et vers la jambe en arrière, effacé en avant et en
arrière, croisé en avant et en arrière. Et même, dans l'exercice
du jeudi, dans une direction plus rarement utilisée : épaulé,
le corps en face, les épaules tournées dans un angle au-dessus de
la hanche. Le n° 7 du mercredi est une version intéressante sur le
plan rythmique et plus chorégraphique du posé chassé et dans le n°
8 du vendredi, le posé chassé est combiné avec toutes sortes de
petits sauts et de pas de bourrée rapides.
Beaucoup
d'exercices, tout particulièrement les premiers du milieu (par
exemple, le n° 7 du lundi, les n° 8 et 11 du mardi, les n° 9 et 11
du mercredi) doivent être exécuté avec les bras en position «bras
bas» (position préparatoire), ce qui permet d'accorder une
attention complète à la position des pieds et aux directions et aux
placements des épaules et de la tête (l'épaulement).
Certains
exercices allegro comportent un changement soudain de rythme dans
leur dernière partie (par exemple : le n° 23 du lundi et le n°
11 du mercredi) qui indique que Bournonville devait utiliser ce
«truc» dans ses classes pour faire en sorte que les
danseurs prennent davantage conscience de l'importance de la
musicalité des exercices. La musicalité est un mot-clé dès lors
qu'il s'agit de caractériser le style de Bournonville. La musicalité
va toujours main dans la main avec la technique, car pour exécuter
les exercices avec la musicalité adéquate et le bon phrasé, il
faut d'abord maîtriser les aspects techniques de l'exercice.
Cependant, faire un exercice des classes de Bournonville de manière
correcte musicalement parlant constitue aussi une aide technique pour
le danseur. C'est un paradoxe intéressant inhérent au style et à
la technique Bournonville et c'est en pratiquant les classes que l'on
trouve progressivement le clé de ce paradoxe.
Cet
essai d'analyse de la structure des classes Bournonville étant à
présent terminé, je veux conclure en louant une nouvelle fois la
valeur chorégraphique de cette série d'exercices et la satisfaction
qu'en retire aussi bien le professeur que l'élève en travaillant
sur les détails. On ne cesse jamais d'être impressionné par la
manière originale qu'avait Bournonville d'arranger l'ensemble des
pas. On découvre constamment de nouvelles surprises dans la
composition des pas. La récompense, c'est la joie, qui vient
naturellement, de pouvoir finalement danser ces pas avec l'attention
à tous les aspects qui les constituent ; le phrasé musical et
les accents, la qualité « en clair-obscur » des
combinaisons de pas, les changements de dynamique, les épaulements
et les mouvements des bras sans tension, gracieux et fluides, qui
contrastent avec les mouvements des pieds rapides et précis et
connectent les séries de pas dans des séquences de danse pure.
C'est le cadeau que vous trouvez au fond de la malle aux trésors de
Bournonville.
.
Dinna Bjørn - Texte traduit de l'anglais par Bénédicte Jarrasse

Le
contenu des articles publiés sur www.dansomanie.net et
www.forum-dansomanie.net est la propriété
exclusive de
Dansomanie et de ses rédacteurs respectifs.Toute
reproduction
intégrale ou partielle non autrorisée par
Dansomanie
ou ne relevant pas des exceptions prévues par la loi (droit
de
citation
notamment dans le cadre de revues de presse, copie à usage
privé), par
quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété
intellectuelle.