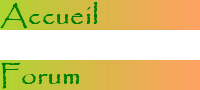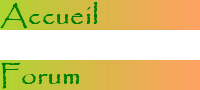Léa Thomasson, Chambéry-Saint-Pétersbourg via Milan et Stuttgart
17 juillet 2017
: Léa Thomasson, la Française du Mariinsky
Du
haut de ses vingt ans, Léa Thomasson, jeune Savoyarde, a
déjà bien roulé sa bosse : Chambéry, Paris,
Milan, Stuttgart, et maintenant Saint-Pétersbourg. Après
un an passé à la prestigieuse Académie Vaganova,
Léa intègre, en septembre 2017,
le «saint-des-saints»
de la danse classique, le Ballet du Mariinsky, où elle est
vraisemblablement la première Française à avoir
été engagée, au moins depuis le début du
vingtième siècle. Avec beaucoup de courage et de
persévérance, surmontant les difficultés
administratives et linguistiques, elle est parvenue à
réaliser son rêve, travailler en Russie, cette Russie qui
représente pour elle «Le» pays de la danse.
Comment êtes-vous venue à la danse? Êtes-vous issue d'une
famille de danseurs?
Non, pas du tout, je
viens d'une famille de musiciens. Dans ma famille, tout le monde fait
de la musique, pas forcément à titre professionnel d'ailleurs, mais
j'ai été baignée dans la musique depuis que je suis toute petite.
Mes parents aiment bien l'art de manière générale, et nous allions
souvent au musée et au spectacle.
J'ai commencé, toute
petite, par la gymnastique. Un jour, ma mère m'a proposé d'essayer
un cours de danse, et je suis allée au Conservatoire National de
Région de Chambéry, chez moi, en Savoie. J'ai d'abord fait de la
danse moderne, car il n'y avait plus de place au cours de classique.
Ensuite, je suis passée dans le cours de classique, d'abord à
Chambéry, puis à Annecy. Quand j'ai eu quinze ans, j'ai voulu
m'investir davantage encore dans la danse, et en plus des cours au
Conservatoire, j'ai pris des leçons dans une école privée
d'Annecy, auprès de Bénédicte Windsor. Elle m'a préparée aux
concours et j'ai passé des auditions dans plusieurs écoles en
Europe. J'ai été admise au CNSMD à Paris et à l'école de
l'English National Ballet. Bénédicte Windsor, admiratrice de
l'école française et elle-même ancienne élève de
l'établissement, m'a conseillée d'aller au CNSMDP. J'y suis restée
un an, c'était au moment où Clairemarie Osta a pris la direction du
Département Danse. Mon professeur était alors Anne Salmon,
l'assistante de Pierre Lacotte.
Pourquoi avez-vous
quitté le Conservatoire un an après?
Tout simplement parce que
j'ai raté mon examen de fin d'année et que je n'ai pas été admise
dans la classe supérieure. Il fallait donc que je trouve autre
chose. Je suis allée faire le stage d'été à la Scala de Milan.
Mes parents avaient des amis en Italie, ce qui a simplifié les
choses. Frédéric Olivieri, qui était le directeur de l'école de
danse de la Scala [il est devenu depuis directeur de la compagnie,
ndlr], m'a repérée et acceptée dans un cours. Il m'a ensuite
proposé d'intégrer l'école en sixième année – le cursus à
Milan en comporte huit. J'ai fait la sixième et la septième année
là-bas. J'ai été admise en huitième année, mais durant les
vacances d'été, j'ai suivi quelques cours à Paris. J'ai rencontré
un Polonais, qui, après m'avoir vu danser, m'a dit que je devrais
m'intéresser à l'école russe, que mon corps pouvait convenir. Il
voulait me présenter directement à des professeurs de l'école
Vaganova, mais celle-ci était fermée hors période scolaire. Il m'a
alors adressée à la John Cranko Schule de Stuttgart, où il y avait
essentiellement des enseignants russes venus du Bolchoï et de Perm.
J'y ai donc pris des cours auprès de Natalia Gasmaeva, elle-même
formée à l'école de Perm. J’ai donc dû choisir, entre rester à
Milan pour finir ma scolarité ou aller à Stuttgart et saisir cette
opportunité de travailler avec les méthodes russes, ce qui a
toujours été une envie ancrée en moi. Je me suis décidée pour
Stuttgart, où j’ai également eu l’opportunité de travailler un
peu avec la compagnie. J’ai même pu faire un peu de corps de
ballet et participer à une soirée mixte composée d’ouvrages de
Cranko. En tous cas ce fut pour moi une belle expérience, une belle
année.

A la Scala, vous ne
travailliez pas avec les méthodes russes aussi?
Non, en fait, à l’école
de la Scala, on enseignait avec la méthode russe à l’époque de
Anna Maria Prina, mais lorsque Frédéric Olivieri – qui est
Français – est arrivé à la direction [en 2006, ndlr], des
changements ont été introduits. Il reste encore trois professeurs
russes, je crois, mais personnellement, j’ai étudié avec l’épouse
de Frédéric Olivieri, qui utilisait en même temps des éléments
de méthode française et de méthode russe. Je ne pourrais pas vous
définir précisément de quelle école son enseignement relevait.
C’est aussi pour cela que je suis partie de Milan, car je voulais
apprendre avec une méthode bien spécifique.
Et la John Cranko
Schule, pourquoi l’avez-vous quittée?
Pourquoi ? Parce que
j’ai eu une proposition pour aller étudier à l’Académie
Vaganova. C’est l’école la plus prestigieuse au monde, et une
telle proposition, ça ne se refuse tout simplement pas. J’avais
suivi des masterclasses là-bas à l’occasion d’un stage, durant
les vacances – non, je ne me repose pas pendant les vacances, je
continue à travailler! - et des professeurs m’avaient
repérée. Ils m’ont dit que je devais me présenter, que j’avais
une chance d’intéresser l’école, et qu’en plus, si je
souhaitais ensuite travailler en Russie, cela me faciliterait les
choses. J’y suis donc restée un an. Après l’examen de fin
d’études, les directeurs de compagnie viennent nous voir, et j’ai
été engagée au Mariinsky.
Qui étaient vos
professeurs à l'Académie Vaganova?
Madame Marina Vassilieva,
qui est une des plus anciennes enseignantes de l’école. Elle a été
le professeur d'Evguénia Obraztsova et de Viktoria Tereshkina,
notamment. C’est elle d’ailleurs qui est la responsable du
département des enseignants. C’est elle que les autres professeurs
viennent toujours consulter s’ils ont des questions sur la
pédagogie.
Quel type de contrat
aurez-vous au Mariinsky, au moins pour vos débuts? CDD, CDI?
J’aurai un contrat d’un
an. En fait, c’est en raison de la date d’expiration de mon visa
de travail. Les permis de travail pour les étrangers ne sont
valables qu’une année, et doivent faire l’objet d’un
renouvellement à chaque fois. La durée du contrat ne peut être
supérieure à celle du visa.
Vous avez vingt ans,
cela n’a pas dû être évident de vous installer ainsi loin de
chez vous, de devoir vous organiser seule, comment avez-vous géré
cela, de manière très pratique?
Déjà, mon éloignement
s’est fait de manière graduelle. D’abord Paris, où j’étais
interne, puis l’Italie, l’Allemagne, j’avais déjà dû
m’adapter à différentes langues, différentes cultures. Donc, la
Russie, ce n’était qu’un pas supplémentaire à franchir, même
si c’était un grand pas. Et c’est ce que je voulais. Aller
là-bas, à l’école Vaganova, c’était mon rêve, et je ne me
suis pas vraiment posée de questions. Une fois sur place, j’ai tout
fait pour essayer d’apprendre le russe au plus vite. Durant l’été,
j’ai étudié la langue toute seule, avec une application installée
sur mon i-pad, j’ai acheté quelques livres. Cela ne m’a
finalement pas paru trop difficile. Une fois à l’école, nous
avions aussi deux cours de russe par semaine. Vous savez, ici, très
peu de gens parlent anglais, donc ou vous apprenez le russe, ou vous
êtes perdu. Tous les cours à l’école sont en russe. Il faut
aller très vite, si on veut profiter au maximum de l’enseignement
qu’on reçoit. Pour moi, il était de toute façon évident que je
devais parler la langue du pays.
Est-ce que l’école
Vaganova vous fournit une assistance pour trouver un logement,
effectuer les démarches administratives?
Pour le logement, il n’y
a pas de problème, car on est à l’internat, qui, de plus, se
trouve dans le bâtiment même de l’école, rue Rossi. Tout était
très bien organisé. En plus, l’école Vaganova est très bien
située, en plein centre de Saint-Pétersbourg, à cinq minutes à
pied de Nevsky Prospekt, la principale avenue de la ville. Tout est à
proximité. Et vivre à l’école Vaganova, c’est quand même
vivre dans un beau château ! Les locaux sont magnifiques.
Qu’est-ce que cela
vous a fait, quand vous avez appris que vous étiez engagée dans
l’une des plus prestigieuses compagnies de ballet classique au
monde?
Mon premier sentiment
quand j’ai appris la nouvelle, ce fut une grande reconnaissance. Je
suis très reconnaissante qu’on m’ait donné une telle
opportunité, que les gens qui m’entouraient, notamment au théâtre,
aient cru en moi. Durant cette année à Saint-Pétersbourg, j’ai
rencontré des gens formidables, dans le milieu de la danse et
ailleurs, et j’ai aussi beaucoup grandi en tant que personne. Aller
au Mariinsky, pour moi, c’est une chose extraordinaire. Je pense
que c’est le meilleur endroit où je puisse être, pour travailler
et m’épanouir en tant qu’artiste.
Est-ce que ce contrat
vous est tombé dessus par surprise, ou est-ce qu’au cours de
l’année scolaire, vos professeurs vous avaient déjà laissé
entendre, compte tenu de vos capacités, que vous aviez une chance
d’intégrer le Mariinsky? Vous ont-ils préparée pour cela?
On ne m’a pas dit
ouvertement que j’avais une chance d'entrer au Mariinsky. Enfin
si, il y a tout de même eu un professeur, une dame, qui m'a demandé
où j'aimerais travailler à ma sortie de l'école. Je lui ai répondu
que je ne savais pas vraiment, mais que je voudrais bien rester en
Russie. « Et pourquoi pas ici ? » me dit-elle. A la
sortie du cours, je suis retournée la voir et je lui ai posé la
question : «Pensez-vous vraiment que je puisse viser
le Mariinsky?» - «Oui, tu en as les moyens, mais
il faut que tu travailles, car l'examen est redoutable». Aucun
autre professeur ne m'a dit : «Tu peux entrer au
Mariinsky», d'autant plus que je suis une étrangère, ce qui
complique les choses : connaissance de la langue, paperasserie
administrative, visa de travail... En plus je venais d'arriver, je
n'ai passé qu'un an à l'école, et ils prennent de préférence
ceux qui ont fait leur scolarité entière là-bas. Il faut vraiment
correspondre au «style Vaganova», et personne ne
pouvait m'assurer que je correspondrai aux exigences du directeur du
Mariinsky. Lors de l'audition, Monsieur Fateev vient lui-même
assister aux épreuves, et il est accompagné de répétiteurs. En
fait, deux ou trois répétiteurs sont venus voir la totalité des
épreuves, et M. Fateev est venu pour les examens de classique.
Quand débute votre
contrat au Mariinsky?
Au premier septembre
2017.
Avez-vous déjà eu
l'occasion de danser sur la scène du Mariinsky en tant qu'élève de
l'école Vaganova?
Oui, j'ai eu cette
chance-là, j'ai participé aux représentations de La Fleur de
pierre, que Youri Grigorovitch a remonté pour le Mariinsky en
novembre 2016. J'ai aussi dansé avec les élèves de l'école dans
Casse-Noisette. J'y ai fait l'une des Dames galantes de l'acte
I, la Valse des flocons et la Danse arabe. Et évidemment le
spectacle de fin d'études, en juin.
Vos parents sont-ils
venus vous voir au Mariinsky?
Oui, ils sont venus pour
le spectacle de l'école.
Vous avez déjà une
idée du spectacle sur lequel vous ferez vos débuts en tant que
danseuse de la compagnie?
Non, mais si vous
regardez le programme de septembre au Mariinsky [Cendrillon,
Carmen Suite, Le Corsaire, Casse-Noisette,
Giselle, La Sylphide ndlr.], vous verrez qu'il y a
tellement de ballets que de toute façon, ce sera quelque chose
d'intéressant. Je pense que cela dépendra de la vitesse à laquelle
je vais apprendre le répertoire.
Comment avez-vous
réussi à vous adapter à des écoles très différentes, à Paris,
au Conservatoire, à la Scala, à la John Cranko Schule…
Passer de la John Cranko
Schule à l’école Vaganova, ce n’était pas bien difficile, car
à Stuttgart, ils n’emploient que des méthodes russes. Donc
l’adaptation n’a pas été compliquée. C’était en revanche
beaucoup moins évident pour moi de passer de la Scala de Milan à la
John Cranko Schule… L’école russe est dure, mais en même temps
c’est ça que je voulais, au fond de moi je rêvais d’aller
danser en Russie. Donc, il fallait que j’en passe par là, et quand
j’ai eu l’opportunité d’intégrer l’école Vaganova, j’ai
presque trouvé cela «naturel», normal. Mais je sais
aussi que j’ai encore beaucoup à apprendre. Je travaille pour
cela, et les choses se font petit à petit.
D’où vous est venu
ce désir d’aller en Russie? Vous avez vu des reportages, des
vidéos sur les grandes compagnies russes (Bolchoï, Mariinsky).
Aviez-vous de la famille en Russie?
Ce sont une multitude de
petites choses qui m’ont donné ce goût. Et c’est vrai que je
trouve les danseuses russes moins froides, plus passionnées qu’en
Occident. Et il y a en Russie une vraie vénération de la danse. On
y vénère les danseurs, comme en Espagne on vénère les
footballeurs. Pour une danseuse classique, la Russie, c’est
vraiment le monde du ballet.
Mon premier contact avec
la Russie, ce fut quand j’étais chez Bénédicte Windsor, à
Annecy, au centre Artys. L’école avait organisé une sorte
d’échange avec un établissement russe, et on avait passé une
semaine à Voronej. Nous avions été accueillis dans des familles
russes. Ce fut une expérience étonnante. La vie en Russie, c’était
très différent de ce que je connaissais alors. Je ne peux pas dire
que je suis tombée immédiatement amoureuse de la Russie. Voronej,
c’est une ville provinciale, c’est quelque part la «vraie
Russie». Saint-Pétersbourg, en revanche, ce n’est pas
«réellement la Russie». C’est une ville plus
européenne, avec des cafés, de nombreux étrangers. Mais Voronej,
ça a été un premier contact, qui m’a permis de voir comment les
Russes travaillaient, avec quelle rigueur, et de comprendre leur
amour pour la danse. Cela m’a poussée, à mon retour, a regarder
des vidéos de l’école Vaganova, des grands interprètes russes.
Et petit à petit, le désir d’aller travailler là-bas s’est
imposé en moi. En Russie, les gens ne comptent pas les heures. A
Vaganova, l’école est ouverte en permanence. Si le dimanche,
l’envie me prend, je peux aller travailler, les studios sont
ouverts sept jours sur sept, de huit heures à vingt-et-une heure.
Rien à voir avec l’expérience que j’ai eue à la Scala par
exemple. En plus, l’école est tellement grande que si, quand on a
un moment de libre, on veut s’entraîner, il y a toujours un studio
de disponible. Tout le monde fait cela ici d’ailleurs. Il y a une
forte émulation, qu’on ne trouve que difficilement dans d’autres
institutions.
Vous êtes, d’après
les recherches que j’ai pu effectuer, la première danseuse
française à intégrer le Mariinsky, au moins depuis le début du
vingtième siècle. Y-a-t-il des artistes russes que vous prenez pour
modèle, ou du moins que vous admirez particulièrement?
Ouliana Lopatkina, c’est
le premier nom qui me vient à l’esprit. Et sinon – j’ai aussi
le droit de donner le nom d’un interprète masculin? –
Mikhaïl Barychnikov.
Vous avez eu
l’occasion de le rencontrer?
Oui, très brièvement, à
Milan, lors d’un spectacle qu’il présentait en tournée.
Avez-vous vu Ouliana
Lopatkina sur scène, au Mariinsky?
Non, comme elle s’est
arrêtée de danser cette saison, malheureusement. A ma liste je
pourrais aussi ajouter Svetlana Zakharova, que j’ai vue à
plusieurs reprises à Milan, où elle était artiste invitée. Olga
Smirnova également, étoile du Bolchoï…
Avez-vous un
répertoire ou un ouvrage qui vous attire particulièrement? Un
rôle que vous rêveriez de danser?
Il y a énormément de
rôles que je voudrais danser un jour. J’aime beaucoup Nikiya, dans
La Bayadère, Giselle également, ainsi que La
Légende d’Amour, de Grigorovitch, que j’ai eu déjà
l’occasion de voir au Mariinsky. Il y a tellement de ballet
magnifiques. Le Mariinsky danse des ballets qu’on ne connaît pas
du tout en Europe occidentale. J’ai fait des découvertes, comme la
version de Spartacus [Léonide Jakobson, ndlr] que possède le
Mariinsky, l’Oiseau de feu – qu’on danse finalement peu
hors de Russie -, Shéhérazade, La Fontaine de
Bakhchissaraï, ou même Roméo et Juliette, avec cette
scène finale extraordinaire, qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
Propos recueillis par Romain Feist
Le
contenu des articles publiés sur www.dansomanie.net et
www.forum-dansomanie.net est la propriété
exclusive de
Dansomanie et de ses rédacteurs respectifs.Toute
reproduction
intégrale ou partielle non autrorisée par
Dansomanie
ou ne relevant pas des exceptions prévues par la loi (droit
de
citation
notamment dans le cadre de revues de presse, copie à usage
privé), par
quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété
intellectuelle.