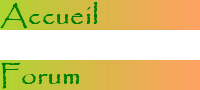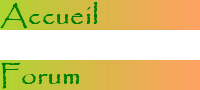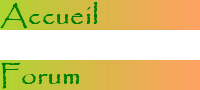 |




|
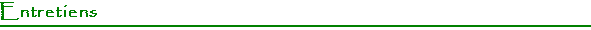
 |
|
|
Jean-Christophe Maillot : remettre La Belle sur le métier
29 décembre 2016 : rencontre avec Jean-Christophe Maillot
En cette période de fêtes de fin d'année, Jean-Christophe Maillot a remis
à l'affiche des Ballets de Monte-Carlo une chorégraphie
déjà relativement ancienne, La Belle, créé en 2001. Pour
autant, il ne s'agit pas d'une simple reprise, mais d'un
remaniement approfondi de la pièce d'origine, pour laquelle de
nouveaux costumes ont été dessinés par
Jérôme Kaplan. Dans une conversation à bâtons
rompus, Jean-Christophe Maillot s'est expliqué sur les
circonstances de cette re-création, et raconte le
déroulement du travail en répétition avec les deux
étoiles du Bolchoï choisies pour assurer les rôles
principaux : Olga Smirnova et Semyon Chudin (voir notre interview : Semyon Chudin : Le Prince de Monaco). Et rendez-vous est déjà repris avec les danseurs moscovites pour 2018.
Jean-Christophe Maillot
Pourquoi
avez-vous souhaité remonter La Belle? Ce ballet occupe-t-il une place
particulière dans votre carrière?
Jean-Christophe Maillot : Ce ballet a effectivement une place particulière. C'est la première pièce qui m'a
permis de raconter, à travers le spectacle, l'idée que je peux me faire du
spectacle. L'acte I revendique le plaisir de la réécriture, tout en conservant
le besoin du divertissement. Il ne s'agit pas nécessairement pour moi de
déstabiliser totalement le public. L'acte II me permet d'explorer ce que j'aime
dans la narration, à savoir la dimension psychanalytique du ballet. Ce genre de
ballet a en effet souvent été conçu pour valoriser la technique classique au
détriment de l'histoire. Dans les versions originales de La Belle au bois
dormant, le conte de Perrault n'est pas amputé, il est carrément coupé en
deux. J'avais donc le souci de raconter une histoire en revenant vraiment à la
source du conte. Quant à l'acte III, je pense que la musique originale de
Tchaïkovski, telle qu'elle a été composée pour le ballet, n'est pas
suffisamment dramatique, suffisamment forte, si l'on veut raconter l'histoire
en en faisant ressortir toute la dimension obscure et effrayante. J'ai donc
pris une autre œuvre de Tchaikovski, son Roméo et Juliette, qui est en
soi une œuvre musicale remarquable, mais sans doute un peu trop courte pour
raconter l'histoire de Roméo et Juliette.
De
manière générale, j'aime l'idée de divertir le public, de lui offrir un
spectacle qui accorde une place particulière à l'esthétique, aux costumes, aux
lumières... Il y a aussi la volonté de trouver les moyens, en conservant la
technique classique, de donner une forme de contemporanéité à un conte et de le
rendre aujourd'hui crédible. C'est un conte de fées, certes, mais il doit y
avoir quelque chose qui relie le public à l'histoire. Le pas de deux du baiser,
en particulier, nous ramène à une forme d'humanité. Cette pièce est importante
pour toutes ces raisons. On a pas mal tourné avec, mais elle est difficile à
emmener en tournée, car elle est assez lourde techniquement. J'ai donc voulu
aussi l'alléger pour lui permettre de retrouver une nouvelle vie.
Il a
fallu que j'accepte l'idée, de plus en plus forte pour moi, que certains
ballets meurent, dès lors que certains danseurs ne les font plus. Ils étaient
tellement liés aux particularités de ces danseurs qu'il m'était souvent
insupportable de les voir continuer à exister sans être magnifiés autrement.
L'idée d'avoir Olga [Smirnova, ndlr.] sur ce ballet a donc été très importante
pour moi. Elle m'a donné envie de le transmettre à nouveau.
Il y a aussi eu le plaisir de changer les costumes.
Philippe Guillotel [créateur des costumes en 2001, les nouveaux costumes sont
signés de Jérôme Kaplan, ndlr.] avait fait à l'époque de la création un travail
formidable, mais ses costumes étaient très liés aux années 90, à toute cette
esthétique à la Decouflé, et j'avais envie de quelque chose de plus élégant, de
plus lissé, mais aussi de plus explicite pour donner à voir la confrontation
des deux univers qui composent le ballet. La Belle, c'est la rencontre
de deux mondes : le monde du Prince, emprisonné, très anguleux, et celui
de la Belle, extrêmement coloré, tout en rondeurs. Le Prince n'a pas été aimé
du tout par sa mère, la Belle, elle, l'a trop été, et pour l'un comme pour
l'autre, il s'agit de se libérer du poids de leur éducation.
L'histoire
de La Belle n'a plus grand chose à voir avec celle de La Belle au
bois dormant que l'on connaît à travers le ballet classique. J'ai lu dans
le programme tout le mal que vous pensiez des livrets de ballet, qui lissent
l’œuvre dont ils sont tirés...
La
plupart des livrets, oui. Disons que si l'on revendique l'héritage d'une œuvre
littéraire, il faut aller à la source. On ne peut pas continuer à faire
aujourd'hui La Belle au bois dormant en ne tenant pas compte de la
véritable histoire. Ce qui est effrayant, c'est qu'on vide le conte de son sens
fondamental, à savoir la dualité entre le mal et le bien. On le réduit et on en
fait quelque chose d'accessoire. Au XIXe siècle, cela faisait sens, parce que
le ballet était là pour mettre en avant une écriture chorégraphique. L'exigence
intellectuelle de l'époque n'est pas non plus la même qu'aujourd'hui. Moi
j'essaye de raconter vraiment l'histoire et pourtant j'ai la pudeur de ne pas
appeler ça La Belle au bois dormant.
Sur
le plan chorégraphique, le ballet a-t-il beaucoup changé depuis sa création et
change-t-il aujourd'hui en fonction de ses interprètes [la reprise de
décembre 2016 comprend trois distributions, ndlr.]?
L'écriture
chorégraphique ne change pas, mais mon écriture chorégraphique appartient
tellement aux danseurs qui ont dansé et dansent le ballet... Je clame toujours
haut et fort que si mes ballets sont mal dansés, ils n'ont aucun intérêt. Pour
moi, si je n'ai plus la distribution originale, le ballet, dans l'absolu, ne
devrait même plus exister, même si j'accepte l'idée que les gens voient trois
distributions et préfèrent même celle qui n'est pas originale. Mais en ce qui
me concerne, la distribution originale est celle qui fait naître le ballet, et
c'est la seule et l'unique. Après, on court après. Il faut donc accepter de
s'en détacher.
Lisa
[Lisa Hämäläinen, interprète
de la deuxième distribution, ndlr.] a un parcours passionnant : elle a mis
cinq ans pour arriver à une forme de maturation. Il y a quelque chose de
formidable en elle. Sa Belle est beaucoup plus fragile, mais elle a une
plastique tellement incroyable que ça nourrit le ballet. Chez Victoria [Victoria
Ananyan, interprète de la troisième distribution, ndlr.], il y a une maturité
beaucoup plus forte, qui durcit un peu le personnage. A chaque fois, il y a des
choses que j'accepte... Ce ne sont pas forcément des choses que je trouve
justes, mais c'est ça le propre d'une compagnie de danse. On est dans du
spectacle vivant, et il n'y a pas, en fin de compte, d'unanimité ou de vérité
sur une œuvre chorégraphique par rapport aux interprètes. La différence
notable, c'est que dans la distribution avec Victoria, c'est une femme, Maude
Sabourin, qui danse le rôle de Carabosse, alors que dans les deux autres
distributions, c'est un homme. Ce rôle, je l'avais pensé pour un homme, mais
Maude s'est imposée lors d'une répétition. Son androgynie et son ambiguïté
servent le personnage. Ce qui est merveilleux dans une troupe, c'est de tenter
des aventures différentes autour d'un répertoire qui est le même. C'est ce qui
fait qu'une œuvre de Mozart est jouée éternellement par des musiciens
différents. J'aime beaucoup l'image de ces violonistes qui s'approprient un
violon pendant trente ans puis le passent à un autre. En plus, il y a 80% des
danseurs qui n'avaient jamais dansé le ballet. C'est une chance extraordinaire
d'avoir des œuvres qui ont été créées il y a quinze ou vingt ans, qui restent
d'actualité et sont toujours là pour nourrir un répertoire, ici ou ailleurs. Ce
patrimoine chorégraphique est un trésor qu'il faut absolument protéger.
J'avais
envie aussi à un certain moment de ne plus m'obliger à créer, sous prétexte que
c'est quelque chose que l'on attend. Je n'en avais ni l'envie, ni la force, ni
le désir. En revanche, j'avais envie de revenir sur cette pièce, de réviser une
grande partie du premier acte, toute la partie de la valse, qui ne me plaisait
pas sur le plan chorégraphique. Il y a des petits détails qui paraissent
anodins aux yeux de certains, mais sont fondamentaux à mes yeux, car je
n'arrivais pas à m'expliquer la narration, comme par exemple, le fait que le
Prince reçoive la couronne de Carabosse au moment où il part à la guerre. Pour
moi, la manière dont je le racontais n'était pas assez claire. Là, il y a
quelque chose qui s'éclaircit. Finalement, c'est comme travailler une toile
dont on s'aperçoit au bout de quelques années, si on la passe aux rayons X,
qu'elle comporte dix ou douze couches de peinture. Mais peut-être que le
tableau n'est jamais fini... Je pense que c'est important d'entretenir ça.
L'année prochaine, on part en tournée avec La Belle, le Lac, Cendrillon,
Roméo et Le Songe, donc cinq pièces narratives faites dans la
compagnie, qui sont régulièrement demandées à l'étranger. Chaque année, j'ai
une compagnie qui se renouvelle et ne répond pas aux mêmes attentes. Il y a
donc ce besoin en permanence de les remettre en vie avec les gens qui sont présents.
Quel
rôle ont joué Olga Smirnova et Semyon Chudin dans votre désir de remonter La
Belle?
La
reprise de cette Belle est d'abord liée à elle - Olga. J'avais envie de
remonter La Belle et Olga était celle qui me donnait envie de remonter
le ballet. Je la voulais dans ce ballet, comme je la veux en Juliette. Semyon,
c'est un danseur avec qui j'avais déjà travaillé. Je l'apprécie énormément sur
le plan humain. Très peu de danseurs sont venus me voir pour me demander de
danser mes pièces. C'est arrivé à une époque avec des danseurs de l'Opéra, mais
je leur avais dit non. Peut-être que les gens ont cru que je disais toujours
non. Semyon, lui, est venu me voir pour me dire qu'il voulait travailler avec
moi. Après, il ne s'agit pas simplement de faire quelque chose ensemble, il
faut trouver un rôle. Il aurait aimé que je l'invite l'an dernier sur Casse-noisette.
Semyon, ce n'est pas non plus un pur produit Bolchoï, il a dansé en Corée, à
Zurich, il a voyagé, vu pas mal de choses... Au Bolchoï, les danseurs ont des coachs
privés, des gens souvent assez âgés et pas forcément en relation avec le monde
d'aujourd'hui. Ils travaillent dans ce cocon fermé et quand ils arrivent ici...
c'est une respiration. Ils ont envie de
vivre des choses plus fortes, humainement parlant, détachées de la pression
qu'ils vivent au Bolchoï. D'ailleurs, Semyon a mis du temps à respirer ici. Quand
j'ai pensé à la Belle pour Olga, c'est Semyon qui m'est apparu comme le
personnage idéal pour le Prince. C'est sur ce rôle-là qu'il me semblait pouvoir
explorer et révéler les choses les plus intéressantes. Il a accepté tout de
suite. Ça a pris du temps, parce qu'il fallait les libérer de leurs obligations au Bolchoï, notamment
Semyon, qui fait les Casse-noisette en décembre, ce qui n'est pas le cas d'Olga.
 Semyon Chudin et Olga Smirnova dans La Belle (chor. J-C. Maillot) Semyon Chudin et Olga Smirnova dans La Belle (chor. J-C. Maillot)Le
parcours d'Olga, depuis Casse-noisette,
est énorme dans la quête de
liberté. Quand on sait d'où elle vient, quand on sait
qu'au Bolchoï, elle était une danseuse
réputée
froide...Je l'ai rencontrée sur La Mégère, elle avait
vingt-deux ans. Elle prend aujourd'hui le risque de vaciller. Elle n'ose pas encore
être laide. Dans l'acte III, elle est encore trop policée, trop
gentille. La Belle est une femme qui a été violée, maltraitée, et elle doit
faire faire peur à ce moment-là, montrer davantage de force et de physicalité
face à Carabosse. J'ai une passion pour cette fille qui me rappelle beaucoup
Bernice dans sa manière de complètement s'immerger dans ce qu'elle fait et d'y
réfléchir. Elle n'a pas la même folie ni la même maturité que Bernice au même
âge, mais il y a une
telle intelligence
dans son corps. C'est aussi quelqu'un de très à
l'écoute. C'est pour moi une
relation de travail sur le long terme. Je ne vais pas la perdre, car je
vois
quelque chose en elle qui se développe. Il y a des moments dans
la danse où
elle arrive vraiment à s'oublier et à vivre ce qu'elle
est en train de faire.
Ce qu'elle fait là, ce sont aussi des choses qui peuvent changer
un peu sa
manière d'aborder le classique. Qu'une fille de vingt-cinq ans
ait envie de
découvrir autre chose que son seul univers, je trouve ça
bien. Bien sûr que son
monde, c'est le ballet classique, et il faut qu'elle y reste, mais elle
veut le nourrir avec autre chose, en l'occurrence cette relation avec
un
chorégraphe, qui nous enrichit mutuellement.
Je n'ai jamais invité personne dans la compagnie en
vingt-cinq ans. Inviter quelqu'un, ça voulait dire renier les danseurs avec
lesquels je travaillais. Tout ça est délicat à dire, mais quand on chorégraphie
depuis trente ans, on a plus d'attentes, plus d'exigences dans le travail. Je
n'ai plus le temps d'apprendre aux danseurs à devenir quelque chose, j'ai
besoin de travailler avec des outils déjà là. Olga a une telle maîtrise
technique et un corps tellement discipliné qu'il traduit immédiatement ce que son
cerveau a assimilé. Il y certains moments où son corps la domine encore un peu.
Il faut maintenant qu'elle trouve le parfait point d'équilibre entre le corps
et l'esprit, qui fait que l'un n'est plus en concurrence avec l'autre. Elle est
en train de chercher et elle est en train de trouver. Je commence donc à
envisager la possibilité pour elle d'un contrat de guest permanent.
J'aimerais maintenant qu'elle revienne pour faire mon Roméo et Juliette
avec Artem [Ovcharenko, ndlr.].
Et vous, quand retournez-vous au
Bolchoï?
Ce
sera en octobre 2018 pour Don Juan. Je travaille actuellement sur le
livret avec Jean Rouaud. Et ça se fera sur une musique de Bach.
Propos recueillis par Bénédicte Jarrassse.
Olga Smirnova dans La Belle (chor. J-C. Maillot)
Le
contenu des articles publiés sur www.dansomanie.net et
www.forum-dansomanie.net est la propriété exclusive de
Dansomanie et de ses rédacteurs respectifs.Toute reproduction
intégrale ou partielle non autrorisée par Dansomanie
ou ne relevant pas des exceptions prévues par la loi (droit de
citation
notamment dans le cadre de revues de presse, copie à usage
privé), par
quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété
intellectuelle.
Entretien
réalisé le 29 décembre 2016 - Semyon Chudin © 2016,
Dansomanie
|
|
|