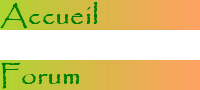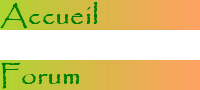Vous
avez été le dernier partenaire d'Yvette Chauviré. Que vous inspire d'emblée la
disparition de cette grande figure de la danse?
Les Français ont la mémoire
courte. On en discutait hier encore avec Pierre Lacotte. C'est incroyable que
les médias n'aient pas porté davantage d'attention à la disparition d'Yvette
Chauviré. Quand on voit de qui l'on parle et ce que l'on a dans la presse... On
nous rebat les oreilles à propos de telle ou telle star à la mode, et là, une
femme de la stature d'Yvette Chauviré disparaît, elle qui fut l'un des piliers
de l'Opéra et l'une de nos plus grandes danseuses, connue dans le monde entier,
et on en parle à peine... Mais c'est le reflet de ce qu'est devenue la France.
A côté de ça, en Russie, Vladimir Vassiliev, quand il a appris la nouvelle, m'a
appelé dans l'heure. Il était très affecté.
Quel fut votre premier
contact avec Yvette Chauviré?
J'étais un jeune danseur
étoile, et je venais de danser ma première Giselle, avec Lyane Daydé
pour partenaire. C'était en 1965. Ce n'était pas à l'Opéra, mais au Théâtre de
l'Alhambra, qui n'existe plus aujourd'hui. On avait donné cette Giselle
avec une compagnie qui s'appelait le Grand Ballet Classique de France, dirigée
par l'imprésario Claude Giraud, époux de Lyane Daydée. Certaines
représentations devaient aussi avoir lieu à Rouen, au Théâtre des Arts. Lyane
Daydée alternait avec Yvette Chauviré dans le rôle-titre. Suite à une
défection, Yvette Chauviré s'est retrouvée sans partenaire. Elle voulait
travailler avec un danseur sûr, possédant une certaine expérience, pas avec un
débutant qu'elle aurait dû former. Sachant cela, Lyane Daydé m'a un peu
« pistonné », autrement dit recommandé, auprès d'elle. Mes premiers
pas dans Giselle aux côtés d'Yvette Chauviré ont donc eu lieu au Théâtre
des Arts de Rouen. Ensuite seulement, j'ai dansé le ballet avec elle à l'Opéra
de Paris. Nous avons aussi dansé ensemble le Grand Pas classique, de
Victor Gsovsky, qu'elle avait créé avec Wladimir Skouratoff. Bien plus tard,
elle a tenu une conférence « dansée » à l'Opéra Bastille, dans
laquelle elle montrait la chorégraphie de Giselle, avec la participation
de Clairemarie Osta et Benjamin Pech. Elle était toujours aussi extraordinaire.

Qu'avez-vous ressenti la
première fois que vous vous êtes retrouvé partenaire d'Yvette Chauviré?
Vous
savez, quand vous êtes un jeune danseur, et qu'on vous dit que vous allez
danser avec la Chauviré... En fait, je n'ai pas gardé un souvenir très précis
des représentations de Giselle au Théâtre des Arts de Rouen, même si
cela s'était bien passé. Le souvenir le plus marquant pour moi, ce fut lorsque
nous avons remonté Les Mirages de Serge Lifar, en 1966 je crois. Les
circonstances étaient très particulières. Il n'y avait plus personne à l'Opéra
en mesure de transmettre le rôle du Jeune homme [rôle masculin principal du
ballet, ndlr.]. Ce pauvre Michel Renault, qui l'avait créé en 1947, était alors
plus ou moins interdit de séjour au Palais Garnier. Avec Lyane Daydée, il avait
intenté un procès à l'Opéra de Paris pour licenciement abusif, procès qu'il
avait gagné, et donc, la direction lui en voulait beaucoup. Il en était de même
pour Serge Lifar, lui aussi persona non grata. Lifar m'avait dit
alors : «si tu veux, je te fais travailler en dehors de l'Opéra, mais en
aucun cas à l'Opéra». En fait, il ne se souvenait plus vraiment de sa propre
chorégraphie. Flemming Flindt, qui avait lui aussi dansé Les Mirages,
était parti à Copenhague, et n'était pas disponible. Il ne restait donc plus
grand monde pour faire travailler la pièce, et c'est grâce à Léone Mail, sa
répétitrice, et à Yvette Chauviré, que nous avons pu reconstituer Les
Mirages. Il y avait bien quelques fragments de films 8mm tournés par Léone
Mail, mais il manquait tout de même une partie de la chorégraphie. Et c'est
Yvette Chauviré qui m'a ainsi tout appris. C'est avec elle vraiment qu'on a pu
re-créer les Mirages.
Chauviré, c'était d'abord une grande artiste, une
grande interprète, même si, évidemment, elle avait des bras formidables, un dos
extraordinaire... C'était quelqu'un qui interprétait ses rôles, que ce
soit dans Les Mirages ou dans Giselle. Après le gala qui avait
été donné en 1998 à l'Opéra, à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire,
j'avais été interviewé par Eve Ruggieri. Je lui avais dit : «pour moi,
Yvette Chauviré, c'est la Reine Christine, c'est Greta Garbo. Il y a
d'ailleurs beaucoup de ressemblance». Quand elle me faisait travailler le rôle
du Prince Albert [Albrecht, Giselle, ndlr], elle me faisait toujours
penser à ce film avec Garbo. Garbo y campait une femme dissimulée sous un
costume masculin. Et quand Chauviré me montrait les déplacements, les
cheminements sur scène du Prince Albert – d'une manière extraordinaire -, je
voyais littéralement Greta Garbo dans La Reine Christine.

Quelle
version de Giselle dansiez-vous lors de cette première fois?
C'était
la version de Lifar. Chauviré avait elle aussi remonté une Giselle,
celle de Gert Reinholm, qui était à l'époque directeur du ballet de la Deutsche
Oper de Berlin. Je suis allé, à la demande de Chauviré, plusieurs fois à Berlin
pour danser sa Giselle. Elle avait notamment voulu que je sois le
partenaire d'Eva Evdokimova, alors toute jeune étoile, pour ses débuts dans le
rôle-titre. Il me semble d'ailleurs que cette version «Chauviré» de Giselle
figure toujours au répertoire du ballet de la Scala de Milan.
Quand Michel Descombey est devenu directeur du
Ballet de l'Opéra de Paris, en 1962, il a réintégré, dans Giselle, le
pas de deux des Vendangeurs, qui est ensuite devenu un pas de dix dans la
version Alonso. Mais dans ses grandes lignes, la chorégraphie de Giselle
ne varie pas tant que cela d'une version à l'autre. Il y a le poids de la
tradition, et l'on ne peut pas vraiment faire autre chose. Néanmoins, Descombey
voulait quelque chose d'un peu nouveau, et il avait confié à Yvette Chauviré la
réalisation du second acte de Giselle. C'était une splendeur. Je me
souviens que Claude, mon ex-épouse, qui était à l'époque dans le corps de
ballet, était émerveillée. Chauviré avait une façon particulière de montrer les
personnages : Giselle, Myrtha, les deux grandes Wilis... Cette version a
tenu l'affiche assez longtemps. Mais quand John Taras a succédé à Descombey [en
1969 ndlr], ça a changé. Je connaissais déjà assez bien Taras, qui allait
remplacer Reinholm à la Deutsche Oper. Yvette Chauviré l'avait invité à
déjeuner pour essayer de savoir s'il allait conserver «sa» Giselle. Il
ne lui a rien dit, mais finalement, il a voulu refaire une mise en scène. Ça a
été une grosse déception pour Yvette. Et ce deuxième acte remonté par Chauviré
a donc disparu. Mais c'est tout de même cette version que nous avons dansée
pour ses adieux. Après, d'autres versions se sont succédé à l'Opéra de
Paris : celle de Patrice Bart, bien sûr, et aussi celle d'Alicia Alonso,
qui était excellente. J'étais même parti à La Havane pour la danser avec elle.
C'est Youli Algaroff qui m'avait recommandé pour être son partenaire. Alonso
voulait «tester» la chorégraphie chez elle, à Cuba, avant de la monter à Paris.
Ça s'est très bien passé, et après, j'ai dansé cette version à Paris, notamment
avec Josefina Méndez [étoile du Ballet National de Cuba, ndlr.], qui avait été
invitée en France pour faire Giselle. C'était vraiment une très belle version et j'avoue que je ne comprends
pas pourquoi, chaque fois qu'il y a un changement de direction, on veut changer
tout ce qui a été fait auparavant. Comme cela, on jette aux oubliettes des
choses magnifiques.

En-dehors de Giselle,
quels sont les ouvrages les plus marquants que vous avez dansés avec Yvette
Chauviré?
Les
Mirages. Indiscutablement. Malheureusement, c'est une œuvre qui n'est pas
donnée très souvent. Elle a tout de même été remontée encore du vivant de Lifar
et de Michel Renault [cf. supra, ndlr]. Lorsque je l'ai reprise avec Chauviré,
Michel Renault m'a dit qu'il y avait des petites différences avec la création,
mais il m'a laissé faire.
Lorsque
Les Mirages a été donné à l'Opéra de Paris en 2006, a-t-on fait appel à
vous ou à Yvette Chauviré?
Non,
on ne m'a rien demandé. A propos des Mirages, je me souviens que le
ballet avait été mis à l'affiche de l'Opéra de Lille, à l'initiative de Willy
Cerullo, qui était maître de ballet là-bas. Nous avions été invités, Yvette et
moi, pour une représentation. Après le spectacle, il y a eu un dîner assez
mémorable, en présence de Lifar et de Henri Sauguet, le compositeur. Il ne
manquait que Cassandre, qui avait dessiné les décors. C'est dommage qu'il n'y
ait pas eu de caméras de télévision pour immortaliser cette soirée. Lifar
parlait beaucoup, et racontait des anecdotes sur la première. Et régulièrement,
Sauguet lui donnait une tape sur l'épaule et lui glissait à l'oreille :
«mais non Serge, ce n'est pas comme cela que ça s'est passé!».
Serge
Lifar a toujours vénéré Yvette Chauviré. Elle avait pris sa défense lors de son
procès en épuration, en 1945, et il lui en était reconnaissant. Mais elle a
toujours été aussi l'une de ses interprètes privilégiées. L'une de ses autres
égéries était Liane Daydé, à qui il avait donné le rôle d'Aricie dans Phèdre,
alors qu'elle n'avait que quatorze ans. Lifar était un visionnaire, il avait
l’œil pour identifier ceux qui avaient du talent. Il faut dire que le corps de
ballet, dans l'immédiat avant-guerre et dans l'immédiat après-guerre, n'avait
absolument pas le niveau de qualité qu'il a maintenant. Il comptait une
cinquantaine de personnes, qui n'avaient ni les capacités, ni les moyens
d'aujourd'hui. Des personnalités telles que Chauviré se distinguaient d'autant
plus.
Un
jour, Yvette Chauviré m'avait invité à l'accompagner à l’Élysée, pour une
remise de décoration. Il s'agissait d'une promotion de la Légion d'honneur,
dans laquelle il y avait aussi Michèle Morgan et Charles Trenet. J'étais dans
un petit salon avec Yvette Chauviré. Soudain, le Président de la République
[Jacques Chirac, ndlr] entre, et je l'entends encore s'exclamer : «Ah! Je vais
faire un câlin avec Yvette»! Il s'assoit à côté d'elle, et elle lui dit :
«Monsieur le Président, j'aimerais vous présenter mon dernier partenaire, Cyril
Atanassoff». «Ah bon!». La réaction d'Yvette Chauviré était incroyable :
c'était elle qu'on honorait ce jour-là, moi je n'avais qu'une importance
secondaire. J'étais son partenaire, c'est un fait, mais la personne la plus
importante, c'était elle. Et pourtant, elle a eu ce réflexe de gentillesse
envers moi pour me présenter au Président. D'ailleurs, ensuite, je me suis un
peu entretenu avec lui, étant donné que j'étais un amoureux fervent de sa Corrèze.
J'y avais appris à pêcher la truite dans les années 1968-1969. [Jacques Chirac]
m'a regardé et m'a dit : «Alors, comme ça, vous êtes un pêcheur de
truite?» - «Oui, Monsieur le Président!». Nous avons échangé quelques
souvenirs, nous connaissions tous deux le curé de Tarnac, Georges Blaise [? orthographe incertaine, ndrl]...
Je me
rappelle aussi de spectacles que nous donnions au Palais de l’Élysée. Il y
avait une toute petite scène, dont le Général De Gaulle se servait pour y tenir
ses conférences de presse. Avec Yvette, nous y avons absolument tout dansé.
Tout le corps diplomatique était présent à ces représentations, et à la fin,
nous nous mettions en rang devant la scène et le Général De Gaulle venait nous
féliciter et nous remercier. Il y avait aussi des ministres : Jacques
Chaban-Delmas, Maurice Couve de Murville... Le chef du protocole annonçait les
noms des invités, au fur et à mesure de leur arrivée, mais De Gaulle allait
directement vers Yvette Chauviré. Il lui prenait les mains et s'entretenait
avec elle. Il avait une admiration sans bornes pour elle. Cela vous donne une
idée de ce que représentait alors cette danseuse en France et dans le monde.
C'était vraiment LA star.
Aujourd'hui, le regard s'est un peu détourné de la
danse. Il faudrait déjà une grande star, très médiatisée, comme Nouréev, pour
que l'Opéra de Paris redevienne une sorte d'épicentre de la danse. Certes, il y
a eu Benjamin Millepied, mais c'est quand-même surtout Natalie Portman [son
épouse] qui a attiré l'attention. Aujourd'hui, si des danseurs à l'Opéra font
sérieusement leur travail, ils assureront leur carrière, ils seront appréciés
de leurs professeurs et des balletomanes, mais c'est tout. Pour être reconnu,
même par les gens qui ne viendront jamais à l'Opéra de Paris, il faut être un
phénomène médiatique, comme Monsieur Nouréev.
Avez-vous
gardé contact avec Yvette Chauviré, après ses adieux «officiels» à la scène en
1972?
Oui bien sûr. Je la voyais
souvent. Elle revenait fréquemment à l'Opéra. Rudolf Nouréev l'avait appelée
pour faire le rôle de la Reine dans Raymonda. Elle donnait également des
cours de style aux danseurs.
Vous
avez dansé Raymonda avec Yvette Chauviré en Reine?
Non.
J'ai dû faire Abderam en troisième ou quatrième distribution. Je n'étais pas en
très bons termes avec Rudolf Nouréev, et je ne me suis jamais retrouvé sur
scène en même temps qu'Yvette. En tous cas, dans ce rôle, elle conservait une
aura extraordinaire.
Quand
avez-vous vu Yvette Chauviré pour la dernière fois?
Ce fut un peu un regret.
Cette maladie dont elle était atteinte... enfin, je ne suis pas médecin.... La
dernière fois que je l'ai vue, c'était avec Eriko Arima [pianiste à l'Opéra de
Paris, ndlr]. La mère d'Eriko Arima – originaire de Kyoto -, avait demandé à
Yvette Chauviré d'être la directrice artistique de son école de danse. L'école
organisait fréquemment des spectacles avec des danseurs professionnels invités,
japonais ou français. Eriko venait donc très souvent lui rendre visite. Il y a
à peu près quatre ans, Eriko et moi avons décidé, d'un commun accord, d'aller
voir Yvette Chauviré chez elle . Nous avions prévenu Anne Bergeron [dame
de compagnie d'Yvette Chauviré, ndlr] – une femme extraordinaire, qui s'est
occupée d'elle jusqu'à la fin. Quand je suis arrivée chez Yvette, j'ai eu un
choc. Je pensais qu'en lui parlant, elle allait cligner des yeux, opiner de la
tête... Mais elle n'était plus là. Ce n'était plus ma Yvette, ce n'était plus
ma Greta Garbo, elle avait les cheveux tout blancs... Je me suis dit, il faut
que je garde un bon souvenir d'elle, celui des dialogues que nous avons eus,
les moments que nous avons vécus ensemble. Après, je me suis confié à Pierre
Lacotte, et finalement, j'ai regretté de ne pas être allé la revoir plusieurs
fois. Même si nous, nous avions l'impression qu'elle ne comprenait plus ce qui
se passait autour d'elle, qui peut savoir vraiment ce qu'elle ressentait?
Peut-être ne pouvait-elle pas réagir par un sourire, par un clignement des
yeux, mais peut-être aussi percevait-elle tout de même certaines choses? Je me
disais : «retourne voir Yvette, retourne voir Yvette», et je remettais à
chaque fois cela au lendemain. Et puis, Claude Bessy m'a téléphoné pour
m'annoncer son décès. C'est ainsi. On ne peut pas revenir en arrière. Après, je
me suis longuement entretenu avec Anne Bergeron, mais on ne sait pas exactement
comment Yvette s'est éteinte. Ses obsèques se feront en tout petit comité, mais
une messe devrait être dite à l'église Saint-Roch dans le courant du mois de
novembre [information confirmée depuis : le service religieux aura lieu le
21 novembre 2016 à 10h00, ndlr]. Cela en étonnera peut-être certains, mais j'ai
toujours pensé qu'Yvette était croyante. Je l'avais invitée pour le baptême de
ma fille – qui n'a pas arrêté de pleurer durant toute la cérémonie, à l'église
Saint-Roch, justement. Il y avait ensuite une petite réunion privée dans le
studio que nous habitions avec mon ex-épouse, et Yvette était venue en
compagnie du Père Saint-Estève [?], et elle conversait tout le temps avec lui.
C'est pour cela que quand on dit qu'elle n'était pas croyante... Pour Pierre Lacotte, si, elle était croyante,
mais non pratiquante, comme beaucoup de chrétiens.

Que s'est-il passé dans
votre esprit quand Claude Bessy vous a annoncé la disparition d'Yvette
Chauviré? Vous vous y attendiez?
Je pensais qu'elle était
immortelle! Mais cela devait arriver, elle aurait eu cent ans dans quelques
mois. C'est en soi déjà assez extraordinaire. Cela faisait plusieurs années
qu'elle était très malade, mais elle était entourée d'anges. Elle était déjà
parmi les anges. Elle ne paraissait pas souffrir. Elle était radieuse. Je ne me
rappelle plus exactement quand j'ai pu avoir une conversation cohérente avec
elle pour la dernière fois. C'était peut-être il y a quelques années,
lorsqu'elle faisait répéter le Grand Pas classique [Gsovski / Auber] à
des danseurs de l'Opéra à l'Amphithéâtre Bastille. Mais je ne saurais plus vous
dire précisément quelle fut notre dernière conversation. Sinon, bien sûr, il y
avait eu le fameux gala pour son quatre-vingtième anniversaire, au Palais
Garnier [10 février 1998, ndlr]. Mais c'était son spectacle, elle était
entourée d'un tas de gens, et je ne lui
tenais pas la main! Je n'étais que le spectateur de cet hommage qu'on lui
rendait.
Qu'avait-elle de si
remarquable, au point de devenir l'une des plus grandes danseuses françaises du
vingtième siècle?
C'est
difficile à expliquer. C'est un peu magique. La danse, bien sûr, ce sont des
moyens physiques : un galbe, des bras, des jambes... mais il n'y a pas que
cela. En fait, c'est justement dans les moments où elle n'exécute pas un
mouvement que la danseuse est présente ou n'est pas présente. Et Yvette, elle,
était toujours là. Qu'elle soit assise sur un trône ou qu'elle fasse des
fouettés, elle était là. C'était une harmonie, elle était bien dans l'espace,
resplendissante. Voilà, c'est le côté magique d'une grande artiste.
Le
plus beau souvenir que je garderai d'elle, c'est la dernière fois qu'elle a
dansé La Mort du cygne. C'était à l'Opéra de Paris, en 1972. Il n'y a eu
que deux représentations. C'était très émouvant. C'est vrai, Yvette a joué les
prolongations. A l'Opéra, elle a dansé jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.
Mais si elle l'a fait, c'est qu'elle le pouvait. Elle pouvait encore danser et
interpréter La Mort du cygne. Elle apportait énormément. Il fallait voir
cela, quand elle faisait travailler La Mort du cygne à Dominique
Khalfouni ou à Monique Loudières! C'était la quintessence, l'incarnation
absolue de cette Mort du cygne.
Quelles
sont les «filles spirituelles» d'Yvette Chauviré à l'Opéra de Paris?
Question
délicate! Dominique Khalfouni, Monique Loudières donc, Noëlla Pontois aussi. Ce
sont des danseuses qui ont elles aussi marqué leur époque, mais qui ne sont pas
des fac-simile, des «copies» d'Yvette Chauviré. Elles ont reçu d'Yvette
une éducation. C'était un peu comme une psychanalyse. Yvette parlait
énormément. Elle disait, elle expliquait. C'est elle qui m'a expliqué le rôle
du Prince Albert [aujourd'hui rebaptisé Albrecht, ndlr], pourquoi il agit comme
ceci ou comme cela... Elle analysait les rôles. C'était peut-être de
l'instinct, elle ne faisait pas de recherches, mais elle apportait énormément,
non seulement aux danseuses, mais aussi aux danseurs.

Et
donc, elle aurait aussi eu des «héritiers» masculins?
En
tout cas, ceux qui ont eu la chance de l'avoir pour partenaire : Attilio
Labis, Youli Algaroff... Je me souviens, alors que j'étais encore élève à
l’École de danse, d'Algaroff et Chauviré. C'était deux très grands artistes. Un
couple, sur scène, représente la vie. Je me souviens aussi – toujours à l’École
de danse -, d'une fois où George Skibine avait fait venir Tatiana Gsovsky –
épouse de Victor Gsovsky -, qui était alors directrice de l'école de la
Deutsche Oper de Berlin. Une femme extraordinaire. Des années plus tard, nous
avons déjeuné dans un restaurant français au Kurfürstendamm, à Berlin. Tatiana
Gsovsky et Yvette m'avaient invité. J'étais en admiration devant Tatiana, je me
remémorais le temps où elle était venue monter La Dame aux camélias [chorégraphie
de Tatiana Gsovsky, sur une musique de Henri Sauguet, créée à l'Opéra de Paris
en 1960, ndlr], à l'initiative de George Skibine. Encore une pièce aujourd'hui
complètement oubliée. Bien des chefs-d’œuvre finissent ainsi. Autre souvenir
qui me vient à l'esprit : Les Mirages. J'étais alors débutant, et
je faisais l'un des petits Négrillons, celui qui apportait le coffre. Yvette
Chauviré dansait l'Ombre. C'était bien avant que je ne fasse le rôle masculin
principal [le Jeune-homme, ndlr]! Il y avait aussi La Belle-Hélène,
de … John Cranko! Yvette Chauviré et Michel Renault tenaient les rôles
principaux. Et nous, les élèves de l’École de danse, faisions les petits
Orphéons. Dans la distribution, il y avait aussi Attilio Labis, qui incarnait
Achille. Claude Bessy, Micheline Bardin et Jacqueline Rayet, qui faisaient
Vénus à tour de rôle, étaient également de la partie. Yvette était
resplendissante. Tout comme dans Istar, qu'elle a créé. Fabuleux!
C'était une vraie «performance» que Lifar avait imaginée pour elle. Elle y
était d'une beauté extraordinaire.
Je
suis heureux qu'on parle d'Yvette. Ce qui est bien, c'est d'en parler. Hugues
Gall me demandait toujours : «Avez-vous eu des nouvelles d'Yvette?
Avez-vous vu Yvette? Bonjour mon cher, avez-vous parlé à Yvette?»... Il aimait
beaucoup Yvette, et grâce à lui, du vivant de la danseuse, un studio de
répétition au Palais Garnier a été baptisé «RotondeYvette Chauviré». Des
générations et des générations de danseurs vont se succéder dans ces
lieux : «On répète où? A Zambelli! Et si Zambelli n'est pas libre? Eh
bien, on va à Chauviré! Et sinon, on va à la classe A, à la classe B, ou au
foyer». Il y a aussi les grands studios Petipa, Nouréev et Balanchine. Mais
pour moi, là où on travaillait, c'était Zambelli et Chauviré! Il y aura bien
sûr d'autres souvenirs, des documents, des films. Mais faut-il les montrer? Je
crois que c'est le mythe qui doit perdurer.
Propos recueillis par Romain Feist
Le
contenu des articles publiés sur www.dansomanie.net et
www.forum-dansomanie.net est la propriété exclusive de
Dansomanie et de ses rédacteurs respectifs.Toute reproduction
intégrale ou partielle non autrorisée par Dansomanie
ou ne relevant pas des exceptions prévues par la loi (droit de
citation
notamment dans le cadre de revues de presse, copie à usage
privé), par
quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété
intellectuelle.