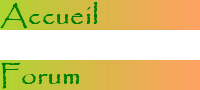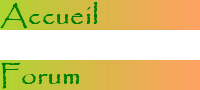|
Charles Jude, directeur
du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux
09 juin
2008 : conversation avec Charles Jude
Charles Jude, ancien danseur Etoile de
l'Opéra National de Paris - il fut
nommé en 1977 dans Ivan
le Terrible, de Youri Grigorovitch -, préside
aux destinées du Ballet de l'Opéra National de
Bordeaux depuis 1996. Formé à la danse par
Alexandre -"Sacha" - Kalioujny, il eut également la chance
de connaître Serge Lifar, et fut le témoin des
derniers instants de Rudolf Nouréev, dont il est en quelque
sorte le "fils spirituel".
Charles Jude a accepté de nous recevoir, pour
évoquer tout d'abord le souvenir de ces maîtres,
puis pour détailler son action à la
tête du Ballet de Bordeaux au cours des douze
années écoulées, et nous faire part de
ses projets d'avenir.

Premiers pas avec Alexandre
Kalioujny
C’est avec Alexandre Kalioujny
que j’ai débuté la danse ; à
l’époque, il enseignait au conservatoire de Nice.
C’est lui qui m’a mis le pied à
l’étrier. En fait, je n’avais aucune
envie de faire de la danse. C’est mon père qui
m’a inscrit au cours, sans me demander mon avis. Il tenait
à ce que ses enfants aillent au conservatoire pour y
pratiquer une discipline artistique.
Alexandre Kalioujny a bien vu que la danse ne
m’intéressait pas ; il me semble
d’ailleurs que lui-même s’y
était mis assez tard. Auparavant, il avait
été un sportif de haut niveau. Pour me
décider, il m’a emmené sur un stade,
m’a fait courir, sauter, et m’a expliqué
que la danse, c’était aussi un sport de
compétition ; j’ai été
sensible à cette comparaison, et j’ai fini par
aimer la chose… !
En 1971, je suis monté à Paris. Alexandre
Kalioujny avait dit à mes parents qu’il y avait
une audition à l’Opéra, et ils
m’y ont envoyé. J’ai
été pris. Par la suite, Alexandre Kalioujny a
été nommé professeur des Etoiles,
à l’Opéra, ce qui m’a permis
de continuer de travailler avec lui, jusqu’à son
décès.
Alexandre Kalioujny avait un tempérament de
créateur. Ses cours étaient
véritablement chorégraphiés. Il avait
l’intelligence de mettre les difficultés
techniques en perspective, en situation, dans un
enchaînement. Il utilisait rarement les
«entre-pas». Les difficultés se
succédaient les unes aux autres, et il fallait
impérativement que chaque figure soit
exécutée parfaitement faute de quoi, en
l’absence de pas de liaison permettant de reprendre un
élan, la suivante ne passait pas non plus… La
réalisation de tels enchaînements demandait une
très grande concentration.

Ma sœur, Marie-Josèphe, elle, a appris le piano et
a fait une carrière de concertiste. Il nous est
arrivé de travailler ensemble, notamment pour les Quatre
tempéraments et Sonatine, de Balanchine. Nous avions aussi
participé au tournage d’une émission
télévisée, à Nice,
consacrée à la Sonate au clair de lune de
Beethoven.
Pour ce qui est de créer véritablement quelque
chose ensemble, pourquoi pas, mais il faudrait qu’elle me
dise ce qu’elle a envie de jouer, qu’elle me fasse
parvenir un enregistrement, et que je puisse mettre des pas dessus. Le
problème, c’est que ma sœur est toujours
par monts et par vaux, elle donne beaucoup de récitals
à l’étranger, et il est difficile
d’arriver à bloquer une période
suffisamment longue pour que nous puissions travailler en commun.
Mais nous aurons au moins l’occasion de nous retrouver le 4
juillet prochain, pour un gala de bienfaisance au profit
d’une association caritative, Prisma. Isabelle
Juppé sera la marraine de cette manifestation. Ma
sœur y jouera en compagnie d’un autre pianiste de
renom, Michel Béroff, et j’y participerai
moi-même avec quelques danseurs de la troupe du Grand
Théâtre.
Serge Lifar,
l’héritage
C’est Serge Lifar qui
m’a enseigné la chorégraphie de
Giselle. Quand j’ai abordé Albrecht, Alexandre
Kalioujny a demandé à Lifar de me transmettre le
rôle, et de me montrer le style. Par la suite, j’ai
eu l’occasion de danser de nombreux ballets de Lifar, comme
Suite en blanc, Phèdre ou Icare.
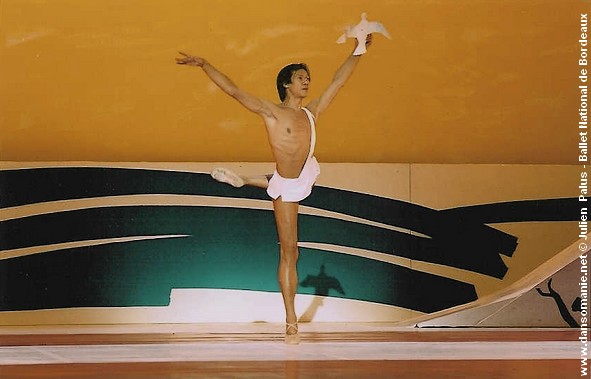
Lifar, que j’ai eu la chance de bien connaître,
était quelqu’un de passionnant et de
passionné, qui a toujours cultivé un
côté «star» : il voulait
être vu. Dans la danse, pour lui, le plus important,
c’était l’esthétique et le
rythme. Il avait véritablement le rythme dans le sang.
Lorsqu’on est jeune, et qu’on est un simple
interprète, on fait ce que le maître demande, sans
se poser trop de questions. Une fois qu’on est
passé de l’autre côté de la
barrière, et qu’on est face à
d’autres danseurs, auxquels il faut donner des directives, on
mesure l’importance de la tâche qui nous incombe
pour transmettre un répertoire, un style. Il nous faut faire
partager aux jeunes générations cet
héritage que nous avons nous-même reçu
des mains du maître.
Pour l’hommage que nous avons rendu à Serge Lifar
en 2001, j’avais fait venir Cyril Atanassoff, pour
qu’il fasse partager son expérience aux danseurs
bordelais. Lui-même avait beaucoup travaillé sous
la direction de Lifar. Le but de cette production était de
mettre en perspective Lifar interprète, au travers
d’Apollon musagète et du Fils prodigue, que
Balanchine avait chorégraphiés pour lui, et Lifar
chorégraphe, avec Icare et Suite en blanc.
Bordeaux, 1996 - 2008
A mon arrivée à
Bordeaux, en 1996, le ballet n’avait pas à
proprement parler de répertoire. Le
précédent directeur, Paolo Bortoluzzi,
privilégiait essentiellement le répertoire
contemporain. Lorsque Thierry Fouquet – le directeur
général de l’Opéra de
Bordeaux – m’a demandé de prendre en
mains la compagnie, mon premier souci a été de
reconstruire un vrai répertoire, qui allie classicisme et
néoclassicisme tout en ménageant une place pour
des commandes à des chorégraphes actuels.
En France, la danse classique n’est guère
à l’honneur en dehors de Paris, si ce
n’est à Bordeaux ou à Toulouse.
J’ai donc voulu prendre exemple sur Rudolf Nouréev
et sur l’Opéra de Paris, où existe
encore un vrai répertoire, et qui est en quelque sorte le
«temple» de la danse académique, tout en
ayant su s’ouvrir à la création
contemporaine, et ceci dès l’époque de
Rolf Liebermann qui, dans les années 1970, avait
fondé le GRCOP (Groupe de Recherche
Chorégraphique de l’Opéra de Paris),
dont la direction fut confiée à Carolyn Carlson.
Le Ballet de Bordeaux est l’une des principales compagnies
françaises ; nous le devons au soutien d’Alain
Juppé, le maire de la ville, de Thierry Fouquet, le
directeur du Grand Théâtre, et du
Ministère de la Culture ; mes demandes pour obtenir des
danseurs en nombre suffisant pour remonter un répertoire
digne de ce nom ont été satisfaites, et nous
disposons aujourd’hui de 38 artistes permanents, auxquels
viennent s’ajouter une quinzaine de surnuméraires
qui complètent l’effectif des grosses productions.
Les grands ouvrages classiques sont exigeants, et si l’on
n’a pas les moyens humains requis, il vaut mieux
s’abstenir de monter des ouvrages tels La Belle au bois
dormant ou Le Lac des cygnes.
Je peux dire que je me sens bien à Bordeaux. J’ai
la chance de travailler dans un théâtre
historique, j’ai de bon danseurs et on me donne les moyens
nécessaires pour mener la politique artistique que je
souhaite. Comme vous me demandez si la saison 2008-2009 sera un dernier
feu d’artifice, ou une ouverture sur de nouvelles
perspectives, je peux donc vous répondre que ce sont de
nouveaux horizons qui s’ouvrent à nous,
évidemment. Depuis dix ans, la compagnie a prouvé
sa valeur, et a obtenu une reconnaissance sur le plan national et
international. Nous allons porter à la scène des
ouvrages de grands chorégraphes actuels, tels Kylian ou
Forsythe, ce qui accroîtra notablement la
notoriété et la stature de la compagnie. Ceci, je
n’en doute pas, va permettre au Ballet de Bordeaux de se
mesurer aux grandes troupes internationales. Cela a de
surcroît un effet d’entraînement : plus
la renommée d’une compagnie augmente, et plus elle
attire de bon danseurs qui, à leur tour, contribuent
à l’amélioration du niveau
général du corps de ballet.

Il y a certains grands chorégraphes auxquels
j’aimerais passer des commandes, en vue de les
créer des œuvres nouvelles à Bordeaux :
John Neumeier, par exemple, qui est quelqu’un
d’extraordinaire. Carolyn Carlson a
déjà créé pour nous, et
nous avons pu monter des pièces de Paul Taylor,
José Limon ou David Parsons.
Grâce à Rudolf Nouréev, j’ai
eu la chance de connaître beaucoup de grands noms de la
danse. Cela m’a permis de nouer des contacts, et de les
aborder plus facilement lorsqu’il s’est agi de leur
commander des ballets nouveaux, ou d’en faire entrer
d’anciens au répertoire du Ballet de Bordeaux.
En revanche, je ne pense pas qu’il y ait encore beaucoup de
ballets oubliés qu’il faille faire
renaître de leurs cendres. En matière historique,
je m’en suis pour l’essentiel tenu au grand
répertoire du dix-neuvième siècle.
Nous avons bien sûr remonté une version de
Giselle, ainsi que Le Lac des Cygnes ou La Belle au bois dormant. Mais
des ouvrages tels que le Lac des Cygnes exigent aujourd’hui
une très grande scène, et c’est
pourquoi nous utilisons plus volontiers le Palais des Sports pour de
telles productions.
Le Ballet Biarritz, autre compagnie d’importance en
Aquitaine, est tout à fait complémentaire du
Ballet de Bordeaux. Thierry Malandain fait du très bon
travail avec sa troupe ; c’est également
quelqu’un qui est issu d’une formation classique,
d’ailleurs. Au début de la saison à
venir, il sera invité à Bordeaux pour y
créer Valses. Le travail de Thierry Malandain est reconnu au
niveau national et international, et nos deux compagnies
possèdent chacune leur identité propre dans la
région.
Reconstruire les classiques :
Nouréev, pour l’exemple
Rudolf Nouréev a toujours voulu
revisiter les ballets de Petipa en préservant
l’essentiel de la chorégraphie originelle.
Lorsqu’il a créé Cendrillon –
qui n’est pas une œuvre de Petipa - ex nihilo,
j’ai pu voir comment il procédait, notamment pour
le découpage musical et la transposition du texte
littéraire en mouvements de danse. Nouréev aimait
beaucoup le cinéma, et chaque fois qu’il inventait
un ballet, il travaillait comme un réalisateur de film ou un
cameraman. Mais s’il n’hésitait pas
à resituer l’argument dans une autre
époque, un autre univers, il demeurait fidèle au
thème d’origine, et ne commettait jamais de
trahison. Lorsque j’ai monté ma
Coppélia, j’ai suivi la même
démarche. J’ai ancré
l’histoire dans le milieu du cinéma, aux
Etats-Unis, dans les années cinquante, avec une
Coppélia devenue Marylin Monroe. Je voulais retrouver
l’esprit des comédies musicales de cette
époque. Je savais que Nouréev
était en admiration devant Fred Astaire. Je n’irai
pas jusqu’à dire que j’ai voulu lui
rendre un hommage explicite, mais cette Coppélia constitue
le prolongement logique de ce que Nouréev m’a
appris en matière de composition d’un ballet.
Nouréev me disait toujours qu’il
«fallait utiliser toute la magie du plateau». Un
chorégraphe se doit de connaître toutes les
ressources qu’offrent les équipements techniques
d’un théâtre (éclairage,
machinerie…) pour faire naître cette magie.
Aujourd’hui, la vidéo vient
compléter les moyens à notre disposition, et
beaucoup de ballets y font maintenant appel, en matière de
scénographie.
Pour la version de Roméo et Juliette que nous
créerons au cours de la saison prochaine, je me suis
imposé un respect rigoureux de l’œuvre
de Shakespeare. L’histoire de Roméo et Juliette
est si intemporelle, d’une construction si
évidente, que je n’ai pas voulu la transposer.
Elle demeurera donc située dans l’Italie de la
Renaissance, dans une atmosphère où alterneront
exubérance et noirceur. Et la musique de Prokofiev
relève, à elle seule, de la narration! Je
préserverai donc le contexte historique d’origine,
mais en revanche, la chorégraphie proprement dite sera
actuelle. A chaque personnage sera associé un style
chorégraphique différent, de manière
à bien marquer le caractère propre des
rôles.
Pour la scénographie de Coppélia,
j’avais fait appel à un illusionniste,
Gérard Majax. J’aime bien travailler avec des
magiciens, qui acceptent de mettrent leurs tours au service de mes
chorégraphies. Je ne vais pas vous dévoiler les
détails, mais il y aura à nouveau des effets de
magie dans Roméo et Juliette. J’ai toujours
été fasciné par la magie. Mais
l’artifice doit être employé a bon
escient, intégré à
l’œuvre, il doit surprendre le public, tout en lui
paraissant naturel.
Charles Jude
directeur… et danseur?
Lorsque j’ai
créé Coppélia, je n’ai pas
voulu interpréter tout de suite le rôle de
Coppélius. Je n’avais pas le temps de le
travailler sérieusement, et j’ai
préféré attendre.
Je ferai peut être de même pour Roméo et
Juliette. Je ne danserai pas ce ballet immédiatement, mais
peut-être à l’occasion d’une
reprise. Le rôle qui m’attire le plus, ce
n’est d’ailleurs pas celui de Roméo,
c’est plutôt Tybalt. Mais rien n’est
sûr ; je sais aussi qu’il faut
à un moment ou à un autre laisser la place
à des jeunes, qui ont leur carrière à
faire.
De toute façon, je continue de
m’entraîner, si ce n’est quotidiennement,
du moins régulièrement. C’est un besoin
physiologique, mon corps le réclame. Cela aussi me vient de
Nouréev qui, lorsqu’il n’assurait pas de
représentation, se faisait toujours une obligation de
prendre son cours. Cela maintient les sens en éveil. Et un
créateur chorégraphique se doit de ressentir
lui-même les mouvements, s’il veut être
capable de les montrer aux autres.
De Bordeaux, et
d’ailleurs
Le Ballet de Bordeaux s’ouvre
aussi au monde extérieur en invitant des solistes qui
n’appartiennent pas à la troupe. Nous avons
déjà eu par exemple Delphine Moussin ou
Mélanie Hurel, de l’Opéra de Paris.
Lors d’une tournée au Japon, j’ai
rencontré Mathias Heymann, qui m’a
impressionné et que j’aimerais beaucoup faire
danser à Bordeaux. Dernièrement, j’ai
invité Giuseppe Piccone [danseur italien qui a
exercé notamment à l’English National
Ballet et à l’American Ballet Theatre, ndlr.] qui,
lui aussi, est un très grand artiste. Il reviendra la saison
prochaine, certainement pour Roméo et Juliette, et aussi, je
l’espère, pour Coppélia. Je sais
qu’il a envie de s’installer à Bordeaux,
et je souhaiterais, petit à petit,
l’intégrer dans la compagnie. Mais il y a toujours
de délicates questions de planning à
régler, car tous ces danseurs ont d’autres
obligations et des contrats dont il faut tenir compte.
En tout état de cause, la venue de danseurs extérieurs
à la compagnie est une chose bénéfique pour nous.
Ces artistes parlent ensuite de leur expérience autour
d’eux, et attirent d’autres éléments de
valeur à Bordeaux. Nous avons ainsi recruté Oksana
Kucheruk, originaire de Kiev, et qui est vraiment extraordinaire.
Horizon 2013
Pour ce qui est de l’avenir
immédiat, il y a la restructuration de la salle Franklin
[ancienne salle du Jeu de Paume, puis casino, utilisée
depuis le XIXème siècle comme lieu de
répétition pour l’orchestre, ndlr.].
L’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine va
déménager dans un nouvel auditorium, tandis que
le ballet disposera de la salle Franklin, transformée en
studios de danse. Nous pourrons ainsi inviter plusieurs
chorégraphes simultanément, qui auront chacun un
lieu de travail qui leur sera propre ; jusqu’à
présent, nous n’avions qu’une seule
salle de répétition, mais dès
l’année prochaine, cela aura changé.
Par ailleurs nous avons de grands projets pour 2013 ; Bordeaux
s’est portée candidate au titre de
«Capitale Européenne de la Culture» pour
cette année-là, et si notre dossier est retenu,
ce sera aussi une opportunité pour le ballet. Nous voudrions
mettre cette manifestation à profit notamment pour
fêter le centenaire du Sacre du printemps, et inviter des
compagnies étrangères de renom.
Charles Jude
Entretien
réalisé le 9 juin 2008 - Charles Jude © 2008,
Dansomanie
|
|