 |




|
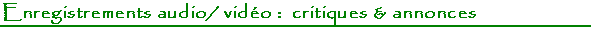
 |
|
|
La Danseuse, un film de Stéphanie Di Giusto
Cinéma : La danseuse, la vie de Loïe Füller et Isadora Duncan rêvée par S. Di Giusto
Présenté
au Festival de Cannes 2016 dans la sélection «Un certain
regard», le film de Stéphanie di Giusto retrace le destin de Loïe
Fuller, célèbre danseuse du début du XXème siècle, rapidement
occultée par Isadora Duncan. Porté par un casting impeccable, La
Danseuse est pleine de qualités, malgré un
scénario parfois trop académique.

C'est
en rêvant d'être comédienne que Loïe Fuller est arrivée à la
danse. C'est sur scène que, pour surmonter un trac qui la
paralysait, elle fit virevolter sa robe pour la première fois,
esquissant sa célèbre danse serpentine. De ses débuts dans
l'Illinois à son arrivée à Paris — où elle brilla aux Folies
Bergères —, la réalisatrice montre la danseuse animée par la
volonté de réussir, quitte à comparer son héroïne à une
sportive de haut niveau, à travers des scènes pertinentes sur sa
préparation physique. Même si elle se produisit à
l'Opéra de Paris1 et que Rodin et Mallarmé chantèrent
ses louanges, le souvenir de Loïe Fuller fut quelque peu occulté par celui d'Isadora Duncan, sa délicieuse
concurrente.

Mais plutôt que de se concentrer sur cette rivalité,
Stéphanie di
Giusto montre Fuller davantage comme un mentor, développant
envers
sa protégée un amour passionné et destructeur. En
imposant Duncan,
à la sensualité outrageuse, Loïe Fuller s'est
brûlée les ailes, détruisant sa propre
carrière pour se faire oublier du grand public.

Le
projet de la réalisatrice était donc de réhabiliter son héroïne. Par son casting, La Danseuse abolit toutefois ses ambitions
scénaristiques. Ainsi, en choisissant Lily Rose Depp pour incarner
Duncan, Stéphanie di Giusto éclipse involontairement la prestation
pourtant impeccable de Soko (Augustine, Bye Bye Blondie).

De fait, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp parvient à capter
toute l'attention sur elle, écrasant pour la seconde fois Loïe
Fuller, au destin décidément bien triste2. Qu'à
cela ne tienne, les scènes de danse demeurent grandioses et
extrêmement bien filmées, donnant à voir ce
à quoi le spectateur de
l'époque a pu assister. Par ailleurs, les séquences dans
la forêt montrant Loïe Fuller avec ses danseuses,
préparant un spectacle à l'Opéra
de Paris [Le Lys de la vie, voir note1, ndlr], rappellent la poésie chorégraphique de Pina
Bausch, clin
d'oeil au sublime documentaire de Wim Wenders.

Si la
fin du long-métrage confère à l'héroïne une destinée bien plus
glorieuse qu'au personnage réel, La Danseuse est un
premier film efficace, qui ne ravira pas que les amateurs de
danse.
Paola Dicelli © 2016, Dansomanie

1.
Loïe Füller donnera une unique représentation à
l'Opéra de Paris le 1er juillet 1920, à l'occasion
d'un «gala roumain»,
en présence de la Reine Marie de Roumanie, protectrice, amie et
confidente de la danseuse. On y représenta un ballet
intitulé Le Lys de la vie,
ballet qui fut filmé par Loïe Füller elle-même
en tant que réalisatrice l'année suivante, mais avec une
doublure pour la danse. Loïe Fuller confectionna elle-même
les costumes du spectacle, mais la teinture artisanale employée
conduisit à quelques déboires, comme le rapporte, dans un
compte-rendu plutôt ironique, la revue Commœdia :
Sur
le plateau, il fait une chaleur tropicale. Rien de surprenant, nous
sommes en plein Sahara ; heureusement, il y a quelques palmiers. Il y a
même un dromadaire. Cet animal se comporte d'une façon
très correcte. Il faut dire qu'il est en bois ; aussi ne
risque-t-il pas de renverser la girl qui le chevauche avec des
éclats de rire. Cette girl est vêtue en papillon.
Au centre du plateau, il se passe des choses
mystérieuses. Les machinistes se penchent au bord d'un trou.
Vont-il boire au puits de l'Oasis? Non! ils disposent simplement une
glace sans teint très épaisse sous laquelle deux
projecteurs ouvrent leurs yeux éblouis.
Un officier américain passe, la poitrine plus
constellée de médailles que la devanture d'une baraque de
pédicure forain. Malgré toutes ses décorations et
tous ses galons, le major Paul C. Turner est l'homme le plus
affable et le plus courtois qui soit. Il a une figure enfantine et
souriante et des yeux clairs qui regardent droit. C'est lui le
«manager» (comme nous disons en français) de la
troupe.
The Lily of Life?
C'est un conte de fées! Un jeune prince vient chercher sa
fiancée, mais au moment des noces, il tombe malade ; il va
mourir... Mais la princesse a lu dans un livre qu'il existe un lys
miraculeux qui peut sauver son fiancé. Et la voilà
parcourant le monde à la recherche de la fleur merveilleuse.
Vous pensez bien qu'elle finit par la trouver après mille
péripéties, et que le jeune prince, revenant à la
vie, l'épouse à la fin du conte!
C'est S. M. la reine de Roumanie qui a écrit
le scénario, c'est Miss Loïe Füller qui a fait la mise
en scène. Ce n'est pas une pantomime, c'est un ballet
mêlé de chant. M. Stroesco, de l'Opéra-Comique,
chantera le rôle du prince.
La musique a été empruntée
à divers auteurs : Debussy, Mendelssohn, Grieg,
Tschaïkovsky [sic], Rimsky-Korsakoff, etc... Il y avait
également une partie extraite de Wagner ; mais, comme on ne joue
pas Wagner à l'Opéra, on a fait une coupure. C'est sur
cette musique que Miss Loïe Füller a fait sa mise en
scène...
Dans la salle! Une voix autoritaire sort d'une housse de fauteuil et donne des ordres : «Ready, girls!» Miss Loïe Füller émerge de la housse dans laquelle elle s'est enveloppée.
– Ce
n'est pas une mise en scène ordinaire, où les personnages
sont un peu sacrifiés au décor. Ici, le décor est
secondaire. Il est d'une extrême simplicité, et j'ai
porté tout mon soin sur les costumes et le groupement de
mes personnages.
«La
lumière sera la reine de la fête ; c'est elle qui aura le
plus grand rôle. Enfin, j'estime que les accessoires ne doivent
pas tenir la grande place qu'on leur donne. Au lieu d'un trône
magnifique, prenez quelques bancs, des chaises, recouvrez-les d'un
voile, sur lequel tombe une projection. Vous obtiendrez un très
gros effet avec bien peu de choses.
La pièce sera jouée demain au profit des
blessés de guerre roumains et belges. Après quoi nous
parcourerons le sud de la France en juillet et en août ; en
septembre, nous irons en Angleterre.
Sur la scène, le «jeu du voile»
commence. On dirait un immense soufflet au fromage qui se gonfle et qui
monte. Et sous ce voile qui s'agite mystérieusement comme une
jatte de lait en ébulition, les girls jacassent et rient. Pouf!
le soufflet crève. Il en sort un essaim de jolies femmes...
En partant, nous rencontrons les figurantes qui sont
des femmes du monde... (Chut! nous tairons les noms), et l'une d'elle
[sic] regarde mélacoliquement son peignor de bain multicolore.
– C'est très joli, ce costume, mais ça déteint! J'ai les jambes toutes vertes!
Le plus terrible, c'est que ce fut peint à l'encre indélébile!
[André Rigaud, Commœdia, 1er juillet 1920]

2.
Loïe Füller ne fut pas aussi
oubliée que le film (qui reste une fiction) semble le
suggérer. Pour le dixième anniversaire de sa mort,
l'Opéra de Paris donna une série de
représentations exceptionnelles d'un spectacle «en
lumière noire» intitulé Fluorescences, monté
par Gabrielle Bloch, dite Gab. Sorère, continuatrice de la
compagnie de Loïe Füller après le décès
de la danseuse en 1928. Gab. Sorère fut par ailleurs l'une des
compagnes de la Füller à la vie. Gab. Sorère
appraît, dans La Danseuse, sous les traits de Mélanie Thierry. Au travers du personnage imaginaire de Louis (Gaspard Ulliel),
Stéphanie di Giusto prête également à
Loïe Füller un amant masculin, ce qui n'est, sur un strict
plan historique, pas une absurdité, puisqu'elle compta
très probablement parmi ses conquètes le futur roi Carol
II de Roumanie. Carol était le fils ainé de Marie de
Saxe-Cobourg-Gotha, la princesse puis reine de Roumanie -
également éphémère compagne de la
Füller - qui rédigea l'argument du Lys de la vie donné à l'Opéra de Paris en 1920 (cf. note 1).

La première représentation de Fluorescences eut lieu au Palais Garnier le 9 février 1938, en même temps que Rigoletto (!) de Verdi. La seconde fut donnée le 11 février (avec Oriane et le Prince d'Amour de Florent Schmitt et Le Cantique des Cantiques d'Arthur Honegger). Le 18 et le 21 février 1938, Fluorescences fut à nouveau couplé à un opéra de Verdi, Othello cette fois, tandis que la dernière, le 28 février, eut lieu après une exécution de Coppélia.
Si le spectacle fut diversement apprécié par la critique
(qui estimait généralement qu'un tel ouvrage avait
davantage sa place au music-hall qu'à l'Opéra), il
souleva en revanche l'enthousiasme des milieux artistiques, car
c'était là la première utilisation à grande
échelle des lampes à ultra-violets (ou
«lumière noire»), qui n'étaient
jusque-là qu'un gadget de laboratoire. Fluorescences
fut d'ailleurs monté avec la coopération
d'ingénieurs de la Compagnie des Lampes Mazda, qui
commercialisait ces appareils en France et qui cherchait à en
équiper massivement les salles de théâtre
parisiennes. Le compositeur Arthur Honegger fut l'un des principaux
promoteurs de cette innovation technologique mise au service du
spectacle, et proposa même d'enregistrer une série de
disques de musique spécialement adaptée aux «ballets de lumière».
Mais laissons le dernier mot à Gab. Sorère, qui, lors de la conférence de presse de présentation de Fluorescences déclara :
Loîe Füller ne fut jamais, à proprement parler, une
danseuse. Créatrice de lumières, ses apports au
théâtre ont fourni toutes les idées et tous les
procédés qu'utilisent aujourd'hui, non seulement les
scènes de théâtre ou de music-hall, mais la rue
elle-même, avec ses monuments éclairés par des
projecteurs, comme on les voit depuis peu d'années. Elle allait
au théâtre comme le savant va à son laboratoire, et
il est certain que, vivante, elle eut adopté la lumière
noire avant toute autre.
Le
contenu des articles publiés sur www.dansomanie.net et
www.forum-dansomanie.net est la propriété exclusive de
Dansomanie et de ses rédacteurs respectifs.Toute reproduction
intégrale ou partielle non autrorisée par Dansomanie
ou ne relevant pas des exceptions prévues par la loi (droit de
citation
notamment dans le cadre de revues de presse, copie à usage
privé), par
quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété
intellectuelle.

La Danseuse
Réalisation : Stéphanie Di Giusto
Scénario : Stéphanie Di Giusto et Sara Thibaud d'après Giovanni Lista
Producteurs : Alain Attal, Emma Javaux, Marie Jardillier
Producteur exécutif : Xavier Amblard
Directeur de la photographie : Benoît Debie
Chef monteur : Géraldine Mangenot
Chef décorateur : Carlos Conti
Directrice du casting : Pascale Béraud
Directeur de production : Bruno Vatin
Chef costumier : Anaïs Romand
Ingénieur du son : Pierre Mertens
Ingénieur du son : Thomas Desjonqueres
Mixage : Eric Chevallier
Chorégraphie : Jody Sperling
Durée : 1h52
Loïe Fuller – Soko
Louis – Gaspard Ulliel
Gabrielle – Mélanie Thierry
Isadora Duncan – Lily-Rose Depp
Marchand – François Damiens
Armand – Louis-Do de Lencquesaing
Lili – Amanda Plummer
Ruben – Denis Ménochet
Sortie en salle le 28 septembre 2016
Les Productions du trésor / Wild Bunch Distribution
|
|
|





























