 |




|

 |
|
|
Bayerisches Staatsballett (Munich)
13 octobre 2009 : 100 Jahre Ballets Russes (Les 100 ans des Ballets Russes)
Lucia Lacarra (Zobeïde) - Marlon Dino (L'Esclave doré) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)
En
ce mardi 13 octobre 2009, le Bayerisches Staatsballett reprenait pour
la deuxième année consécutive sa soirée 100 Jahre Ballets russes,
conçue comme un hommage à cette vague de nouveauté chorégraphique qui
déferla sur l’Europe en 1909, hommage doublé d’une réflexion sur les
héroïnes « pathétiques » du ballet classique.
Cette date marquait également le grand retour de l’étoile Lucia
Lacarra, tenue plusieurs mois éloignée de la scène pour cause de
blessure. Interprétant le rôle principal de Schéhérazade,
le célèbre ballet de Fokine (représenté sur la scène du Nationaltheater
de Munich dans une scénographie aussi proche des origines que
possible), elle a su rassurer ses admirateurs par une danse assurée et
maîtrisée sans difficultés visibles ; quant à sa technique toujours
excellente, elle vient compléter une présence en scène à la force
émotionnelle indéniable, notamment vers la fin du ballet : lorsque
Zobéide apprend la mort de son amant, le désespoir sincère et juste qui
semble envahir Lucia Lacarra franchit aisément le « quatrième mur »
séparant les danseurs du public. L’étoile rompt ainsi avec le jeu
quelque peu détaché – le public peinant alors à concevoir l’ampleur de
la passion dévorante de Zobéide pour l’Esclave doré – qui caractérisait
son partenariat pourtant complice avec l’impressionnant Marlon Dino. La
danse puissante et la carrure imposante de ce dernier lui permettent
d’offrir une interprétation sauvage, sensuelle, mais jamais racoleuse
du rôle créé par Vaslav Nijinski. A noter également la force de sa
présence (imposée dès son entrée fracassante) et la qualité de sa
saltation, aux sauts d’envergure et aux réceptions moelleuses, qui
participe à la dimension féline de ce personnage, bienvenue face à la
séduction envoûtante de la reine du harem.

Marlon Dino (L'Esclave doré) - Lucia Lacarra (Zobeïde) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)
Le corps de ballet de la compagnie bavaroise fut d’une assez belle
facture, même si l’on pouvait remarquer çà et là quelques imprécisions
et mauvais placements (en plus de la chute malencontreuse d’une jeune
servante) ; on regrettera cependant un certain manque généralisé
d’audace et d’effronterie qui n’aurait pas dépareillé – bien au
contraire ! – dans cette peinture d’un harem aux mœurs légères.
L’on pourra appliquer le même commentaire aux les trois Odalisques
qu’incarnaient soir-là Ekaterina Petina, Daria Sukhorukova et Zuzana
Zahradnikova : la technique est précise, maîtrisée et incisive, les
ensembles sont plus que corrects… mais les variations manquent d’un
grain de folie sensuelle qui eût été ici approprié, absence soulignée
par la précipitation parfois évidente des danseuses vis à vis de
certains accents, ce qui ajoute dès lors une sécheresse perceptible à
leur interprétation par ailleurs intéressante.
Paradoxalement, le travail de la compagnie paraît plus abouti dans Les Biches,
de Bronislava Nijinska, une pièce de 1924 pourtant plus anecdotique,
tant sur le fond historique que chorégraphique. Nous sommes loin des
transgressions symboliques et si scandaleuses pour la vieille Europe
qu’offrait L’Après-midi d’un faune ou même, à une moindre échelle, la Schéhérazade
présentée en ouverture de cette soirée : en pleines Années Folles, la
question est ici de savoir ce qu’il se passe entre les jeunes filles
gentiment délurées et les trois athlètes qui surgissent dans cette
maison très féminine comme des renards joueurs dans un poulailler
plastiquement très élégant (les couleurs pastels de Marie Laurencin
sont un plaisir pour les yeux).

Marlon Dino (L'Esclave doré) - Lucia Lacarra (Zobeïde) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)
Cyril Pierre, Javier Amo Gonzalez (excellent) et Gregory Mislin
étaient ce mardi les trois hommes de la situation, assumant avec brio
le comique de la chorégraphie qui les faisaient fanfaronner en shorts
bleus et socquettes blanches. Leurs pas de trois furent dans l’ensemble
homogènes et les ensembles harmonieux, mais l’on pouvait déceler chez
Cyril Pierre une certaine raideur dans les réceptions qui tranchait
avec l’exceptionnel ballon de Javier Amo Gonzales ; le travail de la
petite batterie (primordial pour les variations des trois athlètes) se
voyait donc légèrement déséquilibré. Cyril Pierre regagnait cependant
l’estime du public en se montrant un partenaire très attentif et
précieux pour Daria Sukhorukova, la première soliste issue du Théâtre
Mariinsky, qui faisait là des débuts très réussis dans le rôle de la
Dame en bleu (en lieu et place de la française Séverine Ferrolier,
annoncée dans un premier temps). La jeune femme fait preuve dans ce
rôle d’indéniables qualités, révèle une paire de jambes de toute
beauté, interminable et racée, et insuffle à ce personnage aux premiers
abords très froid une noblesse et une majesté somptueuses, au travers
d’une danse toutefois sobre et sans superflu. Contrepoint de cette Dame
en bleu, la Maîtresse de maison incarnée par l’étoile brésilienne
Roberta Fernandes délivre sur scène une folle énergie tout à fait à
propos, faisant preuve de beaucoup d’allant, de dynamisme, voire même
de « bagou » ; ce, malgré une chorégraphie quelque peu ingrate qui ne
laisse que peu de place à la virtuosité ou même au lyrisme, qualités
souvent fort appréciées du public.
Ilana Werner et Maira Fontes composent de très plaisantes
Demoiselles en gris, complices et joyeuses. Les deux jeunes femmes font
montre d’une technique très propre et d’un répondant quasi naturel, à
l’entrain communicatif et souriant. De même, les danseuses du corps de
ballet se jouent de ces Biches
légères avec un plaisir visible, leur enthousiasme et le bon niveau
général de la compagnie participant à la bonne humeur ambiante – ce qui
aide à escamoter le manque de profondeur de la pièce (sans faire
oublier cependant quelques approximations un peu gênantes lors de
certains ensembles).

Marlon Dino (L'Esclave doré) - Lucia Lacarra (Zobeïde) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)
Pour clore cette soirée-hommage, le Ballet de Bavière propose Once upon an ever after…une
pièce de Terence Kohler sous forme de bilan chorégraphique du travail
classique, plus précisément une sorte de réflexion sur les héroïnes «
pathétiques » des ballets canoniques : d’où notamment des citations et
reprises des personnages d’Aurore, Giselle, Odette / Odile…
La pièce s’ouvre sur une introduction néo-classique sobre ; les
danseurs sont en justaucorps noir sur fond noir, et se meuvent avec
chacun une gestuelle différente, mais bien identifiable pour les
balletomanes… ici nous avons les battements d’ailes d’Odette, là les
ports de bras de Coppélia, ailleurs les mains croisées de Giselle, plus
loin la pantomime d’Albrecht. Cette première scène annonce la couleur :
Terence Kohler pose son sujet d’une manière simple, sans trop de
prétentions apparentes, tout comme il le refermera dans le dernier
mouvement.
Le premier personnage qui fait son apparition sur scène est – sans
doute pas par hasard – Giselle, suivi de près par son amant. Ilana
Werner interprète une jeune paysanne plutôt touchante, sincère dans une
interprétation relativement épurée. Nul doute que la version classique
pourra par la suite convenir à cette jeune membre du corps de ballet,
surtout lorsqu’elle aura gagné en maturité. La chorégraphie reste assez
simple, la seule difficulté à laquelle a été confrontée la danseuse a
été d’arracher les pétales de sa marguerite sans trop d’encombres (le
tissu étant visiblement trop épais pour pouvoir tirer délicatement
dessus) ! Allen Bottaini est convaincant dans le rôle d’Albrecht,
notamment lors de la scène suivante, lorsqu’il est tourmenté par des
Wilis au look New-Age ; Myrtha est interprétée par une Roberta
Fernandes aux airs de banshee échevelée, qui tire de nouveau sur la
corde de la folie (une folie certes bien différente de celle des Biches)
dans une chorégraphie essentiellement composée de courses. Cette vision
de l’histoire de Giselle sera à peine plus longue, même si l’on
recroisera le couple Giselle / Albrecht par la suite, et laisse une
impression de superficialité… N’était-ce pas un peu trop facile de ne
jouer que sur l’explicitation de la folie des Wilis, sans creuser plus
avant ?
Cette impression de facilité subsistera tout au long de la pièce,
malgré quelques trouvailles comiques – ah, cette Aurore aux jambes
faibles qui réapprend à marcher après cent ans de sommeil ! – et une
compagnie très en forme : le morceau de bravoure pastichant Balanchine
est très bien assumé par l’ensemble de la troupe, qui se joue du tempo
très rapide avec une vélocité d’exécution, une technique et une
harmonie presque idéaux, même si on eût aimé voir plus d’insolence et
de provocation dans les déhanchés (tout comme manquait cette pointe
d’effronterie au tableau oriental de Schérérazade).
Il est dommage que cette réflexion sur l’Héroïne ne s’aventure pas dans
des sentiers un peu moins battus, et fait finalement preuve d’une
timidité assez dommageable, cachée derrière des audaces scénographiques
pas toujours très heureuses (pour l’exemple, les fleurs en néon
représentant la forêt de la Belle au bois dormant donnent plus une impression de touche pop-art que d’un véritable postulat de recherche du décor).
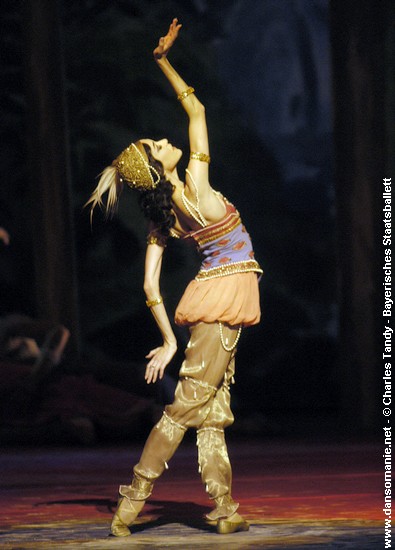
Lucia Lacarra (Zobeïde) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)
Nour el Desouki tire son épingle du jeu grâce à son interprétation du
Prince Désiré, tout à fait dans la lignée des princes classiques : les
lignes sont belles, les intentions nobles et les gestes propres et
assurés. L’on remarque aussi Marlon Dino, qui une fois de plus se
montre excellent partenaire et fait honneur à son Odette, Daria
Sukhorukova qui travaille le Cygne sous une forme très lyrique. Après
avoir mis en valeur ses jambes dans le ballet de Nijinska, c’est cette
fois son travail du haut du corps, notamment des bras (passage obligé
pour toute danseuse se frottant au Cygne) sur lequel se concentre
l’attention. Elle réussit l’épreuve avec un brio que l’on était en
droit d’attendre d’une ancienne soliste du Théâtre Mariinsky, et nous
offre une interprétation d’Odette délicate et fluide, à l’expressivité
tout en retenue ; c’est à peine si l’on note de temps à autre une
pointe de maniérisme dans le placement des mains. Face à elle, Odile
est esquissée (Terence Kohler n’accorde qu’un temps très limité à la
mise en place de ce personnage) par Elena Karpuhina, déjà remarquée
dans le corps de ballet des Biches. Cette petite danseuse, dont le
physique rappelle en plusieurs points celui d’Evgenia Obraztsova, ne
démérite pas et dote son Cygne noir d’une technique alerte et d’une
énergie ciselée, sans tomber dans la démonstration de sentiments.
Si le Bayerisches Staatsballett, avec son hommage aux Ballets
russes, nous permet d’assister à une soirée tout à fait satisfaisante
(et plus encore), l’on regrettera ces infimes détails qui auraient pu
faire de cette soirée un moment véritablement enthousiasmant. On
constatera cependant avec plaisir l’excellent niveau de la troupe,
niveau qui ouvre un éventail non négligeable de possibilités
chorégraphiques et qui montre que Londres, Paris ou la Russie ne sont
pas les viviers privilégiés des grandes compagnies européennes.
Anna Imbert © 2009, Dansomanie
Schéhérazade
Musique : Nicolaï Rimsky-Korsakov
Chorégraphie : Michel Fokine
Zobeide : Lucia Lacarra
L'Esclave doré : Marlon Dino
Shahriar : Cyril Pierre
Le Chah Zeman : Norbert Graf
Premier eunuque : Vincent Loermans
Les Odalisques : Zuzana Zahradníková, Daria Sukhorukova , Ekaterina Petina
Les Biches
Musique : Francis Poulenc
Chorégraphie : Bronislawa Nijinska
La Maîtresse de maison : Lucia Lacarra
La Dame en bleu : Marlon Dino
Trois Athlètes : Cyril Pierre
Once Upon An Ever After
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Chorégraphie : Terence Kohler
Giselle : Ilana Werner
Myrtha : Roberta Fernandes
Aurore : Séverine Ferrolier
Variation II : Zuzana Zahradníková
Odette : Daria Sukhorukova
Albrecht : Alen Bottaini
Siegfried : Marlon Dino
Désiré : Nour El Desouki
Variation I : Lukáš Slavický
Rothbart : Vincent Loermans
Bayerisches Staatsballett
Bayerisches Staatsorchester
Dir. Valery Ovsianikov
Mardi 13 octobre 2009, Nationaltheater, Munich
|
|
|





























