 |




|

 |
|
|
Royal Ballet (Londres)
31 janvier
2009 : The Seven Deadly Sins - Carmen - Danse à Grande Vitesse
La reprise de The Seven Deadly Sins
a de quoi surprendre tant les critiques plutôt négatives
avaient fusé lors de sa création il y a deux ans.
Pourtant, Will Tuckett ne semble pas avoir grandement retouché
la chorégraphie, toujours aussi linéaire et
répétitive ; seule Martha Wainwright se voit correctement
sonorisée et l’on se demande si, après
s’être plaint de son inaudibilité, on ne
préférait finalement ne pas l’entendre… Mais
à présent que l’histoire est intelligible, on
réalise mieux qu’on assiste à une comédie
musicale plutôt qu’à un ballet, et vu sous cet
angle, cela fonctionne plutôt bien, grâce à une
narration efficace et suffisamment courte pour ne pas lasser. On peut
néanmoins demeurer perplexe quant à la présence de
cette œuvre en un tel lieu. Les quatre autres chanteurs
d’ailleurs, sans doute mieux dotés vocalement, profitent
allégrement de cet artifice pour dynamiser l’ensemble et
apporter richesse à la couche sonore qui égale celle
visuelle peinte par le décor et les lumières. Quant
à la chorégraphie? C’est un peu le
problème…

Martha Wainwright et Zenaida Yanowsky dans The Seven Deadly Sins, chor. Will Tuckett
La matinée voyait la prise de rôle de Kristen McNally qui,
si elle n’a pas la précision de Zenaida Yanowsky, a un
certain aplomb lui permettant de surfer sur tous les hommes du ballet
avec un sourire ébahi, dans le style très naïf qui
sied à la personnalité d’Anna II. Elle manque
toutefois de l’autorité et de la présence de la
créatrice du rôle, qui officiait le soir, même si
celle-ci n’est pas encore très affûtée
physiquement. Pour son retour sur scène après une absence
de près d’une année, Zenaida Yanowsky
confère au personnage une variété
d’attitudes et donc de nuances avec une conviction que Kristen
McNally a pour sa part un peu de mal à restituer.
The Seven Deadly Sins
est donc à prendre pour ce qu’il est, une succession de
performances de danseurs émérites, en premier lieu celle
de Laura Morera, stupéfiante d’aisance, incarnant une
strip-teaseuse en talons aiguilles qui ne la gênent pas pour
faire des jetés à la hauteur de ses déhanchements
provocateurs. C’est également le cas du diaphane Edward
Watson, figure pâle de l’amoureux dans tout son clinquant,
qui a peaufiné son personnage de l’amant en
détresse - les rôles heureux ne lui conviennent pas et
tout semble avec lui conduire à la même inexorable fin, ce
qui le rend toujours éminemment sympathique.
Après quelque lutinage à trois en compagnie de Gary Avis,
Anna finalement lui échappe et c’est l’occasion de
montrer son art du drame, inégalé au Royal Ballet,
à l’aide notamment de quelques extensions bien
élégantes. Enfin un peu de danse! Thiago Soares, en homme
maléfique, est le seul autre changement de distribution entre la
matinée et la soirée et s’il semble mieux se
délecter de son rôle de patron du strip-club que Bennet
Gartside, c’est peut-être parce que celui-ci est
déjà tout à son Escamillo... Seven deadly sins?
La différence entre Mats Ek et Will Tuckett, ou entre Carmen et The Seven Deadly Sins,
se marque d’emblée par le poids que le
chorégraphe d’un Bizet un peu arrangé apporte aux
mouvements. Si Will Tuckett raconte simplement une histoire - un peu
désordonnée, sans véritable ligne
chorégraphique, mais avec un visuel tape à
l’œil -, Mats Ek fait du Mats Ek : une typologie
reconnaissable - gestes, cris, mouvements de groupe familiers du
chorégraphe se déclinent allégrement -, qui aide
à trouver ses marques. Lorsqu’il dérive vers les
gestes abstraits et le kitsch, il y a toujours un groupe de personnages
qui surgit pour mettre en oeuvre quelques mouvements plus classiques
qui recadrent l'ensemble - souvent des hommes en grands
jetés traversent la scène, de manière simple,
rapide, efficace.

Tamara Rojo et Thomas Whitehead dans Carmen, chor. Mats Ek
Au
regard du précédent ballet et de la faible Anna II,
Carmen apparaît comme la femme forte dans laquelle Tamara Rojo
glisse sa splendeur et sa malice. La Carmen
de Mats Ek ne roule pas les cigares, elle les fume !!! et Tamara Rojo
passe son temps à tirer sur l’objet (qui semble
dégoûter Viacheslas Samodurov) avec une joie immense,
courant elle aussi de bras en bras mais pas en victime, en gardant
toujours les commandes.
Les hommes ici sont faibles et les femmes dirigent. C’est la
surprenante Lauren Cuthbertson qui porte Thomas Whitehead, son
José, non le contraire, et les mouvements ne sont guère
attribués en fonction des genres, ce sont plutôt les
costumes qui désignent les sexes. Don José est donc un
pauvre garçon, tout de gris vêtu face aux couleurs fluo
des filles en robe et d’Escamillo, le matador doré. Mais
celui-ci n’est pas un toréador resplendissant, c’est
un bonbon absurde et ridicule, et Carmen lui tire le sexe tout
comme elle a arraché le cœur de José.
Les mouvements sont tendus, syncopés et caractérisent les
personnages. M est carrée et s’immisce là où
José ne l’attend pas, mais où il trouve très
logiquement sa place. Lorsqu’ils dansent ensemble, ils sont
synchrones, ils se ressemblent : la danse est tendue, sèche et
pleine d’arrière-pensées. Alors pourquoi
José est-il attiré par Carmen? Carmen brille de tous ses
feux, c’est la tentation, la faille, le doigt planté dans
la paume de la main qui fait mal et transforme Thomas Whitehead,
habitué des rôles torturés, en maniaque
sanguinaire. En face, Tamara Rojo n’est pas si insouciante, elle
sait faire pleuvoir les injures grossières (on sait que les
danseurs de Mats Ek parlent, voire hurlent, la vie n’est pas
simple!), exhale son hispanité et son humanité face
à la froideur de M, l’inquiétante non-rivale…
Avec DGV : Danse à Grande Vitesse,
on pénètre dans un autre univers où
l’imaginaire se laisse porter dans des vagabondages à
l’infini. A l’opposé de Mats Ek, Christopher
Wheeldon crée des œuvres dont l'art pour l’art est
la finalité. Chaque mouvement, chaque pose pourraient se
décomposer comme les images d’un film qu’on
n’a pas encore assemblé, mais qui au son de la musique de
Michael Nyman atteignent la fluidité du 25 images par seconde.
Dans des justaucorps minimalistes aux teintes sobres, les corps
disparaissent en silhouettes dans les tableaux, comme des touches
d’un pinceau très fin.
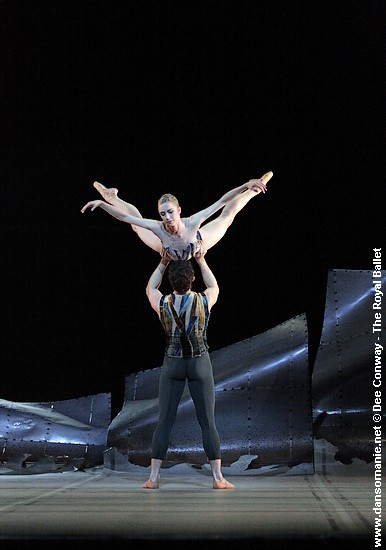
Nathalie Harrison et Garry Avis dans DGV, chor. Christopher Wheeldon
DGV,
créé en 2006, marquait une étape dans
l'œuvre de Christopher Wheeldon qui prend alors une ligne
directrice très précise et très reconnaissable.
Elle s’oriente vers une fascination pour des mouvements dans
l’espace et des constructions très architecturales de ses
chorégraphies de groupe. L’œuvre de Christopher
Wheeldon est une succession de scènes, comme si chaque attitude
pouvait se figer à jamais, et pourtant, tout
s’enchaîne et se lit dans une continuité
étonnante. Avec douze couples étirant leur grandeur sur
le plateau, DGV est une
œuvre monumentale, comme la musique de Michael Nyman jouée
merveilleusement par l’orchestre du Royal Ballet, comme le
décor de Jean Marc Puissant - une bordure de métal aux
pièces mal ajustées en fond de scène
d’où apparaissent ou s’enfuient de temps en temps
les danseurs -, monumental, sobre et surtout très efficace.
DGV,
inspiré par le TGV et surtout la MGV, la "Musique à
Grande Vitesse" de Michael Nyman, est justement
l’antithèse de la grande vitesse, même s’il
évoque des pertes de sensations et de notion du temps. La
chorégraphie, toute en nuances, réitère
constamment l’envol, la suspension, le décalage, comme le
ballon, et se décline autour de quatre couples principaux
virevoltant sur une incroyable musique obsessionnelle qui emporte tout
avec elle. Quatre couples esquissent des pistes, des humeurs et
des ambiances - le dynamisme, la lenteur, l’isolement… -
et interagissent de manière asynchrone. Des assemblages fugitifs
en fond de scène, derrière les parties basses du
décor, et des démultiplications de gestes rendent
les danseurs gigantesques, alors qu’ils sont presque à nu
dans l’immensité de la scène. Christopher Wheeldon
a le don, comme souvent les grands, de réaliser un art
d’une esthétique sophistiquée dans un minimalisme
surréel.
Maraxan © 2009,
Dansomanie
The Seven Deadly Sins
Musique : Kurt Weill
Chorégraphie : Will Tuckett
Anna I : Martha Wainwright
Anna II : Kristen McNally (matinée) / Zenaida Yanovsky (soirée)
Strip club owner : Bennet Gartside (matinée )/ Thiago Soares (soirée)
Stripper : Laura Morera
Motel Man : José Martin
Director : Gary Avis
Fernando : Edward Watson
Edward : Eric Underwood
Carmen
Musique : Rodion Chédrine d'après Georges Bizet
Chorégraphie : Mats Ek
Carmen : Tamara Rojo
José : Thomas Whitehead
Escamillo : Bennet Gartside
M : Lauren Cuthbertson
The Gypsy : Jonathan Howells (matinée) / Brian Maloney (soirée)
The Officer : Viacheslav Samodurov
DGV : Danse à Grande Vitesse
Musique : Michael Nyman
Chorégraphie : Christopher Wheeldon
Avec :
Cindy Jourdain – Ryochi Hirano
Laura Morera – Steven McRae
Melissa Hamilton – Rupert Pennefather
Mara Galeazzi – Sergei Polunin
(Matinée)
Lauren Cuthbertson- Eric Underwood
Leanne Benjamin – Edward Watson
Nathalie Harrison – Gary Avis
Mara Galeazzi – Sergei Polunin
(Soirée)
The Royal Ballet
Orchestra of The Royal Opera House, Covent Garden
Dir. Daniel Capps
Samedi 31 janvier
2009, Royal Opera House, Londres
|
|
|





























