 |




|

 |
|
|
Ballet National du Rhin (Mulhouse - Strasbourg - Colmar)
09 novembre
2008 : Des Ordres / Désordres, au Théâtre Municipal de Strasbourg
Une
valse à trois temps…toujours les mêmes et pourtant
si différents, si singuliers. Cette année, Bertrand
d’At, directeur de la danse du Ballet du Rhin, a choisi comme
incipit de nous dévoiler un triptyque de
chorégraphes contemporains dont le travail s’inscrit
parfaitement dans cette nouvelle mouvance à laquelle le Ballet
du Rhin aspire. Ce spectacle intitulé Des Ordres / Désordres est composé de trois pièces (Retour à Dogville - Immanence - Flockwork)
qui plongent le spectateur dans un univers parfois
théâtralisé composé de mouvance, de langage
gestuel, et d’une recherche de la pureté absolue du
mouvement où le langage du corps reprend tout son sens.
Dans Retour à Dogville,
Hervé Maigret nous propose une relecture chorégraphique
du très surprenant opus cinématographique de Lars von
Trier, Dogville. Ce jeune
chorégraphe, accompagné de ses collaborateurs Nathalie
Licastro et Stéphane Bourgeois avec lesquels il a
travaillé de nombreuses années au Centre
Chorégraphique de Nantes et fondé sa compagnie nc25,
tente de recréer par le biais de l’art
chorégraphique l’atmosphère très
particulière du film. Le ballet est une succession de
scènes de la vie quotidienne dans les années 1960,
au sein d‘un village perdu aux confins des Etats-Unis vivant en
complète autarcie et relié au monde au moyen d’un
transistor. Le décor disposé en arc de cercle
évoque des tranches de vie, des espaces intérieurs, et
représente successivement une salle de cinéma, une salle
à manger, une salle de classe, une épicerie, un bar, une
cuisine, une chambre à coucher dont les murs sont réels
pour les acteurs et fictifs pour les spectateurs, offrant à
ceux-ci, au moyen de la disposition panoramique, la possibilité
de laisser errer le regard à leur gré. Ce
kaléidoscope est pourtant rythmé par un fil conducteur
qui est l’apparition du premier personnage, le balayeur : sous
l’influence du transistor, il actionne la cloche au centre de la
scène et là, commence la plongée dans
l’inconscient, dans une sorte de quatrième dimension. La
cloche sonne le glas, et l’on bascule alors dans un univers
obscur de rêve où tout est possible, même le pire.

Jonathan Freches et Virginie Bigois dans Retour à Dogville (chor. Hervé Maigret)
Le
spectateur assiste alors à la mise en place d’une
étrange dualité : d’un côté, on a un
couple en crise qui se dispute et de l’autre côté,
un couple d’amoureux qui n’aura de cesse de s’enlacer
et de s’embrasser tout au long du ballet. La scénographie
du ballet fait alterner, par une savante alchimie, une danse
théâtralisée et une focalisation - un plan
rapproché sur un groupe de protagonistes -, notamment au moyen
des éclairages. L’expression «mettre en
lumière» prend ici tout son sens. Chaque groupe de
danseurs semble vaquer à ses occupations sans porter
intérêt de ce qui peut se passer autour de lui,
jusqu’au moment où Miss Grey, actionnant la cloche
à son tour lors de son très sensuel solo, réveille
les autres danseurs qui la rejoignent et l’accompagnent dans une
aliénation collective, une danse de Sabbat
matérialisée par des mouvements robotisés et
stéréotypés. La conséquence de ce retour
des hommes à l’état primitif sera le viol de Miss
Grey. La tension atteint alors son paroxysme, on bascule dans le
«désordre», dans l’irréparable.
Malgré ce qui se passe sous leurs yeux, les autres protagonistes
continuent leurs activités dans un décor à peine
éclairé, comme pour matérialiser leur
indifférence. Puis la cloche retentit à nouveau, comme
pour espérer un retour à la normale. La
frénésie est passée, mais peut-on en sortir
indemne? Les parties dansées sont sublimées par le
très bon jeu de scène, notamment lors du pas de deux
adultérin entre le mari et l’institutrice qui rompt le
cours du ballet et est d’une sensualité exacerbée.
Cette délicieuse parenthèse faite dans un presque silence
évoque toujours et encore cette échappée de la
conscience humaine, cet espoir d’un au-delà meilleur,
différent, comme ce puzzle musical qui compose la musique du
ballet et dont le transistor est l’objet sacralisé. On
soulignera la très belle interprétation d’Emilie
Krieger dont les talents de danseuse sont à l’égal
de ses talents de comédienne.
Le second ballet, Immanence, est une création d’Andonis Foniadakis. Il a lui aussi créé sa propre compagnie, intitulée Apotosoma,
après avoir travaillé avec Béjart et Teshigawara,
et développe une danse essentiellement dirigée vers la
recherche du geste parfait, du geste pur. Par conséquent, il
propose un ballet difficile où la virtuosité des danseurs
est une réalité incontestable. Dans un premier temps, la
chorégraphie présente un seul danseur accompagné
par une musique composée de longs moments de silence. Il est
ensuite rejoint par deux autres danseurs et finalement par trois
danseuses. Le ballet est une succession de mouvements d’une
fluidité extrême, avec une gestuelle langoureuse qui
dépasse les limites du corps et des membres pour atteindre un
infini. On entre dans un univers d’abstraction absolue où
les mots sont insensés, inutiles. Comment expliciter
l’inexplicable, le sensationnel?
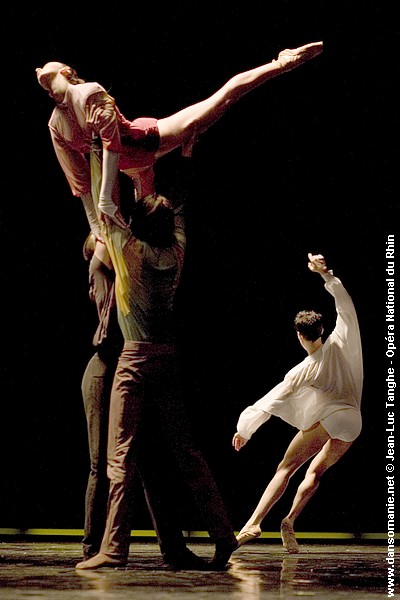
Immanence (chor. Andonis Foniadakis)
On se
retrouve à la genèse du mouvement, à la
quintessence de toute création. Y a-t-il quelque chose à
comprendre alors? Le décor - un simple éclairage qui
souligne par contraste l’obscurité de la scène - et
les costumes épurés nous laissent dans
l’expectative. Dans les méandres de l’inconscient,
de l’animalité, les mouvements deviennent des
impulsions électriques qui ne s’apaisent qu’une fois
les corps réunis dans les différents pas de deux. Lorsque
le rythme du ballet ralentit, le geste se décompose avec une
langueur délibérée, en opposition avec une musique
conceptuelle à la limite de l’audible. Tout au long du
ballet la scansion du mouvement est en parfaite opposition avec la
musique. En définitive, Immanence est une manifestation de la
pensée à travers la perfection gestuelle.
Le dernier ballet, Flockwork,
d’Alexander Ekman, est quant à lui une parenthèse
humoristique où la danse est à la fois le moteur et
l’accessoire de la pièce. Inspiré par Mats Ek et
Jiri Kylian, ce chorégraphe a d’abord créé Flockwork
pour le Nederlands Dans Theater II en 2006. Lorsque Bertrand d’At
l’a invité à travailler avec le Ballet du Rhin, il
a décidé de retravailler son ballet en
réactualisant les différentes données symboliques
enrichies par la personnalité des danseurs du Ballet du Rhin. La
scénographie est composée d’un jeu d’ombres
et de lumières, où le noir et le blanc aussi bien dans
les décors que dans les costumes participent à la
sobriété de l’ensemble et se révèlent
d’une efficacité hors norme.

Flockwork (chor. Alexander Erkman)
Dire que la danse en est l’élément moteur serait
mentir, car c’est avant tout une mise en scène, une
savante alchimie au sein d’un univers dans lequel le spectateur
adhère sans conteste dès l’ouverture du ballet. Le
caractère burlesque est relevé à la fois par le
comique de situation, par l’incongruité des décors
et par le jeu des interprètes qui, tout en étant
d’une jeunesse remarquée, en devient remarquable par la
qualité de leur appropriation de la pièce. Le public
bascule du statut de spectateur à celui d’acteur, lorsque
les danseurs l’apostrophent, le considèrent et
l’intègrent à l’action. Les jeux de
lumière, ceux des «dans’acteurs», et ceux des
décors participent à cette communion qui, malgré
l’omniprésence de l’opposition noir/blanc,
opère une fusion où les corps mélangés se
font objet de décor. Les corps-décors décorent,
jouent avec les éléments de décor,
entraînant le spectateur dans un tourbillon final qui
surenchérit par l’ajout d’un ultime
élément : l’image. De la chorégraphie
initiale naît une graphie ultime et innovante des corps dans
l’espace. Tout concourt à faire de cette pièce un
bijou inestimable où le spectateur prend
énormément de plaisir. On retrouve également une
caractéristique, chère à Bertrand d’At, qui
est de faire des danseurs des machinistes, des acteurs à part
entière de la scénographie : on se souvient notamment de
son Roméo et Juliette ou de son Mandarin Merveilleux
où les danseurs interagissent sur les éléments de
décor. Ce ballet exprime la parfaite corrélation entre
plusieurs arts visuels, formant ainsi une pièce
équilibrée et très plaisante qui a
enchanté le public. Cette pièce clôture un
triptyque de très grande facture. L’interprétation
à la fois dansée et jouée des artistes a
été saisissante de qualité et le choix de Bertrand
d’At de réunir trois pièces si divergentes, mais
motivées par la seule notion de plaisir à partager avec
le spectateur, est une réussite.
Isabelle Schermesser © 2008,
Dansomanie
Retour à Dogville
Chorégraphie : Hervé Maigret
Assisté de Nathalie Licastro, Stéphane Bourgeois, Didier Merle
Conception sonore : Jérémie Morizeau
Scénographie : Cyrille Bretaud
Costumes : Hervé Maigret, Cyrille Bretaud
Lumières : Nathalie Ringeisen
Immanence
Chorégraphie : Andonis Foniadakis
Assisté de Claude Agrafeil
Musique : Julien Tarride
Costumes : Andonis Foniadakis
Assisté de Marion Schmid
Lumières : Nathalie Ringeisen
Flockwork
Chorégraphie, décors, vidéo musique et conception sonore : Alexander Ekman
Assistantes à la chorégraphie : Claude Agrafeil, Célia Amade
Costumes : Alexander Ekman, Joke Visser
Lumières : Tom Visser
Ballet de l’Opéra national du Rhin
Théâtre Municipal de Strasbourg
Dimanche 09 novembre 2008, 15h00
|
|
|





























