 |




|

 |
|
|
Royal Ballet (Londres)
14 novembre
2008 : Voluntaries, The Lesson et Infra, au Royal Opera House
Avant le marathon de décembre et son incontournable Casse-noisette,
le Royal Ballet présente actuellement pour cinq soirées
une nouvelle triple affiche avec une création de son
chorégraphe résident, Wayne McGregor, qui, depuis sa
nomination, avait surtout produit ailleurs… Pour accompagner cet
opus, la compagnie a choisi de remettre sur la scène Voluntaries (1973) de Glen Tetley et, afin de contraster sans doute, The Lesson (1963) de Flemming Flindt, inspiré de la pièce d’Eugène Ionesco.
La Leçon
est un ballet difficile à insérer dans un programme et,
coincé entre deux longs entractes, il fait fonction de grande
pause qui permet de s’aérer du caractère
obsessionnel des deux autres pièces. Ce n’est pas
qu’on se détend avec le ballet de Flemming Flindt, car,
dès l’apparition décalée d’Edward
Watson, la tension monte. Il réalise en quelque vingt minutes,
une phénoménale composition, arrachant les rires
dès son arrivée ; d’abord agité de tics, il
plonge dans l’angoisse au fur et à mesure de son escalade
vers la folie meurtrière. Son visage émacié, ses
cheveux rebelles, son regard perçant conviennent parfaitement
à ce rôle de psychotique ; la manière dont il
écrase la scène de sa présence est conforme
à ses talents d’acteur maintes fois loués dans ce
type de rôle. Il sait à la fois rendre l’aspect
névrotique du personnage, mais aussi l’inscrire dans un
esprit d’humour noir qui ne franchit jamais les limites du drame.
Un grand travail d’acteur, soutenu par l’excellente
Elizabeth McGorian en pianiste tout aussi névrosée et
très présente. Les deux éclipsent un peu la jeune
Yuhui Choe, tendre victime moins poison que certaines autres
interprétes du rôle. De la danse "pure", il y en a peu
pour servir l’aura des interprètes, des explosions du
professeur soulignant quand même l’élévation
du danseur, et la maîtrise de Yuhui Choe qui lui permet de rendre
les passages les plus torturés où le professeur la
martyrise de manière assez spectaculaire. C’est un peu
cette tension entre le jeu de l’acteur et tout ce qui n’est
pas habituel dans le ballet classique qui fait le charme de cette
œuvre qui a le bon goût de ne pas être longue
ou redondante.
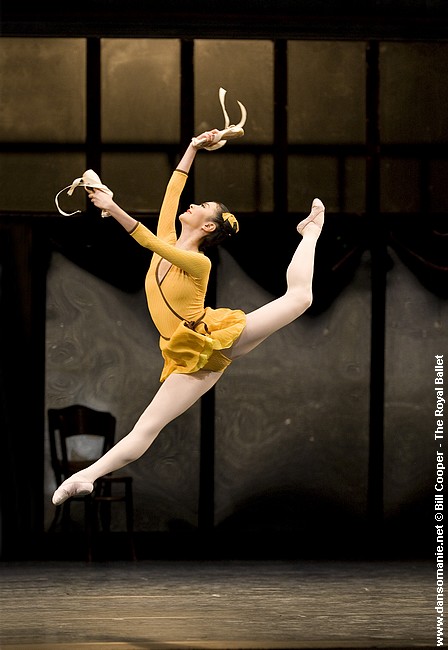
Yuhui Choe (l'Elève) dans The Lesson (chor. Flemming Flindt)
Il y a maints points communs entre les deux autres ballets qui figurent au programme. Voluntaries, de Glen Tetley, ouvrait la soirée de manière très solennelle, sur le Concerto pour orgue
en sol mineur de Francis Poulenc. L’ouvrage aspire à une
certaine plastique, magnifiée notamment par des costumes simples
mais saisissants : des justaucorps en lycra blanc parsemés de
pois multicolores sur le haut du corps ou les jambes dans un cas, des
tee-shirts et des slips tricolores, noirs, gris ou blancs (seule Lauren
Cuthbertson porte une jupette et Eric Underwood, torse nu, un pantalon)
dans l’autre. Cette mise en valeur des corps des danseurs aux
lignes ascétiques tourne vers une certaine androgynie qui, mise
à part les nombreux portés (à la russe dans Voluntaries, au niveau de la taille, et d’ailleurs plutôt manipulations, dans Infra)
se retrouve dans une chorégraphie plutôt
athlétique, même si les filles ont des pointes dans les
deux œuvres. Les lignes effilées font alors partie
intégrante de la chorégraphie de Glen Tetley qui utilise
largement ces corps pour créer des dessins dans l’espace.
Les pas de deux sont très divers et les couples sont aussi bien
mixtes, féminins ou masculins. La répétition est
aussi de mise, comme une obsession de la perfection du geste, comme un
écho à la musique également. Evidemment, Max
Richter n’est pas Francis Poulenc mais l'ambiance est tout aussi
morose. On retrouve chez Wayne McGregor ce goût pour le
mélange des musiques électroniques, très avant
garde, et le classique pur, qui s’exhale dans la composition de Max
Richter, des sons un peu venus d’ailleurs à la Mogwai,
quelquefois mêlés à des bruits de voix, des
saturations très «noisy» avant de reprendre le
rythme des violons et violoncelles, le Max Richter Quintet assurant la
représentation.
Le décor est également minimaliste, un cercle en relief
au style pointilliste pastel rappelant la tenue des danseurs dans Voluntaries,
une fine projection de dessins de personnages marchant au-dessus des
danseurs dans Infra, composition minimaliste de l’artiste Julian
Opie. Il y a aussi cette scénographie très poussée
qui vit à côté de la chorégraphie comme un
élément déterminant du visuel. Dans les deux
oeuvres, on construit des lignes, on organise l’espace par des
placements et des poses sur scène très
déterminantes dans la réussite esthétique de ces
ballets abstraits. Si Voluntaries
construit une géométrie par addition des corps, Infra
porte la marque des contorsions d’une chorégraphie
où un seul corps suffit et plusieurs donnent le tournis. La
principale différence se situe au point de vue du vocabulaire
chorégraphique, même si, là encore, Glen Tetley
s’inscrit dans son époque comme Wayne McGregor dans la
sienne.

Sergeï Polunin dans Voluntaries (chor. Glen Tetley)
Voluntaries
est une ode aux portés et aux arabesques, aux pirouettes et aux
grands jetés dont l’agencement semble uniquement
préoccuper le chorégraphe. Les entrées de groupes
sont souvent fracassantes et spectaculaires. Celles des couples plus
douces et discrètes. Federico Bonnelli et Leanne Benjamin font
à nouveau cause commune en alternance avec un trio, formé de Mara
Galeazzi, Sergei Polunin et Thiago Soares, tous très en verve. Les
deux premiers, souvent seuls, se déplacent lentement dans
l’espace, comme pour y laisser des marques invisibles - les jambes
de Leanne Benjamin développant de multiples arabesques -, qui les
conduisent vers un retour au centre récurrent, devant le rond
gigantesque qui constitue l’unique décor du ballet. Les
tableaux sont rythmés par les différents groupes de
danseurs et par les variations de lumière, mais la
chorégraphie reste assez similaire et la musique de Francis
Poulenc a du mal à maintenir l’attention.
Chez Wayne McGregor, l’utilisation de la répétition
est tout autre car elle se fond dans la musique, elle-même
répétitive, voire obsessionnelle. Elle est un écho
aux mouvements du corps électrisés typiques du
chorégraphe et qui sont presque per se son unique moyen
d’expression. Avec Infra,
Wayne McGregor apporte une pierre décisive à son style
chorégraphique si particulier dont il instaure
définitivement un vocabulaire que l’on retrouve de ballet
en ballet. Si le chorégraphe a souvent dans la construction de
ses oeuvres un propos très précis, celui-ci n’est
pas toujours lisible dans les mouvements proposés par les
danseurs. Dans Infra,
contrairement à ses précédents opus, il
s’affranchit du geste pur pour dire quelque chose de
manière pas très évidente, mais qui le distingue
de Qualia ou Chroma, ou encore de Genus et d'Entity, plus récents.

Eric Underwood et Melissa Hamilton dans Infra (chor. Wayne McGregor)
Le ballet s’ouvre sur Edward Watson, égérie du chorégraphe, danseur au corps «mcgregorien»
par essence, dont les mouvements de tête de dos montrent
qu’il observe et réfléchit. Ce thème est
repris notamment lors d’un long passage où il se confronte
à lui même, réitère des gestes, presque de
mime, compulsifs vers la fin du ballet, alors que Leanne Benjamin et
Mara Galeazzi dansent en duo sur le devant de la scène. On peut
voir à travers les couples qui se forment et se
déforment l’écho de ces personnages qui marchent
au-dessus de la scène, des rencontres qui commencent ou se
terminent : Ricardo Cervera et Lauren Cuthbertson devisant au milieu de
la scène, en visible désaccord, puis se tenant par la
main, Edward Watson passant de Leanne Benjamin à Marianela
Nuñez, paroxysme du couple androgyne, où la silhouette
diaphane d’Edward Watson se confond avec celle de
l’athlétique danseuse. Un passage très
structuré voit les six couples du ballet prendre place tour à
tour dans des rectangles blancs dessinés sur scène
pour une chorégraphie endiablée, asynchrone et
terriblement envoûtante. Lorsque l’écran
s’éteint, la scène se remplit de personnages qui
semblent en être descendus, des gens habillés en civil
traversent la scène comme les bonshommes de Julian Opie
précédemment, emmenant avec eux les danseurs.
Avec Infra, Wayne McGregor
ouvre une porte vers une autre dimension de son œuvre, tout en
établissant concrètement un vocabulaire qu’il est
sans doute le seul à pouvoir utiliser de la sorte. Il construit
en tout cas une œuvre qui, portée par le Royal Ballet mais
s’étendant maintenant au-delà de la compagnie, prend
forme et marquera distinctement ces années.
Maraxan © 2008,
Dansomanie
Voluntaries
Chorégraphie : Glen Tetley
Leanne Benjamin, Federico Bonelli
Mara Galeazzi, Sergei Polunin, Thiago Soares
Helen Crawford, Melissa Hamilton, Hiraku Kobayashi, Emma Maguire, Sian Murphy, Samantha Raine
Ryochi Hirano, Kenta Kura, Brian Maloney, Ernst Meisner, Johannes Stepanek, Thomas Whitehead
The Lesson
Chorégraphie : Flemming Flindt
The Teacher : Edward Watson
The Pupil : Yuhui Choe
The Pianist : Elizabeth McGorian
Infra
Chorégraphie : Wayne McGregor
Leanne Benjamin, Yuhui Choe, Lauren Cuthbertson, Mara Galeazzi, Melissa Hamilton, Marianela Nuñez
Ricardo Cervera, Ryochi Hirano, Paul Kay, Eric Underwood, Jonathan Watkins, Edward Watson
|
|
|





























