 |




|

 |
|
|
Ballet du Capitole de Toulouse
01 novembre 2008 : Coppélia au Théâtre du Capitole de Toulouse
Le Ballet du Capitole a ouvert sa saison 2008-2009 par une reprise très attendue de Coppélia, présentée au Théâtre du Capitole de Toulouse les 30, 31 octobre et 1er novembre derniers.
Spectacle brillant placé à mi-chemin entre rêve et
réalité, cette nouvelle chorégraphie du ballet,
réalisée par Nanette Glushak d’après la
version du chorégraphe cubain Enrique Martinez -
créée à l’Académie de Musique de
Brooklyn le 24 décembre 1968 et restée longtemps au
répertoire de l’American Ballet de New York - avait
été présentée pour la première fois
par le Ballet du Capitole, à Toulouse, le 16 mai 1997. Pour ce
qui est de l’actuelle reprise, Nanette Glushak associée
à Michel Rahn avait souhaité mettre davantage en valeur
le corps de ballet et renouveler le langage chorégraphique dans
le sens d’une plus grande exigence technique : elle a pleinement
atteint les objectifs qu’elle s’était fixé,
offrant au public toulousain quatre représentations de
très grande qualité.

Evelyne Spagnol (Swanilda) - Breno Bittencourt (Franz)
Depuis la première de Coppélia
le 25 mai 1870 au Théâtre Impérial de
l’Opéra, salle Le Peletier, jusqu’à nos
jours, en passant par sa reconstitution par Pierre Lacotte le 18
décembre 1993 au Palais Garnier, le célèbre
ballet n’a pratiquement connu aucune rupture dans la
continuité de sa transmission. Toutefois, depuis quelques
années, la beauté de la musique de Delibes, la
qualité littéraire du conte d’Hoffmann,
L’Homme au sable, le charme du livret de Charles Nuitter et
Arthur Saint-Léon et l’exceptionnelle invention
chorégraphique d’Arthur Saint-Léon, sur lesquels il
se fonde, ont suscité de très nombreuses relectures de
l’œuvre. Certains chorégraphes contemporains ont mis
à jour et développé des thématiques
sous-jacentes à l’intrigue (mythe de Pygmalion, par Roland
Petit, à Marseille en 1975, image de la poupée Barbie,
par Maguy Marin, à Lyon en 1993), modifié de
manière significative la structure de l’œuvre
et accentué sa dimension fantastique (création
d’un rôle fascinant d’étoile, pour un
Coppélius maléfique, par Patrice Bart, au Palais Garnier
en 1996), plus simplement transposé l’œuvre
dans un tout autre contexte que celui du livret d’origine (une
petite ville des États-Unis animée par des
«marines», au début des années cinquante, par
Charles Jude à Bordeaux en 1999) ou encore, très
récemment, au début de 2008, opté pour un parti
pris de fantaisie tonique (tel Jo Strømgren avec le Ballet de
l’Opéra national du Rhin à Strasbourg, ) ou de
fantaisie débridée (tel Cisco Aznar avec le Ballet du
Grand Théâtre de Genève, à Paris au
Théâtre national de Chaillot, et à Lyon).
La chorégraphie d’Enrique Martinez,
remaniée par Nanette Glushak et Michel Rahn, n’est pas,
quant à elle, de cette veine audacieuse ou iconoclaste. Elle
peut être qualifiée de classique et de conforme à
la tradition, dans la mesure où l’argument n’a pas
été modifié, où danse et pantomime
s’équilibrent, où le caractère expressif du
pas de deux et des variations est contrebalancé par la
vivacité et la couleur des ensembles et où les danses de
caractère sont traitées avec le relief saisissant
qu’elles exigent. L’originalité de la
création du chorégraphe cubain réside dans
une vision sereine et optimiste de l’œuvre, devenue, sous
sa signature, une amusante comédie, teintée
d’esprit populaire, marquée
d’étrangeté mais dénuée de toute
implication dramatique ou fantastique -, en quelque sorte un hymne
radieux à la jeunesse et à la vie.

Pascale Saurel dans la Mazurka
La
structure du ballet, dans la version Martinez, est en trois actes.
Après le prélude introductif confié à
l’orchestre, l’Acte I présentait successivement la Valse, la Mazurka, la Ballade de l’Épi, le Thème slave varié, la Czardas
et le Final. On a pu regretter que les danses n’aient pas
toujours été données dans leur
intégralité : ainsi, le public a-t-il été
privé de la quatrième variation pour clarinette soliste
du Thème slave et
n’a pu de ce fait apprécier cette musique
pénétrante, de caractère alangui, sur laquelle se
développe habituellement un magnifique solo où Franz,
déjà amoureux, exprime la fascination et l’attrait
qu’exerce sur lui la poupée Coppélia, assise
immobile à la fenêtre de la maison de vieux magicien.
Après l’entracte symphonique, l’acte II se composait
de la Musique des automates, de la Chanson à boire, de la Valse de la Poupée, du Boléro, de la Gigue
et des diverses scènes qui précèdent ou suivent
ces pages célèbres. Quant au IIIème acte, il
reprenait presque intégralement le IIIème acte
d’origine [dont on se souvient qu’il avait
été imaginé par Delibes, en conclusion à
son œuvre, comme un somptueux spectacle de noce paysanne
où les villageois figuraient des allégories des travaux
et des jours, mais auquel le compositeur avait dû rapidement
renoncer, car ce divertissement avait été jugé
trop long et surtout dépourvu de ressort dramatique], faisant se
succéder la Fête de la Cloche, la Danse des Heures, la Variation de l’Aube (ou l’Aurore), la Variation de la Prière, le grand Pas de deux (ou la Paix), la Danse de la Guerre (ou La Discorde et la Guerre), une variation - interpolée - de Franz, la variation de Swanilda et enfin le Final.
Pour les quatre représentations du ballet, deux distributions
avaient été prévues. Malheureusement, dans la
première distribution, le public toulousain ne put revoir en
Swanilda la première soliste Maria Gutierrez à laquelle
il est très attaché. Malencontreusement blessée
dans un accident de la circulation, elle dut être
remplacée. De plus, dans la seconde distribution, la
demi-soliste Maria Lucia Segalin, malheureusement blessée au
pied, ne put, elle non plus, être distribuée en Swanilda.
Ces circonstances fâcheuses ont malgré tout connu une
issue favorable puisqu’Evelyne Spagnol a pu sauver la situation,
assumant à elle seule le rôle de Swanilda dans les quatre
représentations. Les spectateurs ont ainsi pu retrouver celle
qui avait été première soliste à Toulouse
jusqu’en 2002 et qui vient de quitter le Ballet de Zurich. Elle
s’est montrée une artiste d’une très grande
sûreté technique, endurante et engagée, aussi
souveraine dans le Pas de deux du III, que précise dans la Valse de la poupée ou brillante dans le Boléro et la Gigue
du II. Son mime avait beaucoup de vivacité et elle campait une
Swanilda pleine de détermination. Elle fit aussi merveille dans
les déboulés du Final.
Breno Bittencourt, premier soliste, était Franz dans la
première distribution. Sa maîtrise technique prodigieuse
a, une nouvelle fois, ravi le public. Il campait un Franz plein de
vitalité, visiblement séducteur et plutôt
décidé à en découdre avec Coppélius.
Son élévation est étonnante. Ses tours en
l’air (dont un, quatre) et ses grands jetés furent
impressionnants, en particulier dans l’avant-dernière
variation du Thème slave et dans la Variation interpolée
du III. Il formait avec Evelyne Spagnol un couple
équilibré, complice dans la Ballade de
l’Épi. Il fut aussi, dans la Czardas, le partenaire
fougueux de Gaëlle Riou, danseuse au talent prometteur à
qui était également confiée la Variation de
l’Aube.

Breno Bittencourt (Franz) - Evelyne Spagnol (Swanilda)
Kazbek Akhmedyarov, premier soliste nouvellement engagé au
Ballet du Capitole, était Franz dans la deuxième
distribution. Merveilleusement doué, le jeune Kazakh
s’est fait remarquer autant par sa technique impeccable que par
son expression inspirée et sensible. Il campait un Franz
juvénile, aimant s’amuser, quelque peu naïf,
tantôt amoureux ou volage, tantôt viril mais sans
agressivité. Son mime fut poétique (en particulier dans
le I), et l’on pouvait lire, dans ses entrechats et ses
brisés volés, la joie désinvolte de Franz au
début de l’action. Il vola littéralement au dessus
de l’établi de Coppélius (dans le II) et se montra
d’une virtuosité spectaculaire dans le tour de force
conclusif de la Variation interpolée du III. Il fut aussi
le partenaire énergique de Paola Pagano dans le couple soliste
de la Czardas de la deuxième distribution.
Michel Rahn, chorégraphe, professeur et assistant-directeur du
Ballet du Capitole, était un Coppélius extraordinaire.
Son mime complexe et très fouillé rendait compte de
toutes les facettes du personnage, tour à tour vieillard fragile
et pitoyable, être ridicule, fantasque, en butte aux moqueries et
aux méchancetés de la jeunesse, inventeur
impénitent amoureux de sa créature, bafoué,
jaloux, dupé et trouvant pour finir une consolation dans
l’argent qu’on lui donne… Paola Pagano,
première soliste, dansait la Variation de la Prière.
Très grande, vêtue d’une vaporeuse robe bleu
ciel, l’artiste a impressionné et ému par sa
concentration. La noblesse de ses ports de bras suscitait
l’admiration.
Magali Guerry, soliste, dansait la Variation de l’Aube
dans la deuxième distribution. Elle charma par la
légèreté et la vivacité raffinées de
sa prestation. Coppélia, la poupée immobile,
habillée d’une robe rouge ou dénudée en
maillot blanc, était remarquablement incarnée par Sonia
Le Puil, jeune danseuse encore étudiante dans une école
de l’agglomération toulousaine et servie par un physique
des plus agréables. Les Amis de Franz, bons vivants, et les
Amies de Swanilda, malicieuses ou effrayées, faisaient montre de
belles qualités techniques et d’un réel engagement.
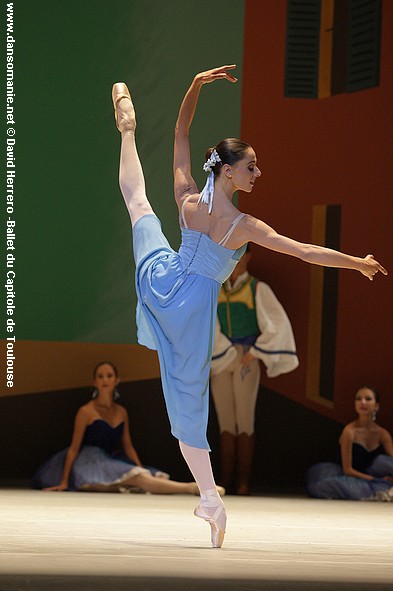
Paola Pagano dans la Variation de la Prière
Les
Automates du II étaient incarnés par six artistes pleins
d’entrain et de fantaisie appartenant au corps de ballet,
différents d’une distribution à l’autre. Leur
intervention dynamique sur la Musique des Automates était
cependant de courte durée puisqu’Evelyne Spagnol (en
Swanilda substituée à Coppélia) dansait
elle-même, déguisée, le Boléro de l’Espagnole puis la Gigue
de l’Écossaise. Ce fut enfin un réel plaisir de
voir les ensembles bien réglés du III, la nature
poétique de la Danse des Heures contrastant avec le caractère belliqueux de la Danse de la Guerre.
Dans cette production, on pouvait admirer les ravissants
costumes dessinés par Bruno Schwengl. Inspirés du
folklore, les costumes nationaux étaient d’un blanc
éclatant rehaussé de rouge, de vert et aussi de
jaune. Les tutus longs portés par les Heures nocturnes
étaient d’un bleu nuit scintillant, d’un très
bel effet. Les décors réalisés eux aussi par le
décorateur autrichien, très réussis,
évoquaient successivement la place du marché d’une
petite ville de Galicie, l’atelier de Coppélius et une
vaste esplanade de cette petite ville. Dans son travail, Bruno Swengl a
eu recours à l’illusion plaisante du décor dans le
décor et a utilisé de belles images
stylisées et symboliques de l’Horloge et de la Cloche. Les
lumières d’Allain Vincent étaient vives dans le I,
claires dans le III, sombres et mystérieuses dans le II,
accompagnant parfois d’un éclat blafard le personnage
fantasque de Coppélius.
Une formation orchestrale composée de musiciens appartenant
à l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et de
musiciens extérieurs (puisque la phalange toulousaine
était en tournée), placés sous la baguette
précise et vigoureuse du chef mexicain Enrique
Carreón-Robledo, a magnifiquement servi la partition de Delibes,
lui restituant ses rythmes variés, ses couleurs instrumentales
contrastées, son élégance et son humour. Le tempo
était en général rapide, même dans les pages
purement symphoniques (Prélude, Entracte) et,
nécessité chorégraphique oblige,
laissait très peu de place aux effets de rubato qui
contribuent d’ordinaire à accentuer le «charme
slave» de cette musique de ballet. Une mention
particulière doit être adressée à Blagoja
Dimchevski, violon solo, qui a conféré à la Ballade de l’Épi
un caractère de simplicité émouvante,
à Charlotte Bletton et Cécile Robillard,
flûte et flûte piccolo, à Joseph-Marie Fillatreau,
Florent Tisseyre et Gilles Rancitelli, percussions, qui, par leur
habileté virtuose, ont donné à de nombreux
passages de l’œuvre et en particulier à la Musique
des Automates et à la Valse des Heures, une poésie et un
éclat incomparables.

Evelyne Spagnol (Swanilda)
Cécile Tarot © 2008,
Dansomanie
Coppélia
Chorégraphie : Enrique Martinez, adaptée par Nanette Glushak et Michel Rahn
Musique : Léo Delibes
Décors & costumes : Bruno Schwengl
Eclairages : Allain Vincent
Swanilda : Evelyne Spagnol (matinée / soirée)
Franz : Kazbek Akhmedyarov (matinée) / Breno Bittencourt (soirée)
Coppélius : Minh Pham (matinée) / Michel Rahn (soirée)
Coppélia : Sonia Le Puil (matinée / soirée)
La Poupée chinoise : Vladimir Bannikov (matinée) / Frédérik Sellier (soirée)
La Poupée arabe : Guillaume Ferran (matinée) / Fabien Cicoletta (soirée)
L'Arlequin : Raphaël Paratte (matinée) / Hugo Mbeng (soirée)
L'Espagnole : Darya Kojevnikova (matinée) / Leire Cabrera (soirée)
L'Ecossaise : Estelle Fournier (matinée) / Ina Lesnakowski (soirée)
Le Prêtre : Patrick Segot (matinée / soirée)
Variation de l'Aube : Magali Guerry (matinée) / Gaëlle Riou (soirée)
Variation de la Prière : Lucille Robert (matinée) / Paola Pagano (soirée)
Mazurka : Nuria Arteaga - Raphaël Paratte (matinée) / Pascale Saurel - Davit Galstyan (soirée)
Czardas : Paola Pagano - Kazbek Akhmedyarov (matinée) / Gaëlle Riou - Breno Bittencourt (soirée)
Danse des Heures : Nuria Arteaga
Danse de la Guerre : Vladimir Bannikov
Ballet du Capitole de Toulouse
Orchestre du Capitole de Toulouse
Direction musicale : Enrique Carreon-Robledo
Samedi 1er novembre 2008, 15h00 (matinée) et 20h00 (soirée), Théâtre du Capitole, Toulouse
|
|
|





























