 |




|

 |
|
|
English National Ballet
Du 02 au 05 juillet
2008 : Festival Ballet au Royal Festival Hall
Festival Ballet
fêtait le retour de l’English National Ballet au Royal
Festival Hall qui lui fut jadis associé lorsque la compagnie s’appelait encore
London Festival Ballet. Cette triple affiche pariait sur la diversité avec,
pour débuter, A Million Kisses to my Skin, une chorégraphie de David
Dawson dynamique et jouissive, très moderne tout en utilisant un vocabulaire
classique dépouillé et régénéré dans une construction étourdissante sur le Concerto
n°1 pour clavier et orchestre en ré mineur, puis, un opus plus lent et plus
sombre de Wayne Eagling - des impressions et sentiments retenus sur les Rückert
Lieder de Gustav Mahler chantés par Elizabeth Sikora -, et, pour terminer,
l’hommage à l’académisme avec Etudes d’Harald Lander, l’une des
signatures de la compagnie.
Mais
diversification ne signifie pas antinomie et les deux premiers ballets ont un
parti pris esthétique qui rejoint un peu la perfection stylistique et la
composition carrée du dernier. Les scénographies sont très travaillées et la
succession de tableaux dessinés au millimètre d’Etudes répond
parfaitement aux courses folles organisées dans le moindre détail d'A
Million Kisses ou les déplacements raisonnés de Resolution.

Jenna Lee dans A Million kisses to my skin, chor. David Dawson
Le carré
de sol blanc cerné de verticalité noire d'A Million Kisses accueille des
danseurs en blanc qui se jouent des lumières à l’horizontale en détachant leur
silhouette sur le fond noir, ou en projetant à la verticale leur ombre sur le
sol. Ils ne sont que vitesse et lyrisme, dans une démonstration de vélocité -
et par conséquent de virtuosité - et une recherche frénétique du mouvement
perpétuel, incarnation de l’hésitation, de l’accord ou du refus, les corps se joignant
et se repoussant. Un passage lent central oppose à ce tourbillon enivrant une
douceur suave, comme un ralenti des mouvements précédents, plus lisibles. Les
ombres se meuvent fébrilement comme à la poursuite de leurs propriétaires,
démultipliant les effets. Thomas Edur et Agnes Oaks irradient un lyrisme absolu
dans leur partenariat fusionnel et d’une perfection glacée, avant d’être
rejoints par leurs "faux doubles", Elena Glurdjidze et César Morales,
dans un jeu de synchronies et d’asymétries, puis enfin, par le troisième
couple, Erina Takahashi et Fernando Bufalá pour la première, Anton Lukovkin
pour les autres représentations.
La dynamique du ballet repose sur de constants mouvements,
relancés par des successions de mini voire micro tableaux avec des sorties et
entrées de scène spectaculaires. Il y a une très belle distribution des
partenariats, entre les danseurs et danseuses, du solo au trio en passant bien
sûr par les traditionnels duos et mouvements de groupe, en particulier un
sextuor de femmes très brillant, dans tous les sens du terme.
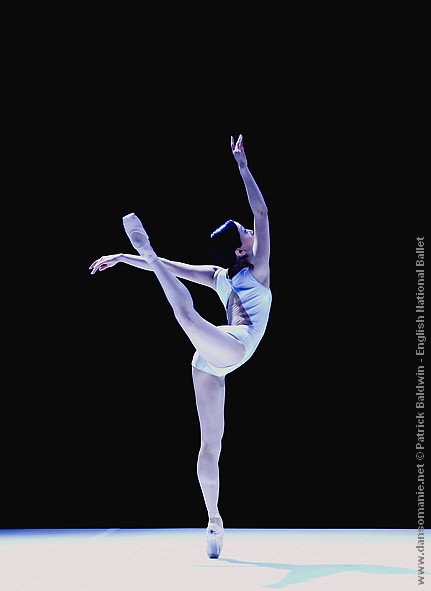
Erina Takahashi dans A Million kisses to my skin, chor. David Dawson
Le
malaise de Fernando Bufalá le soir de la première, après la blessure de Dmitri
Gruzdyev, a malheureusement entamé l’intégrité du ballet pour les soirées
suivantes, Anton Lukovkin appelé à le remplacer le matin de la deuxième
représentation n’ayant pu répéter assez longuement. Ce ballet étant
excessivement demandeur en matière de
placements, de coordination et de désynchronisation savante, il entraîne une
exigence ultime pour les partenariats, les accroches entre les danseurs se
devant d’être extrêmement millimétrées dans l’espace et dans le temps. Ainsi,
certaines apparitions du troisième homme ont été supprimées, notamment le
frénétique trio masculin, réduit à un duo entre Thomas Edur et César Morales,
qui clôt le premier mouvement de la partition de Bach. En revanche, Thomas Edur
a parfois effectué les parties de son cadet lorsque sa propre présence n’était
pas nécessaire sur scène. Cette entaille à l’œuvre n’était cependant pas
visible pour qui ne connaissait pas le ballet, la maestria des danseurs et la
profusion de pas jubilatoires ayant pallié les mouvements absents.
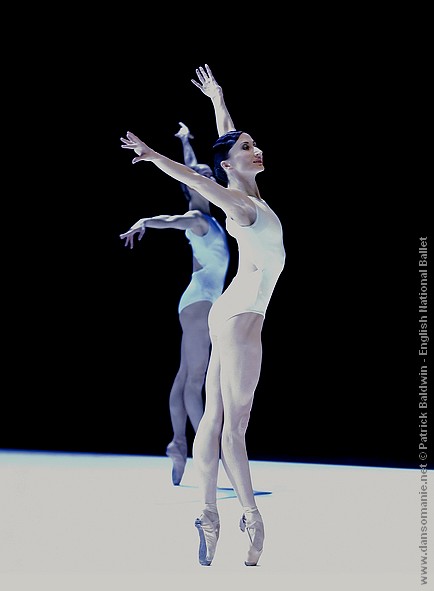
Daria Klimentova dans A Million kisses to my skin, chor. David Dawson
Le ballet
se sert à merveille des individualités présentes : la souplesse et la
vitesse de César Morales, la puissance et l'abattage d'Asta Bazevičiũte, Jenna
Lee ou Laura Bruña - grandes danseuses qui impressionnent dans les grands jetés
et les pirouettes -, la dynamique électrique d'Elena Glurdjidze ou la précision
d'Erina Takahashi.
A Million Kisses to my Skin fait appel aux
ressources ultimes des danseurs et a le charme fou des moments enivrants où le
risque de la rupture absolue déclenche l’adrénaline chez le spectateur. Point
de danger ici, mais des conduites aux frontières du possible, des mouvements où
le centre du corps devient un objet laxe piloté par des membres inférieurs et
supérieurs très marqués dans des hyper-extensions, des envolées dans certains
portés - rares d’ailleurs, sauf dans le mouvement lent -, des pirouettes
ultra-rapides, une recherche d’angles et de moments d’équilibres saisissants,
soulignés esthétiquement par un très beau travail du haut du corps. Le ballet
ne frôle jamais l’anarchie, car à chaque fois que les mouvements sont au comble
de l’exaltation, David Dawson y réinsère de la synchronie, en particulier par les
bras et les alignements, ce qui est très spectaculaire. La musique de Bach,
nourrie sans cesse par un orchestre très mordant, contribue à faire monter
tension et excitation, la chorégraphie dialoguant avec elle étroitement pour la
nier ou l’épouser, comme elle joue de l’hésitation dans les rapports entre les
danseurs. L’équilibre entre la frénésie des mouvements et leurs soudaines
synchronies, ou tout simplement l’immobilisation des danseurs relance
constamment le ballet, les pirouettes courant après le piano, les sauts des
danseurs sur les envolées de violons... Cette pièce de David Dawson est un des plus grands
frissons du ballet contemporain.

Adela Ramirez et James Forbat dans Resolution, chor. Wayne Eagling
Resolution
est l’inverse de la jouissance procurée par l’œuvre
de David Dawson. La création de Wayne Eagling est un ballet hermétique, surtout
si l’on n’accroche pas aux lieder de Mahler, car il colle parfaitement à cette
musique et ne possède pas une expressivité indépendante de celle-ci. Le
parti-pris esthétique est assez réussi : des costumes très élégants jouent
sur le sombre et la transparence pour les jupes des femmes et les tee-shirts
des hommes, tandis que les jambes voilées des filles et les bras nus des
garçons apportent une touche de clarté dans la scénographie. Des rais de
lumière très légers sur les danseurs tracent des impacts sur la scène plongée
constamment dans une pénombre qu’accentue parfois des fumigènes (un peu trop
sonores d’ailleurs, la musique de Mahler et le chant de la cantatrice étant
parfois couverts).
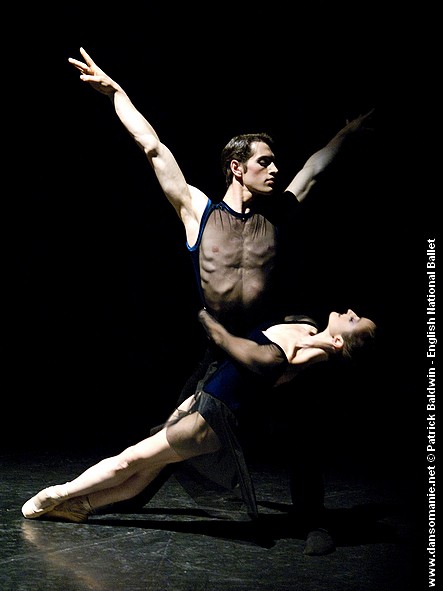
Adela Ramirez et James Forbat dans Resolution, chor. Wayne Eagling
Il est
très difficile de chorégraphier sur une ambiance et Wayne Eagling échoue là où
Christopher Wheeldon, par exemple, excelle à insuffler un contenu cohérent dans
un cadre esthétique contraignant. Le choix de courts lieder rend la tâche plus
compliquée étant donné que les changements de tableaux empêchent le spectateur
de s’installer dans le ballet. Il n’y a pas de force conductrice et peu de
lyrisme dans une chorégraphie axée sur les placements et d’innombrables portés
modernes, dont certains déjà très vus… Peut-être y a-t-il une profusion inutile
de pas, car la musique appelle plutôt à la rareté, à l’espace, voire au vide.
Dans cette ambiance, les galipettes de Medhi Angot sont hors de propos.
James Forbat, Fernanda Oliviera et Young Jae Jung dans Resolution, chor. Wayne Eagling
Le ballet
commence sur un quatuor féminin qui constitue peut-être le mouvement le plus
réussi, avec des attitudes et des synchronies élégantes et simples. Puis, les
couples se forment, le nombre de mouvements s’intensifie, et même le pas de
deux central réunissant Begoña Cao et Arionel Vargas échoue à communiquer quoi
que ce soit.
Le pas de trois masculin qui termine l’œuvre voit Medhi
Angot trituré sous toutes les coutures par Zhanat Atymtayev et Arionel Vargas.
Il saura désormais ce que c’est qu’être une ballerine dans nombre de ballets
contemporains, car il pose rarement le pied à terre - et rarement de manière
autonome -, et se retrouve constamment en l’air, dans des portés pas toujours
très réussis sur un plan esthétique. L’ensemble est très oppressant, et si
Wayne Eagling, qui a expliqué par
ailleurs que cette partie lui a été inspirée par une maladie entraînant la
dégénérescence musculaire, souhaitait instaurer ici le malaise, il engendre
plutôt le scepticisme.
Etudes doit être pris pour ce qu’il est, une construction de pas classiques
sans grand intérêt artistique, mais qui, après Resolution, apparaît
comme un élément de clarté et de jubilation… Le crescendo dans le spectaculaire
fonctionne parfaitement et la compagnie se montre très au point dans
l’exécution.
Zdenek Konvalina, principal au Ballet National du Canada,
appelé à la dernière minute pour remplacer Dmitri Gruzdyev afin que Fernando
Bufalá ne fasse pas toutes les représentations, a dû également pallier la
défection de ce dernier, et danser tous les soirs aux côtés de César Morales,
l’incontournable pirouetteur, et Arionel Vargas, le danseur romantique. Ayant
fait cette saison ses débuts dans Etudes au sein de sa compagnie
d’origine, il était donc porteur d’une fraîche expérience des exploits
techniques requis pour l’occasion.

Zdenek Konvalina dans Etudes, chor. Harald Lander
Suite aux remaniements de distribution, Zdenek Konvalina a
donc eu la surprise d’avoir comme partenaires Elena Glurdjidze et Sarah
McIlroy, alors qu’il n’était prévu au départ qu’il ne danse qu’avec Daria
Klimentová et Erina Takahashi. Les interactions ne sont pas nombreuses, puisque
le danseur romantique est Arionel Vargas pour toutes les représentations, mais
toutes ces danseuses possèdent des personnalités et des gabarits différents, ce
qui pour lui ajoutait une pression supplémentaire. Les jeunes femmes ont su
cependant le mettre à l’aise et rayonner à ses côtés, notamment le soir de la Première où Fernando
Bufalá a déclaré forfait à quelques minutes de l'entrée en scène, alors même
que Zdenek Konvalina n’était pas supposé pas danser avec Elena Glurdjidze.
Arionel Vargas, lui, connaît ses ballerines et sa
participation, dans le rôle du danseur romantique, est irrésistible de douceur
et de légèreté, malgré son grand gabarit et son mime exemplaire.

Elena Glurdjidze dans Etudes, chor. Harald Lander
Trois
ballerines se sont donc succédé dans Etudes et leurs qualités très
différentes ont enrichi le plaisir de les voir croiser leurs talents. Sarah
McIlroy, peut-être la plus concentrée sur un plan technique, s’approprie
parfaitement son rôle de démonstratrice, certaines attitudes sont impérieuses,
grâce à une envergure sereine, un port altier, et un travail du haut du corps
superbe. Elle est, tout comme Elena Glurdjidze, très à l’aise dans les passages
avec les garçons auxquels elle ne cède en rien en matière de dynamisme et de
puissance. Erina Takahashi se montre la plus délicate parmi ces ballerines et
elle excelle dans le pas de deux romantique. Elle vole littéralement dans les
bras d’Arionel Vargas, puis ensuite dans ceux de César Morales, tandis que le
solo sur pointe, d’une rare perfection, révèle une légèreté et une précision
qui sont un régal. Il est parfois difficile dans les ballets de trouver une
raison à l’exécution de ces séries sur pointe - vraiment limite - qui tuent
souvent la cohésion dramatique de l’histoire, mais dans Etudes, elles
trouvent leur justification. Elena Glurdjidze se montre également très
spectaculaire dans cet exercice, mais son travail est beaucoup plus en force,
alors qu’Erina Takahashi vit sa danse avec légèreté, communiquant un plaisir
visible. C’est elle qui s’affirme sans conteste comme la Prima Ballerina de
ces représentations.

Etudes, chor. Harald Lander
Comme la
saison assez brillante de la compagnie l’a montré, le corps de ballet se révèle
particulièrement en forme. Il a parfaitement maîtrisé les difficultés de
synchronisation d’ Etudes, tout comme il a merveilleusement rendu son
esthétique. On ne peut pas évoquer ce ballet sans parler de ce qui fait
l’existence même d’une grande compagnie, en l’occurrence un corps de ballet
cohérent et lumineux, chez les filles comme chez les garçons. C’est
actuellement l’une des caractéristiques de l’English National Ballet. Certes,
il travaille sur un répertoire limité, mais il possède cette qualité de
présenter constamment un groupe de danseurs de haute tenue.
Maraxan © 2008,
Dansomanie
A Million Kisses to my Skin
Asta Bazevičiũte (2 & 3/07), Jenna Lee (4 & 5/07),
Laura Bruña Rubio, Elena Glurdjidze, Daria Klimentová, Agnes Oaks, Erina
Takahashi
Fernando Bufalá (2/07), Anton Lukovkin (3-4 & 5/07),
Thomas Edur, César Morales
Resolution
Begoña Cao, Fernanda Oliveira, Adela Ramirez, Adrienne
Schulte
Medhi Angot, Zhanat Atymtayev, James Forbat, Young-Jae
Jung, Arionel Vargas
Etudes
Elena Glurdjidze (2/07), Sarah McIlroy (3 & 5 /07
matinée & 4/07), Erina Takahashi (3 & 5/07 soirée)
Zdenek Konvalina, César Morales & Arionel Vargas
|
|
|





























