|
English National Ballet
Du 13 au 22 juin
2008 : Strictly Gershwin, de Derek Deane, au Royal Albert Hall
Parler de
Strictly Gershwin, la nouvelle production in-the-round de l’English
National Ballet, ce serait dans l’idéal avoir la capacité d’appréhender un
monde artistique dans toute l’étendue de son vaste horizon, ce serait aussi
pouvoir apprécier une musique spécifique et ancrée dans une époque, des modes
d’expression divers porteurs de marques socioculturelles, tout en sachant
évaluer la capacité à restituer une ambiance qui n’est plus. Sinon, la question
qui se pose est : une compagnie classique de ballet peut-elle donner un spectacle
sur une musique de Gershwin? Derek Deane sait, depuis le Melody In the Move de
Michael Corder, que les danseurs de la compagnie ont le
« groove » ; la réponse est donc certainement oui - bien que
cela paraisse compliqué -, mais sans doute pas dans les contours abordés au
Royal Albert Hall par le chorégraphe. On s’interroge d’abord sur le besoin de
s’entourer de «divertissements divertissants» : s’il ne s’agit pas de
convoquer la grande messe pour une «exceptionnelle extravaganza», peut-être est-ce
pour faire découvrir le ballet à un plus large public - mais là, c’est un échec
si l’on observe les comportements des spectateurs parlant et baillant pendant
les intermèdes classiques – à moins que
le but ne soit, plus prosaïquement, de remplir le Royal Albert Hall et de
réunir des fonds…
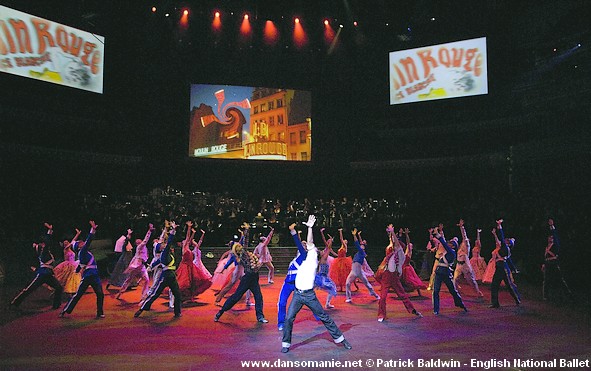
Quoi
qu’il en soit, le rendez-vous annuel au Royal Albert Hall dans les luxueuses élucubrations
«in-the-round» de Derek Deane a cette année tourné à l’ennui. Peut-être est-ce
un effet de génération ou simplement d’habitude, mais si le ballet est
quelquefois délicieusement glacé dans un hiératisme d’un autre âge, il n’en
demeure pas moins dangereusement hermétique à certains modes d’expression, même
s’il dispose par ailleurs d’un vocabulaire d’entrée qui facilite le passage
entre les vagues musicales. Or, le pari n’a pas été poussé à l’extrême, et en
s’entourant de diversions, la pure essence du ballet s’en trouve atteinte,
diminuée par la mise en exergue d’une précision et d’une clarté singulières au
milieu d’une profusion d’effets superflus qui, en offrant un accès facile,
singularisent le plus abscons. Le traitement des lumières est à cet égard très
significatif : les danseurs évoluent souvent dans la pénombre et les
visages des solistes fixés dans des halos de lumière soulignent plus des
attitudes que des mouvements. De plus, faire reposer l’ensemble sur la musique
de Gershwin comme élément fédérateur aurait nécessité peut-être des choix
sonores plus homogènes, mais surtout une implication plus dynamique (plus interactive)
de l’orchestre ou du pianiste solo, autre invité de marque. Or, les musiciens
sont loin, loin des danseurs, loin des spectateurs… et la musique reste une
annexe au visuel qui n’offre pas la continuité dramatique nécessaire pour
vraiment tenir le public en haleine deux heures et demi durant.

Derek
Deane est sans doute sincère, mais in fine, le grand spectacle attendu
fait quand même un peu cheap, à l’image des projections de photos
évoquant les maîtres et leurs muses sur des écrans géants pendant les
performances. La chanteuse est, paraît-il, une légende… Emergeant comme
d’outre-tombe dans un halo de strass, isolée, elle n’est clairement pas de la
fête, sursautant même lorsque Friedemann Vogel lui propose son bras pour la
conduire au centre de la scène, comme s’il avait envahi son espace… Les
danseurs de claquettes ont l’air sympathiques mais ne sont pas si exceptionnels
que cela et, lorsque la compagnie délivre elle-même une version de "Lady
Be Good" tout aussi honorable que celle des spécialistes invités, leur
présence laisse perplexe. Surtout, les deux danseurs de salon sont hors
contexte, car lorsqu’on leur fait côtoyer l’excellence, ils n’existent tout
simplement pas. Sans juger de leurs qualités dans cette discipline, ils ont
échoué à provoquer l’admiration - ne serait-ce qu’en faisant reconnaître leur
spécificité -, et par là même à justifier leur présence dans le spectacle.

Est-ce
par impossibilité de se dégager de son hexis corporel, ou bien Derek
Deane a-t-il voulu que cette différence danseurs classiques / danseurs de salon
se perçoive dans la succession des numéros ? Nous les danseurs de ballet,
gracieux, minces, précis et classieux, eux les entertaineurs, brusques, épais,
patauds et un rien vulgaires ? Ou bien, nous les entertaineurs, vifs,
brillants, dilettantes et généreux, eux les danseurs de ballet, sérieux,
linéaires, sobres et coincés ? Bref, les deux mondes ne se mélangent pas et la
vision frontale de Daria Klimentová en tutu au bout des bras de Dmitri Gruzdyev
laisse planer dans le camp des balletomanes une ombre d’infinie majesté au
milieu de la scène lorsqu’elle contemple les autres couples prosaïquement
terrestres dans le final de "’S Wonderful" Mais là où on
aurait pu tirer parti des extrêmes, on se complait dans le juste milieu.
Compromis ou manque d’inspiration ? Derek Deane ne montre pas beaucoup
d’originalité dans ses pas de deux confiés pour la première à Thomas Edur et
Agnès Oaks - les danseurs principaux invités mais "résidents" de la
compagnie - ou à Friedemann Vogel, du Ballet de Stuttgart, partenaire tour à
tour d’Elena Glurdjidze ou de Daria Klimentová. Guillaume Côté, du Ballet
National du Canada, et Tamara Rojo - ancienne danseuse de la compagnie du temps
de la direction de Derek Deane, maintenant au Royal Ballet -, ne sont pas mieux
servis, même s’ils se voient attribuer les moments les plus classiques dans
"An American in Paris" et surtout dans "Rhapsody In
Blue".

Les duos
connus, ou improvisés pour l’occasion, restent cependant peu inspirés dans les
passages classiques : "The Man I Love" n’est pas vraiment
extraordinaire et il est surtout bien trop court pour installer une ambiance,
même si l’on reconnaît l’osmose du couple phare de la compagnie (Thomas
Edur/Agnès Oaks), "Summertime",
son pendant dans la deuxième partie, interprété par Daria Klimentová et
Friedemann Vogel, est trop axé sur des portés et des attitudes peu originales,
le vocabulaire classique ne se pliant guère que dans ses pas les plus convenus
aux musiques choisies. Il manque ici et la profondeur et le raffinement, et à
l’occasion des changements de distributions - les danseurs invités étant cette
fois remplacés par les danseurs de la compagnie -, le spectacle, impersonnel,
ne s’enrichit pas de nouvelles dimensions.

Peut-être
est-ce plutôt dans les morceaux où la compagnie se meut en grappe que l’on
retrouve un peu de ce qui fait le charme du ballet - mais sans être justement
du ballet -, dans les gestes précis et synchronisés dans "Shall We
Dance", écho de Fred Astaire et Ginger Rogers, mené par Elena
Glurdjidze sur pointes et Friedemann Vogel - ou César Morales et Erina
Takahashi en fin de semaine -, aux côtés d’un corps de ballet très extatique
qui démontre qu’il n’est nul besoin d’être spécialiste de la danse de salon pour faire swinguer une salle, ou
encore dans le numéro de claquettes de Kerry Birkett et ses camarades, court
mais efficace.

Le
spectacle est toutefois marqué par des changements de rythme annoncés d’emblée
avec une classe d’environ dix minutes, clin d’œil triste à "Etudes"que
la compagnie reprend la semaine prochaine au Royal Festival Hall de
Londres. Le public, d’abord amusé puis
médusé après s’être un peu
chauffé avec
l’introduction entraînante de l’orchestre, prend
alors conscience de la
réalité. Dans l’immense Royal Albert Hall, quinze
couples de danseurs se
livrent ainsi à une démonstration de leurs exercices
quotidiens, d’abord au son
du piano, dans un crescendo pas suffisamment rapide pour
détendre l’atmosphère,
et en rendent alors plus d’un perplexe. Même si
l’idée d’imposer dès le début
une ligne - ici, on est au ballet - pouvait séduire (les
balletomanes), elle
divise définitivement le public de manière pratique,
comme la distribution
l’avait partagé sur un plan conceptuel. Or, pour les
amateurs de ballet, Derek
Deane ne réussit pas à trouver le point
d’achoppement même dans cette classe
qui s’étire en longueur de barre sans barre et
pratiquement sans milieu.


Les
danseurs sont souvent pris dans une course à la recherche de lignes et d’effets
qui seront bien visibles de partout, ce qui nuit à la cohérence chorégraphique,
par ailleurs un peu pauvre. Le pari de combler l’espace que cette immense arène
dessine en permanence ne se gagne pas par le nombre, il devrait l’être par les
émotions, la passion, la tension, le rythme, comme paradoxalement des ballets a
priori peu adaptés à cette configuration in-the-round ont pu le faire par le
passé, notamment Roméo et Juliette ou Le Lac des cygnes.
Le corps de ballet masculin est ainsi particulièrement sous-employé au service
d’une chorégraphie du reste très répétitive pour les jeunes femmes.

Seul "Rhapsody
in Blue" offre tour à tour à Guillaume Côté ou Friedemann Vogel une
occasion de briller, ce dernier peut-être un peu plus fluide et aérien avec
Daria Klimentová comme partenaire. Friedemann Vogel est sans doute d’ailleurs
le seul invité à avoir pu, grâce à une dynamique très extériorisée, imposer une
réelle figure de soliste à travers les différents rôles qu’il a abordés. Il
faut enfin souligner le bon esprit des danseurs de la compagnie qui, sur
pointes, en chaussures à talons, en claquettes, ou même en rollers et à
bicyclette, ont fait preuve d’une adaptabilité remarquable au service d’un
spectacle en marge du répertoire.
Maraxan © 2008,
Dansomanie
|
|





























