 |




|

 |
|
|
 Quelle
trajectoire personnelle vous a conduit à tourner des films
sur la danse?
J’ai
d’abord fait des études de cinéma et de
théâtre. Mon premier film, je l’ai
tourné
alors que j’étais encore étudiante. Il
s’agissait d’une fiction-document
consacrée à
Damia, une chanteuse d’avant Piaf. Le film a
été
sélectionné à Cannes et
extrêmement bien
accueilli. Il a même été vendu et
j’ai ainsi
gagné de l’argent, ce qui m’a permis de
continuer
dans cette voie. Mais moi, j’ignorais quel type de film
j’allais réaliser par la suite. Dans mon esprit,
le film
suivant ne devait pas porter nécessairement sur une
chanteuse,
il devait être uniquement motivé par mes
rencontres, mes
choix ou mes attirances artistiques. J’ai ainsi
écrit de
nombreux scénarios, qui ont été
refusés
à la commission des subventions, et cela m’a en
quelque
sorte «bloquée».
Parallèlement, j’avais
fait une rencontre, celle de mon ex-mari, metteur en scène
de
théâtre et d’opéra [Petrika
Ionesco,
notamment à l’origine des décors de la Cendrillon
de Noureev]. Je me suis alors plongée avec passion dans le
monde
du théâtre : j’ai notamment
été
assistante à la mise en scène, j’ai
appris la
direction d’acteurs… Pendant quelques
années,
j’ai donc laissé de côté le
cinéma.
C’est dans cet univers du théâtre que
j’ai
fait deux rencontres importantes : celles de Carolyn Carlson et de
Larrio Ekson. C’est par eux que je suis revenue à
la
danse. Revenue, car je connaissais la danse, j’avais fait de
la
danse jusqu’à 15 ans… J’ai
été
fascinée par les chorégraphies de Carolyn Carlson
et
c’est donc sur elle que j’ai fait mon premier film
sur la
danse, intitulé Blue
Marine.
Il s’agissait d’une petite fiction de 12 minutes,
tournée dans les souterrains de l’Opéra
de Paris,
et faite uniquement à partir de rushes.
Peut-on
à partir de là percevoir un projet à
long terme
derrière cette galerie de portraits que constituent vos
films
sur la danse?
Après
Blue
Marine,
le deuxième film que j’ai fait est La Barque
sacrée,
un film que je considère comme très important et
abouti.
J’ai eu beaucoup de chance car il a été
tourné avec le chef-opérateur que je voulais
absolument
avoir, à savoir Henri Alekan [chef-opérateur de
nombreux
films, notamment La Belle
et la Bête],
décédé peu après. Ce film
évoquait
la mythologie égyptienne, et plus
précisément le
mythe d’Isis et d’Osiris. Carolyn Carlson y
interprétait le rôle d’Isis, Larrio
Ekson celui
d’Osiris, tandis que Jorma Uotinen [danseur de la compagnie
de
Carolyn Carlson] était Seth. Ce film a
été
tourné en studio et coproduit par France 3 et la Sept,
c’était juste avant la création
d’Arte.
C’est mon film majeur, celui qui m’a vraiment
plongée dans l’univers de la danse.
Mon
idée
était en fait de construire toute une série sur
les
mythes, où les danseurs se substitueraient aux
comédiens,
et où, à chaque fois, un chorégraphe
différent serait évoqué. Le projet
suivant devait
ainsi porter sur la mythologie grecque. Le film était
prêt, il s’intitulait Le
Rêve d’Icare,
mais finalement il n’a pas pu se faire. Il faut avouer que
j’ai mis du temps à m’en remettre
financièrement. Pendant tout ce temps, j’ai
écrit
de nombreux projets, notamment sur le chamanisme, mais aussi sur la
danse.
C’est
en fait en voyant Le
Rêve d’Othello,
une création chorégraphique de Larrio Ekson,
interprétée par ce dernier et Agnès
Letestu, que
j’ai eu l’idée de créer une
petite fiction
sur le thème d’Othello.
J’ai passé beaucoup de temps sur le
montage,
après avoir tourné ce film en surimpression, une
technique rarement utilisée dans le domaine de la danse et
d’autant plus risquée que les balletomanes aiment
voir des
images «pures». Mais ici, le recours à
ce
procédé était
spécifiquement lié au
thème de la folie d’Othello. Agnès
Letestu a
beaucoup apprécié ce film et sa
réalisation.
J’ai
ensuite tourné un portrait de Larrio Ekson,
intitulé Flight of
Eagle Spirit.
Le film s’est fait entre Paris, New York et Venise.
J’ai
voulu raconter le parcours de ce danseur exceptionnel qui,
après
avoir connu une enfance très difficile à Harlem
et
découvert la danse à seulement 16 ans,
s’est
retrouvé en Europe à interpréter les
rôles
principaux dans les ballets de Jiri Kylian, de Maurice
Béjart,
de Roland Petit, et évidemment de Carolyn Carlson, dont il a
été le partenaire pendant trente ans. Je
l’ai plus
tard filmé dans un solo à la Biennale de Venise.
Ce film,
Agnès
Letestu l’a aussi vu et aimé, et à
partir de
là, le projet de lui consacrer un portrait est
né,
d’autant plus qu’elle atteignait –
c’était en 2004-2005 – sa
période de
maturité en tant qu’interprète.
J’ai donc
suivi Agnès Letestu pendant un ou deux ans, à
Paris, mais
aussi à Florence et à Valence et le
résultat,
c’est le film Regards sur une étoile.
Quelle
trajectoire personnelle vous a conduit à tourner des films
sur la danse?
J’ai
d’abord fait des études de cinéma et de
théâtre. Mon premier film, je l’ai
tourné
alors que j’étais encore étudiante. Il
s’agissait d’une fiction-document
consacrée à
Damia, une chanteuse d’avant Piaf. Le film a
été
sélectionné à Cannes et
extrêmement bien
accueilli. Il a même été vendu et
j’ai ainsi
gagné de l’argent, ce qui m’a permis de
continuer
dans cette voie. Mais moi, j’ignorais quel type de film
j’allais réaliser par la suite. Dans mon esprit,
le film
suivant ne devait pas porter nécessairement sur une
chanteuse,
il devait être uniquement motivé par mes
rencontres, mes
choix ou mes attirances artistiques. J’ai ainsi
écrit de
nombreux scénarios, qui ont été
refusés
à la commission des subventions, et cela m’a en
quelque
sorte «bloquée».
Parallèlement, j’avais
fait une rencontre, celle de mon ex-mari, metteur en scène
de
théâtre et d’opéra [Petrika
Ionesco,
notamment à l’origine des décors de la Cendrillon
de Noureev]. Je me suis alors plongée avec passion dans le
monde
du théâtre : j’ai notamment
été
assistante à la mise en scène, j’ai
appris la
direction d’acteurs… Pendant quelques
années,
j’ai donc laissé de côté le
cinéma.
C’est dans cet univers du théâtre que
j’ai
fait deux rencontres importantes : celles de Carolyn Carlson et de
Larrio Ekson. C’est par eux que je suis revenue à
la
danse. Revenue, car je connaissais la danse, j’avais fait de
la
danse jusqu’à 15 ans… J’ai
été
fascinée par les chorégraphies de Carolyn Carlson
et
c’est donc sur elle que j’ai fait mon premier film
sur la
danse, intitulé Blue
Marine.
Il s’agissait d’une petite fiction de 12 minutes,
tournée dans les souterrains de l’Opéra
de Paris,
et faite uniquement à partir de rushes.
Peut-on
à partir de là percevoir un projet à
long terme
derrière cette galerie de portraits que constituent vos
films
sur la danse?
Après
Blue
Marine,
le deuxième film que j’ai fait est La Barque
sacrée,
un film que je considère comme très important et
abouti.
J’ai eu beaucoup de chance car il a été
tourné avec le chef-opérateur que je voulais
absolument
avoir, à savoir Henri Alekan [chef-opérateur de
nombreux
films, notamment La Belle
et la Bête],
décédé peu après. Ce film
évoquait
la mythologie égyptienne, et plus
précisément le
mythe d’Isis et d’Osiris. Carolyn Carlson y
interprétait le rôle d’Isis, Larrio
Ekson celui
d’Osiris, tandis que Jorma Uotinen [danseur de la compagnie
de
Carolyn Carlson] était Seth. Ce film a
été
tourné en studio et coproduit par France 3 et la Sept,
c’était juste avant la création
d’Arte.
C’est mon film majeur, celui qui m’a vraiment
plongée dans l’univers de la danse.
Mon
idée
était en fait de construire toute une série sur
les
mythes, où les danseurs se substitueraient aux
comédiens,
et où, à chaque fois, un chorégraphe
différent serait évoqué. Le projet
suivant devait
ainsi porter sur la mythologie grecque. Le film était
prêt, il s’intitulait Le
Rêve d’Icare,
mais finalement il n’a pas pu se faire. Il faut avouer que
j’ai mis du temps à m’en remettre
financièrement. Pendant tout ce temps, j’ai
écrit
de nombreux projets, notamment sur le chamanisme, mais aussi sur la
danse.
C’est
en fait en voyant Le
Rêve d’Othello,
une création chorégraphique de Larrio Ekson,
interprétée par ce dernier et Agnès
Letestu, que
j’ai eu l’idée de créer une
petite fiction
sur le thème d’Othello.
J’ai passé beaucoup de temps sur le
montage,
après avoir tourné ce film en surimpression, une
technique rarement utilisée dans le domaine de la danse et
d’autant plus risquée que les balletomanes aiment
voir des
images «pures». Mais ici, le recours à
ce
procédé était
spécifiquement lié au
thème de la folie d’Othello. Agnès
Letestu a
beaucoup apprécié ce film et sa
réalisation.
J’ai
ensuite tourné un portrait de Larrio Ekson,
intitulé Flight of
Eagle Spirit.
Le film s’est fait entre Paris, New York et Venise.
J’ai
voulu raconter le parcours de ce danseur exceptionnel qui,
après
avoir connu une enfance très difficile à Harlem
et
découvert la danse à seulement 16 ans,
s’est
retrouvé en Europe à interpréter les
rôles
principaux dans les ballets de Jiri Kylian, de Maurice
Béjart,
de Roland Petit, et évidemment de Carolyn Carlson, dont il a
été le partenaire pendant trente ans. Je
l’ai plus
tard filmé dans un solo à la Biennale de Venise.
Ce film,
Agnès
Letestu l’a aussi vu et aimé, et à
partir de
là, le projet de lui consacrer un portrait est
né,
d’autant plus qu’elle atteignait –
c’était en 2004-2005 – sa
période de
maturité en tant qu’interprète.
J’ai donc
suivi Agnès Letestu pendant un ou deux ans, à
Paris, mais
aussi à Florence et à Valence et le
résultat,
c’est le film Regards sur une étoile.
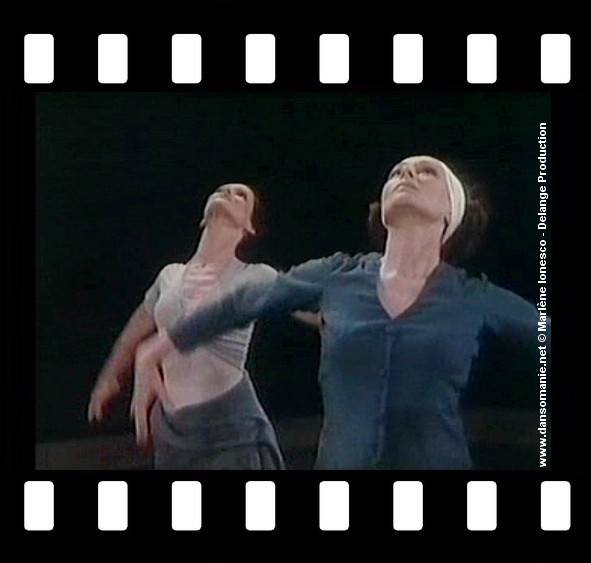 Comment
avez-vous décidé ensuite de tourner le film Comme
un rêve?
Tout est
parti
d’une rencontre. Dans un premier temps, c’est
Larrio Ekson,
avec lequel j’avais tourné Le Rêve
d’Othello,
qui m’a présenté Dominique Khalfouni et
plus ou
moins suggéré de faire un film sur elle. Cette
rencontre
avait eu lieu à l’occasion de la projection du Rêve
d’Othello
que Dominique avait du reste beaucoup apprécié.
Je
n’étais pas opposée à
l’idée de
Larrio, mais j’ignorais alors ce qui allait advenir de tout
cela.
C’est petit à petit que le projet s’est
imposé à moi. J’ai pourtant mis au
moins deux ans
pour convaincre Dominique Khalfouni de
l’intérêt de
ce tournage. Ensuite, il a fallu la découvrir peu
à peu,
car elle ne se livre pas facilement. Au fond, ce film a
été une aventure, comme tout film, mais une
aventure
progressive, en même temps qu’une amitié
magnifique.
Très rapidement, il est apparu évident
qu’il
fallait également évoquer Mathieu Ganio dans le
portrait
de Dominique Khalfouni, autrement dit la transmission de la
mère
au fils. Il venait d’être nommé
étoile et les
points communs entre leurs deux trajectoires sautaient aux yeux
Comment
avez-vous décidé ensuite de tourner le film Comme
un rêve?
Tout est
parti
d’une rencontre. Dans un premier temps, c’est
Larrio Ekson,
avec lequel j’avais tourné Le Rêve
d’Othello,
qui m’a présenté Dominique Khalfouni et
plus ou
moins suggéré de faire un film sur elle. Cette
rencontre
avait eu lieu à l’occasion de la projection du Rêve
d’Othello
que Dominique avait du reste beaucoup apprécié.
Je
n’étais pas opposée à
l’idée de
Larrio, mais j’ignorais alors ce qui allait advenir de tout
cela.
C’est petit à petit que le projet s’est
imposé à moi. J’ai pourtant mis au
moins deux ans
pour convaincre Dominique Khalfouni de
l’intérêt de
ce tournage. Ensuite, il a fallu la découvrir peu
à peu,
car elle ne se livre pas facilement. Au fond, ce film a
été une aventure, comme tout film, mais une
aventure
progressive, en même temps qu’une amitié
magnifique.
Très rapidement, il est apparu évident
qu’il
fallait également évoquer Mathieu Ganio dans le
portrait
de Dominique Khalfouni, autrement dit la transmission de la
mère
au fils. Il venait d’être nommé
étoile et les
points communs entre leurs deux trajectoires sautaient aux yeux.
Sur
combien de temps s’est déroulé le
tournage?
Le projet
s’est
concrétisé fin 2006, et le tournage a eu lieu
principalement mi-2007. J’ai fait un premier montage, sachant
que
le film n’était pas achevé, car je
voulais
absolument avoir les témoignages de Mikhaïl
Barychnikov et
Vladimir Vassiliev. Je me suis d’ailleurs
particulièrement
attachée à ce dernier, d’une part parce
qu’il
était très heureux de revoir Dominique Khalfouni
et
d’autre part pour le contenu si touchant de ses propos. Le
film
s’est donc fait à peu près sur deux ans.
J’ai
aussi voulu
suivre Mathieu Ganio à Saint-Pétersbourg quand
j’ai
appris qu’il allait danser Giselle avec Olesia Novikova dans
le
cadre du Festival du Mariinsky. Le concernant, je voulais terminer sur
une chorégraphie contemporaine, et comme Wayne McGregor
m’avait donné son accord, j’ai
filmé les
répétitions de Genus (on voit aussi deux minutes
de
spectacle) avec Agnès Letestu. Cela permettait
d’illustrer
une certaine évolution du répertoire de
l’Opéra de Paris. Il était
également
important à mes yeux de filmer Mathieu Ganio
précisément avec Agnès Letestu, qui
est
liée de près à sa nomination en tant
qu’étoile sur Don
Quichotte.
Il y avait là aussi comme une histoire de transmission. Je
me
suis dit aussi que c’était peut-être la
dernière fois qu’ils dansaient ensemble.
Pour
Dominique
Khalfouni, la recherche de documents, qui constituent un des aspects de
son portrait, s’est avérée
très difficile.
Par ailleurs, certains étaient très
abîmés,
comme ceux avec Noureev. D’une certaine manière,
ce
travail-là a aussi été une
véritable
aventure.
 Comment
s’est fait le choix des intervenants?
C’est
un choix
personnel que j’ai également soumis à
Dominique
Khalfouni. Il y a aussi eu des changements au cours de la
réalisation… Je tenais en tout cas à
avoir les
témoignages de Michaël Denard ou de Patrick Dupond.
Le
choix s’est finalement porté sur Michaël
Denard, car
il a été un partenaire fréquent de
Dominique
Khalfouni. Cela dit, elle a apprécié tous ses
partenaires, il faut le souligner. La présence de Vladimir
Vassiliev était très importante, du fait de
l’admiration profonde que lui porte Dominique Khalfouni,
admiration qui s’étend plus
généralement
à la Russie. Mikhaïl Barychnikov était
aussi une
évidence, car elle a fait une tournée pendant six
mois
avec lui et l’ABT. Elle a d’ailleurs
hésité
un an ou deux entre les Etats-Unis et le Ballet de Marseille,
qu’elle a finalement décidé de
rejoindre, il est
vrai aussi pour ses enfants qui étaient alors en bas
âge.
Quant à Pierre Lacotte, il est un très grand
admirateur
de Dominique Khalfouni. Il a recréé Le
Papillon pour
elle et fait ses adieux à la scène dans ce pas de deux
qu’il interprétait à ses côtés. De
tels détails, peut-être moins connus, m’ont paru
importants et c’est aussi pour cela que j’ai voulu les
montrer dans le film.
Pourquoi
ce titre : Comme un rêve?
Un jour,
dans la salle
de montage, Dominique Khalfouni m’a dit : «Ce film,
ça a été comme un
rêve». Le titre est
venu comme ça, très simplement.
Comment
s’est fait le choix des intervenants?
C’est
un choix
personnel que j’ai également soumis à
Dominique
Khalfouni. Il y a aussi eu des changements au cours de la
réalisation… Je tenais en tout cas à
avoir les
témoignages de Michaël Denard ou de Patrick Dupond.
Le
choix s’est finalement porté sur Michaël
Denard, car
il a été un partenaire fréquent de
Dominique
Khalfouni. Cela dit, elle a apprécié tous ses
partenaires, il faut le souligner. La présence de Vladimir
Vassiliev était très importante, du fait de
l’admiration profonde que lui porte Dominique Khalfouni,
admiration qui s’étend plus
généralement
à la Russie. Mikhaïl Barychnikov était
aussi une
évidence, car elle a fait une tournée pendant six
mois
avec lui et l’ABT. Elle a d’ailleurs
hésité
un an ou deux entre les Etats-Unis et le Ballet de Marseille,
qu’elle a finalement décidé de
rejoindre, il est
vrai aussi pour ses enfants qui étaient alors en bas
âge.
Quant à Pierre Lacotte, il est un très grand
admirateur
de Dominique Khalfouni. Il a recréé Le
Papillon pour
elle et fait ses adieux à la scène dans ce pas de deux
qu’il interprétait à ses côtés. De
tels détails, peut-être moins connus, m’ont paru
importants et c’est aussi pour cela que j’ai voulu les
montrer dans le film.
Pourquoi
ce titre : Comme un rêve?
Un jour,
dans la salle
de montage, Dominique Khalfouni m’a dit : «Ce film,
ça a été comme un
rêve». Le titre est
venu comme ça, très simplement.
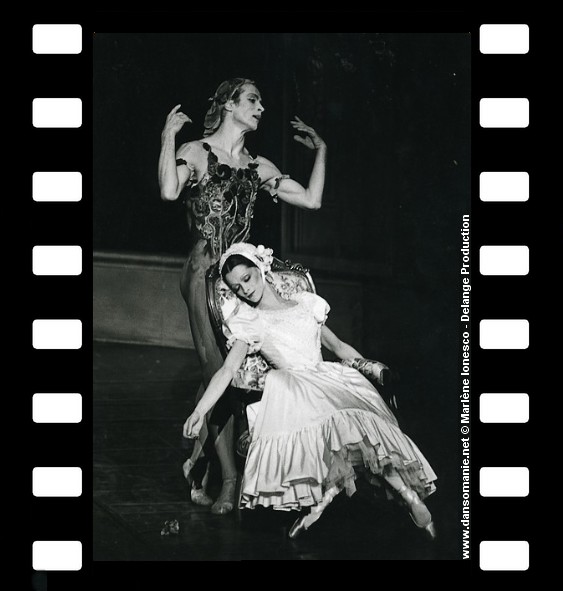 Avez-vous
des modèles en matière de films de danse?
Non. Ce
qui peut
éventuellement m’influencer, ce sont certains
cinéastes que j’ai aimés. Le
cinéma
tchèque, le cinéma italien, Kubrick aussi, et
surtout le
cinéma russe : Mikhalkov, notamment quand il traite
Tchekhov, ou
Konchalovsky. Comme un rêve a d’ailleurs
été
sélectionné en novembre dernier pour un festival
de
documentaires à la Fondation Soljenitsyne à
Moscou. Le
film a été conservé dans les archives
de la
Fondation et j’ai moi-même reçu un
diplôme
pour la promotion de la culture russe dans le monde. A cet
égard, je suis, tout comme Dominique Khalfouni,
très
attirée par la Russie. La Giselle
du Festival du Mariinsky, dont on voit des extraits dans le film, a par
exemple été une magnifique expérience
: j’ai
trouvé Olesia Novikova merveilleuse aux
côtés de
Mathieu Ganio. Cette fille est vraiment un amour, elle m’a du
reste fait penser à Dominique Khalfouni.
J’espère
vraiment que Mathieu Ganio pourra y retourner danser cette
année.
Avez-vous
des modèles en matière de films de danse?
Non. Ce
qui peut
éventuellement m’influencer, ce sont certains
cinéastes que j’ai aimés. Le
cinéma
tchèque, le cinéma italien, Kubrick aussi, et
surtout le
cinéma russe : Mikhalkov, notamment quand il traite
Tchekhov, ou
Konchalovsky. Comme un rêve a d’ailleurs
été
sélectionné en novembre dernier pour un festival
de
documentaires à la Fondation Soljenitsyne à
Moscou. Le
film a été conservé dans les archives
de la
Fondation et j’ai moi-même reçu un
diplôme
pour la promotion de la culture russe dans le monde. A cet
égard, je suis, tout comme Dominique Khalfouni,
très
attirée par la Russie. La Giselle
du Festival du Mariinsky, dont on voit des extraits dans le film, a par
exemple été une magnifique expérience
: j’ai
trouvé Olesia Novikova merveilleuse aux
côtés de
Mathieu Ganio. Cette fille est vraiment un amour, elle m’a du
reste fait penser à Dominique Khalfouni.
J’espère
vraiment que Mathieu Ganio pourra y retourner danser cette
année.
Pour
revenir
à la question, oui, j’ai vu des films de danse,
notamment
ceux de Dominique Delouche, dont j’ai suivi le travail, ce
qui ne
m’empêche pas d’aller mon propre chemin.
Qu’est-ce
qui au fond relie tous vos films?
Pour
répondre
à cette question, je dirais qu’il y a bien une
cohérence artistique derrière tous mes
films. A
chaque fois, c’est la conjonction de plusieurs facteurs : des
opportunités, des rencontres artistiques, sans
oublier une
attirance humaine. Pour moi, on ne peut pas faire un film sur la danse
et sur des danseurs sans une émotion
particulière, une
émotion qui doit exister dès le
départ. Dominique
Khalfouni m’émeut, tout comme Agnès
Letestu,
extraordinaire dans certains rôles. C’est cette
émotion qui me donne envie de suivre des artistes.
Après,
il est évident que certains se livrent plus que
d’autres.
Larrio Ekson par exemple se livre très facilement :
c’est
quelqu’un de très généreux
qui a un immense
besoin d’échange. C’est aussi le cas de
Vladimir
Vassiliev. Avec d’autres, que ce soit Agnès
Letestu ou
Mikhaïl Barychnikov, c’est plus difficile.
Barychnikov
notamment est très renfermé, il se livre peu, on
le
ressent d’ailleurs, je crois, dans le film. Il y a simplement
des
êtres que j’ai envie d’approcher :
Vassiliev ou
Maximova par exemple, je pourrais les filmer tout de suite,
même
si cela a déjà été
fait… Filmer de
belles images de danse ne me suffit pas, il me faut autre chose qui
relève de la sensibilité. Pour la suite? Natalia
Makarova
m’attire beaucoup, mais au fond, je ne sais pas ce que je
vais
faire et le futur reste encore un point
d’interrogation…
Entretien
réalisé le 13 décembre 2008
Dansomanie
© 2009
|
|
|
|
|
|





























